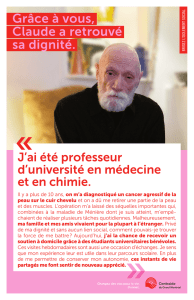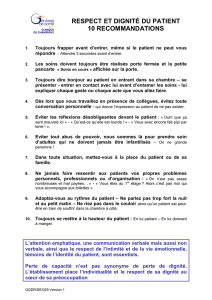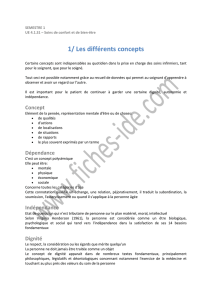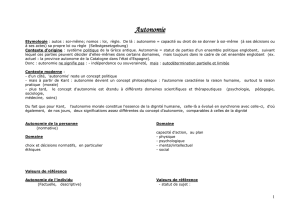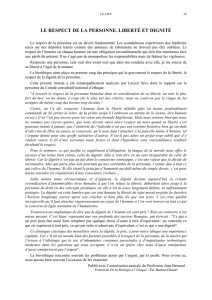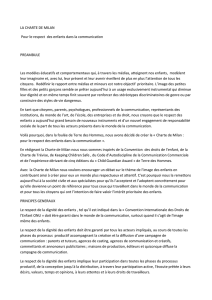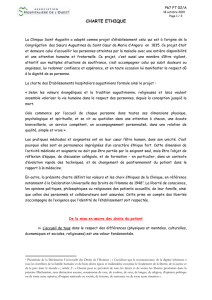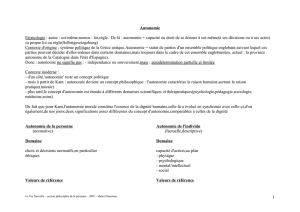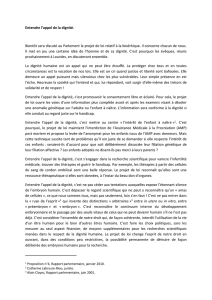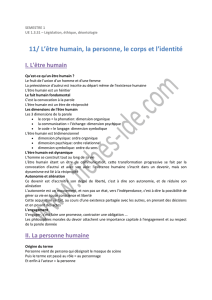la dignite - Centre Hospitalier George Sand

LA DIGNITE : CONCEPT FLOU !
Sans doute le propre du langage est-il de susciter des malentendus, à partir de notions
qui semblent évidentes, qui paraissent aller tellement de soi qu’on ne les remet pas en
question, qu’on ne s’interroge plus sur leur sens, et qu’on véhicule alors comme autant
d’impératifs catégoriques, de prescriptions éthiques, de bonnes pratiques thérapeutiques. S’il
est une notion qui véhicule une telle doxa, une pensée unique, un sens commun moral, c’est
en particulier celle de dignité, qui devient un concept central dans le monde de la santé. La
haute autorité de santé, dans un rapport récent sur les maltraitances passives de nature
organisationnelle dans les établissements de santé, a pointé diverses atteintes à la dignité,
essayant par là même d’en donner une définition positive, voire positiviste, en qualifiant, en
critérisant par conséquent, ce que peut être la dignité.
Or la dignité n’est pas ce que l’on croit. Alors que nous pensons qu’il s’agit d’un
concept libérateur, dont nous croyons qu’il est une manière d’affirmation et de reconnaissance
de la valeur de l’homme, il peut être, souvent, au contraire un concept empreint d’archaïsme,
de condescendance, et certaines conceptions de la dignité aboutissent à l’inverse de ce qu’on
pense qu’elles pourraient défendre. C’est le mérite du récent ouvrage de Monsieur Eric FIAT,
agrégé de philosophie, Maître de conférences en philosophie à l’Université de Paris-Est/
Marne la Vallée, Professeur au Centre de formation du Centre hospitalier de l’AP-HP, :
« Grandeurs et misères des hommes, Petit traité de dignité », Larousse 2010, de le rappeler
avec force et vigueur.
On perçoit au passage combien la philosophie peut nous aider aussi à penser nos
pratiques soignantes.

Il est possible d’identifier au moins cinq conceptions de la dignité : une conception
bourgeoise et libérale, une conception chrétienne ou monothéÏste, une conception kantienne,
une conception hégelienne, et une conception cartésienne.
Que nous enseigne d’abord l’étymologie ?
Le mot apparaît vers la fin du 11
ème
siècle, et vient du latin dignitas. Le mot dignitaire,
celui qui est digne, n’apparaîtra quant à lui qu’en 1752 dans le dictionnaire de Trévoux,
dictionnaire établi par les jésuites au XVIIIè siècle. Le mot indigne, de indignus n’apparaîtra
qu’à la fin du 12
ème
siècle, l’indignité n’apparaissant qu’au 14
ème
siècle, tandis qu’indignation
verra le jour au début du 13
ème
siècle.
Qu’est ce que la dignitas, c’est un mérite, et par suite des qualités qui font qu’on est
digne, qu’on est reconnu comme différend des autres, souvent plus éminent, plus élevé
qu’eux. C’est donc une distinction, quelque chose qui singularise, plutôt que quelque chose
qui universalise. La dignité, par conséquent, apparaît antinomique de l’Egalité. Et peut donc,
somme toute, être contestée comme valeur républicaine.
Les sociétés d’anciens régimes, qui affichaient les différences, font de la dignité une
évidence. Il va de soi, dans ces sociétés, que les hommes sont différents, se distinguant
d’abord par le bénéfice ou non de privilèges. Il existe une différence d’Etat, entre les trois
ordres, que sont noblesse, clergé et tiers-état, ordres qui ne bénéficient pas tous du même
statut, de la même reconnaissance, donc de la même dignité, donc des mêmes qualités. En
abolissant les privilèges dans la nuit du 4 août la révolution transforme, non pas comme on le
croit, à tort, les conditions économiques, mais la conception de l’homme, dont elle fait un
homme sans qualité, pour reprendre un titre d’un ouvrage de Robert Musil, c’est à dire dont la

distinction n’est pas d’essence, n’est pas ontologique, même si elle peut l’être de manière
existentielle et phénoménologique. Il n’existe plus de différence de nature entre les hommes,
tout juste, peut être une différence de culture, qui, ainsi que le dit Rousseau, pourrait
cependant encore pervertir la nature, c’est à dire abolir cette égalité naturelle entre les
hommes.
Et cette idée de l’Egalité naturelle va effectivement être pervertie par les différences
culturelles, au point qu’on pourra considérer l’idée naturelle comme une superstructure, et la
culture – réduite pour Marx aux rapports de production – comme une infrastructure, l’Egalité
naturelle entre les hommes devenant pour les marxistes une fiction idéaliste.
Il est vrai que la société bourgeoise, issue de la Révolution française, va reconstruire
de la différence, de la mesure, une gradation entre les individus, à partir de critères, le plus
souvent matériels, économiques, mais aussi de critères psychologiques, de comportement,
d’attitude, de décence, de contenance, qui vont passer par la répression du corps, du sexe, des
instincts, de tout ce qui peut être l’expression même de la nature. Selon cette conception,
parce que nous sommes naturellement égaux, l’expression de la nature en nous doit être
identique, et mieux encore invisible ; le corps dès lors devient tabou, interdit, masqué, caché,
et n’a plus droit de cité ; pas plus que n’ont droit de cité ses dysfonctionnements ; de la
contenance à la continence, il n’y a qu’un pas ; contenance vestimentaire et d’attitude ; cul
serré, dira-t-on; continence sexuelle et des fonctions d’excrétion ; cul serré aussi, à ce niveau.
Qui d’ailleurs montre son corps est indigne : c’est le fou, le dément, c’est la prostituée, les uns
et les autres rejetés de la cité des hommes, et enfermés dans des maisons (de fous, de retraite –
mot emprunt lui aussi de différenciation, de désignation, de stigmatisation, à comparer au
jubilada (de joie) du castillan- de tolérance) ; c’est un peu l’ouvrier soumis à ses instincts,

passions, atavismes et à son hérédité, renvoyé dans sa cité, son quartier (différenciation
segmentation spatiale) ainsi que le peint Zola. Ce sont ceux qui ne sont pas libres par rapport
à leur corps, ses passions et ses pulsions. C’est aussi la sorcière échevelée, créature
diabolique, et donc tous ceux qui vont avoir le « diable au corps ». Mais c’est aussi la femme
enceinte, qui, à l’inverse des sociétés d’ancien régime, où les reines accouchaient en public,
cache alors souvent longtemps sa grossesse.
Il y a donc ceux qui savent se tenir, dignes de considération, et ceux qui ne savent pas,
qui ne font pas partie de notre monde, conception entre plusieurs mondes qui se substitue aux
différents ordres de l'ancien régime.
Pour autant le cloisonnement est moins important entre les différents mondes qu’entre
les différents ordres anciens, puisqu’aussi bien, certains, particulièrement méritants, peuvent
passer d’un monde à l’autre, ou espérer le faire, par le biais de la méritocratie républicaine,
par le biais aussi de l’exemplarité de sa conduite et de ses mœurs ; heureux donc ceux qui sont
de bonnes mœurs, ou qui s’auront s’élever par l’exemple de leurs qualités, un travail incessant
et fécond sur soi-même, travail qu’ils ne cesseront de glorifier. Nous ne serons pas loin alors
de ce que les nazis placardaient à l’entrée des camps de concentration : « le travail rend
libre ». Et ce paradoxe là souligne aussi tout le paradoxe renfermé par la notion de dignité.
Au total la dignité, selon cette conception, ne va pas de soi, elle n’est pas identique
pour tous, puisque chacun se la construit ; ou peut se la détruire. Il en résulte, dans cette
conception, qu’il y a des hommes moins dignes, voire qui peuvent être indignes : l’oisif, celui
qui ne fait pas fructifier son talent, celui ou celle qui est jouisseur, qui ne pense qu’au plaisir,
et d’abord au plaisir charnel, le libertin, mais peut être aussi le libertaire, dont on peut penser
qu’ils sont hommes indignes et indignés.

Il existe aussi une conception chrétienne (ou monothéÏste) de la dignité. Cette
conception chrétienne de la dignité va se trouver posée de manière exemplaire, presque
caricaturale, par la contreverse de Valladolid, où le dominicain Bartholoméo de La Casas, va
soutenir, contre l’avis dominant de l’époque, église et université confondues, mais elles le
sont alors, donc contre l’intelligentsia de l’époque, que les indigènes d’Amérique centrale et
du sud, les indiens, disposent d’une dignité, donc d’une âme, donc qu’ils sont par conséquent
des hommes, puisque conçus à l’image et à la ressemblance de Dieu. De fait, la conception
chrétienne, à la différence de la conception bourgeoise, universalise le concept de dignité.
Mais dans cette conception la dignité reste affectée par le péché, qu’il soit originel ou véniel.
D’où l’idée que la dignité n’est pas en soi, par définition, quoiqu’il arrive. Elle peut
disparaître, par la chute, et doit donc être rachetée par le sacrifice et la pénitence. Elle peut
aussi disparaître par degré, du fait de nos fautes, de nos péchés successifs, et doit donc aussi
être rachetée, par la biais du sacrement de confession.
Cette conception, certes universalise l’homme, mais la dignité demeure toujours
contingente, affaire de degrés, de qualités, qui apparaissent et disparaissent, en fonction de
nos péchés, donc de nos conduites, ce qui n’est pas bien loin de la conception bourgeoise. Par
ailleurs cette nécessité du rachat sous-tend l’hypothèse d’un prix de la dignité, d’un prix
différentiel en fonction des qualités en jeu, alors même que l’essence de l’homme est d’être
sans prix..
D’autre part cette conception est doloriste, car c’est la souffrance, la douleur,
l’humiliation, la mortification, l’expiation, la mort, qui réintroduisent la dignité, puisque Le
christ s’est immolé pour le rachat de l’humanité. Il faut donc que l’homme, pour être
totalement à l’image et à la ressemblance de Dieu se sacrifie lui aussi comme étant pour
retrouver son être, ce qui demeure assez contradictoire. C’est en tout cas une conception de
l’universalité qui s’inscrit sur le pathos. C’est donc un universalisme conservateur, voire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%