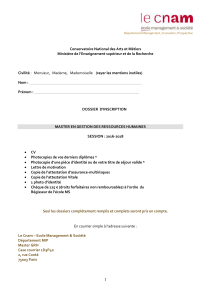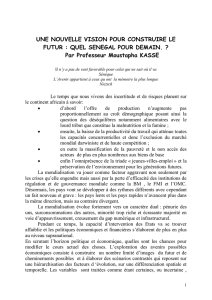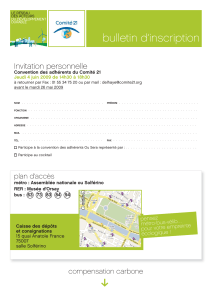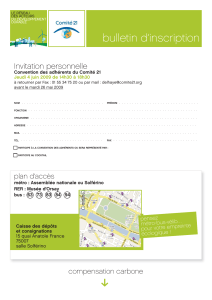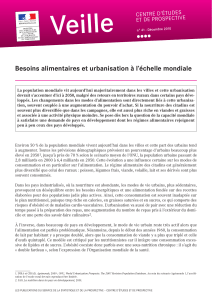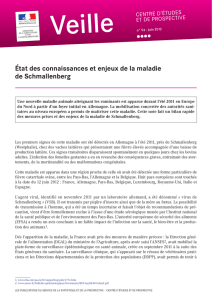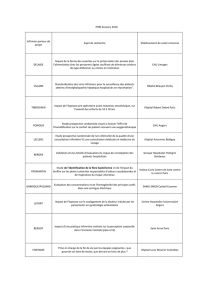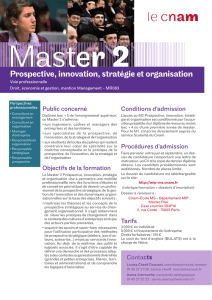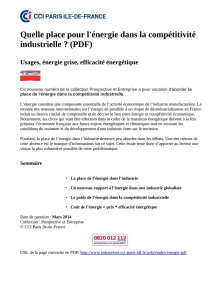Dossier Introduction à la démarche prospective

12 La lettre de l'I-tésé - Numéro 22 - Eté 2014
Dossier
Introduction à la démarche prospective
par Hugues de JOUVENEL,
Président, Futuribles International
Consultant en prospective et stratégie
Hughes de Jouvenel, l’un des grands noms de la prospective en France, Président de
Futuribles International, nous a fait l’honneur d’introduire l’auditoire de la journée à la
démarche prospective. Nous reproduisons ci-après le texte qu’il a eu l’amabilité de nous
envoyer à l’issue de son intervention.
Je remercie les organisateurs de cette 6ème journée I-tésé
de m’avoir offert la possibilité de rappeler, en
introduction à cette rencontre sur «la prospective
énergétique», ce que recouvre de terme de «prospective».
Cela m’apparaît, en effet, particulièrement important dès
lors que le terme est à la mode et qu’il recouvre désormais
des pratiques bien différentes.
Je commencerai par quelques mots sur la philosophie de
la prospective qui est, à mes yeux, bien plus importante
que les méthodes même si celles-ci méritent d’être
connues pour en bien discerner les vertus et les limites.
J’essaierai ensuite de montrer pour quoi l’exploration des
futurs possibles – ou la prévoyance – est essentielle pour
tous ceux, chacun à leur échelle et avec leurs moyens, qui
entendent d’une certaine manière être les artisans d’un
futur plus ou moins choisi, donc agir en stratège.
La philosophie de la prospective
La prospective, au sens moderne du terme, s’est
développée d’abord aux Etats-Unis durant l’entre-deux
guerres sous l’impulsion du Président Roosevelt et, plus
nettement encore, après la seconde Guerre Mondiale, à
partir de préoccupations de nature essentiellement
géostratégique (le «Manhattan project», la guerre du
Vietnam, puis la «Guerre froide»), une attention
particulière étant alors attachée aux nouvelles
technologies, notamment la bombe atomique. Elle s’est
développée un peu plus tard en Europe plutôt sous
l’impulsion de «philosophes sociaux» tels que, en France,
Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel et Pierre Massé.
Cette prospective moderne est essentiellement fondée sur
deux éléments majeurs. D’abord une véritable révolution
culturelle que je situerai au XVIIIe siècle marquée par le
passage des philosophies d’inspiration traditionnaliste
vers des philosophies dites individualistes. Les premières
se caractérisent par la croyance que la marche du monde
est dictée par un ordre supérieur (appelé Dieu ou la
Bonne Nature) et que le défi pour nous est d’essayer de
nous conformer aux préceptes de bonne conduite que
nous impose cet ordre supérieur. La révolution
individualiste (à ne pas confondre avec l’égoïsme) se
traduit par la volonté des hommes et des groupes
sociaux, sans nécessairement renier l’existence d’un ordre
supérieur de nature spirituel ou religieux, de disposer
d’une certaine liberté leur permettant de faire des choix
en fonction de leurs propres valeurs et convictions et
d’engager des actions qui, elles mêmes, vont avoir un
impact sur le « système ». Tout cela est très bien résumé
dans l’ouvrage majeur de Michel Crozier «L’acteur et le
système».
Le deuxième élément repose sur une comparaison certes
un peu simpliste entre la nature du passé et celle du futur
que l’on peut résumer en disant que le passé est le
domaine des faits accomplis tandis que l’avenir est non-
fait, qu’il reste donc à inventer et à construire. Ainsi le
passé serait-il connaissable, ce qui n’empêche pas qu’il
donne lieu à d’âpres controverses entre historiens dont
les analyses sont différentes.
En revanche, l’avenir, dès lors qu’il n’est pas pré-
déterminé échapperait par nature, et quelque soient les
méthodes employées, à la connaissance. Nous disons
qu’il est ouvert à plusieurs futurs possibles. Je dis que
cette opposition est simpliste car le présent n’est qu’un
instant furtif entre le passé dont nous ne saurions
gommer l’héritage (voir l’influence des voies Romaines
sur le tracé de nos infrastructures de transport) et des

13
Eté 2014 - Numéro 22- La lettre de l'I-tésé
Dossier
futurs plus moins enracinés dans le présent et, parfois,
dans un passé assez reculé (ainsi du déclin de la fécondité
et des gains de l’espérance de vie observées dans le passé
qui déterminent pour une part l’évolution à venir de
notre pyramide des âges).
Cette philosophie se résume souvent par cette phrase :
l’avenir ne se prévoit pas ; il se construit. Il se construit
notamment, à partir de décisions et d’actions humaines,
individuelles et collectives, engagées plus ou moins
librement sous réserve que l’on fasse preuve de la
prévoyance sans laquelle nous serions en permanence
exclusivement acculés à gérer les urgences.
L’exploration des futurs possibles
La prospective nous invite à considérer l’avenir à la fois
comme un territoire à explorer et comme un territoire à
construire. Je l’illustrerai à l’aide d’une métaphore, certes
simplificatrice mais, à mes yeux, assez parlante. Nous
sommes tous, en quelque sorte, comme individus et
comme responsables d’organisations, dans une position
semblable à celle du capitaine d’un bateau qui
normalement dispose à bord de deux instruments – la
vigie et le gouvernail – dont les fonctions sont distinctes
mais complémentaires.
Le rôle de l
la
av
vi
ig
gi
ie
e est d’essayer de déceler le vent qui se
lève, l’iceberg avant que le Titanic ne le percute et, plus le
navire est lent à virer de bord, plus la vigie doit avoir la
vue perçante (incidemment, elle doit aussi pouvoir alerter
le capitaine sur les dysfonctionnements internes au
bateau). Je veux ici parler de ce que nous appelons à
Futuribles la veille prospective sur l’environnement
stratégique des organisations telle que nous l’avons
développée d’ailleurs sous le terme de «vigie».
Le défi en l’espèce est d’essayer de nous représenter le
présent au travers de sa dynamique à long terme, donc de
distinguer les faits de nature conjoncturelle, voire
anecdotique, qui feront sans doute la une des média, des
faits qui nous semblent – sans que l’on dispose de
méthodes miracles pour y parvenir – symptomatiques,
révélateurs de tendances lourdes ou émergentes, ceux que
Pierre Massé appelaient «les faits porteurs d’avenir» et
que l’on dénomme plus souvent aujourd’hui sous le
terme de «signaux faibles».
Se représenter correctement le présent au travers de
l’ensemble de ses dimensions, donc en recourant à
l’analyse systémique, est un premier défi car cela
implique de pouvoir mobiliser l’expertise de personnes
fort différentes qui, en se spécialisant ont souvent perdu
en largueur de vue ce qu’elles ont gagné en profondeur
d’analyse. Se représenter le présent dans sa dynamique
temporelle longue exige au demeurant que l’on ne se
trompe pas trop sur les facteurs d’inertie et de
changement. Or j’estime, par exemple, que trop souvent,
au prétexte que les phénomènes démographiques sont
empreints d’une grande inertie, l’on accorde une
confiance excessive à la seule variante médiane des
projections en oubliant que celles-ci sont surdéterminées
par le choix d’hypothèses discutables sur la fécondité,
l’espérance de vie et le solde migratoire. Inversement,
étant fascinés par la rapidité des progrès scientifiques et
techniques, l’on est trop souvent enclins à penser que la
société va changer au rythme de ces progrès. Or la
disponibilité d’une technologie est une chose, les
conditions de sa diffusion dans le corps social en est une
autre, et les usages qui en seront faits, une troisième qui
dépend de facteurs économiques, sociaux, politiques et
culturels.
Enfin, il faut prendre garde au fait que l’on est trop
souvent tenté de ne tenir compte que des phénomènes
mesurables alors que les chiffres dont nous disposons ne
sont pas nécessairement exacts et pertinents,
qu’inversement l’on a souvent tendance à sous-estimer
les variables dites molles au prétexte qu’il est plus difficile
de les appréhender. Mais les variables molles (par
exemple, le portefeuille de compétence d’une
organisation, la capacité des dirigeants à mobiliser les
talents) sont souvent très déterminantes au regard des
performances des entreprises .
La vigie, pour le dire autrement, doit déceler ce que le
présent recèle comme germes d’avenir ou comme racines
de futurs possibles. A partir de là, il nous incombe
d
d’
’e
ex
xp
pl
lo
or
re
er
rc
ce
eq
qu
ui
ip
pe
eu
ut
ta
ad
dv
ve
en
ni
ir
r. Telle est l’ambition de la
p
pr
ro
os
sp
pe
ec
ct
ti
iv
ve
ed
di
it
te
e«
«e
ex
xp
pl
lo
or
ra
at
to
oi
ir
re
e»
» qui recourt à des
méthodes différentes de celles utilisées dans les
prévisions.
L
La
ap
pr
ré
év
vi
is
si
io
on
n repose essentiellement sur l’extrapolation
des tendances observées dans le passé. Elle suppose que
demain diffèrera d’aujourd’hui comme aujourd’hui
diffère d’hier. La méthode la plus couramment utilisée
consiste à examiner comment un sous-système, isolé de
son contexte, a fonctionné dans le passé, quelles sont les
variables et les relations entre ces variables qui ont été
déterminantes dans son évolution. Sur cette base sont
construits des modèles de simulation qui permettent
d’élaborer des prévisions.
Mais cette méthode – dont les vertus sont incontestables
dans certains cas - et les prévisions ainsi établies sont
sujettes à trois limites : la première tient au fait que l’on
raisonne comme si la dynamique du sous-système était
pérenne, qu’il n’y avait pas, par exemple, d’effets de seuil
au-delà desquelles le système, morphologiquement et
physiologiquement, se trouverait modifié. La seconde
tient à l’hypothèse, résumée par l’expression «toutes
choses égales par ailleurs», selon laquelle on fait
abstraction de facteurs exogènes qui viendraient modifier
radicalement le sous-système. La troisième tient à l’effet
dit «GIGO» (Garbage in/ Garbage out) voulant dire, en

14 La lettre de l'I-tésé - Numéro 22 - Eté 2014
Dossier
substance que si les hypothèses d’entrée sont arbitraires,
voire erronées, les prévisions à la sortie le seront tout
autant.
L
La
ap
pr
ro
os
sp
pe
ec
ct
ti
iv
ve
ee
ex
xp
pl
lo
or
ra
at
to
oi
ir
re
e entend appréhender le
système dans sa globalité et débroussailler les futurs
possibles à gros trait plutôt que de produire des
prévisions précises (nous dirons que le parti pris est de
préférer une approximation grossièrement correcte à une
prévision précise mais erronée). Elle s’efforcera, en
particulier, de tenir compte des éventuelles discontinuités
et ruptures – celles-ci pouvant être subites ou provoquées
et résulter de très nombreux facteurs et acteurs – et de la
stratégie des acteurs dont le comportement n’est pas ni
répétitif ni rationnel.
Chacune de ces démarches comporte des vertus et des
limites et, fort opportunément, il est de plus en fréquent
de les utiliser complémentairement. Aucune des deux n’a
la vocation et la prétention de prédire le futur. Dans le
meilleur des cas, elles vont nous permettre d’identifier les
enjeux à moyen et long termes avant que l’incendie ne
soit déclaré et que nous soyons réduits à agir en
pompiers, les circonstances prenant le dessus sur notre
volonté.
La construction de l’avenir
Pour autant donc que nous ayons fait preuve de vigilance
et d’anticipation, nous allons disposer d’un certain
pouvoir pour devenir d
de
es
sa
ac
ct
te
eu
ur
rs
sd
d’
’u
un
nf
fu
ut
tu
ur
r pour une
part au moins choisi. Mais qui est ce «nous» ? Il y a sur la
scène une pluralité d’acteurs, plus ou moins puissants,
poursuivant des objectifs plus ou moins conflictuels ou
consensuels, individuels et collectifs. L’identification des
acteurs et une juste estimation de leurs pouvoirs
respectifs sont ici essentielles, y compris bien entendu de
savoir au profit duquel nous œuvrons.
Et quelle est la représentation que l’acteur en question se
forge d’un avenir souhaitable et réalisable, sachant que,
s’il s’agit d’un acteur opérant au nom de l’intérêt collectif,
il ne s’agit pas de considérer que l’intérêt collectif n’est
rien d’autre que la somme des intérêts individuels, a
fortiori d’une opinion publique que l’on sait fugace,
volatile et souvent surdéterminée par la conjoncture du
moment. Cela, en d’autres termes, signifie que les
prospectivistes vont explorer différentes options, leurs
conditions de mise en œuvre, procéder à une évaluation
ex ante des coûts et bénéfices de chacune d’elles mais qu’il
incombera au décideur de prendre ses responsabilités au
moment d’opérer des choix qui engage la société à long
terme.
Ici intervient donc la notion de projet (venant du latin
pro-jeter,) jeter dans un avenir plus ou moins lointain une
image d’un avenir souhaitable, donc exigeant un choix en
terme de valeur, et réalisable.
S’il est important d’être animé d’un tel projet qui confère
un sens et une cohérence à long terme à nos actions, il est
également important de s’efforcer de le réaliser, d‘où la
nécessité d’établir un compte à rebours (backcasting)
pour savoir qui peut faire quoi et comment dès demain et
les jours suivants pour atteindre l’objectif. L’on pourra
alors parler de plan, de programmation, d’allocation de
moyens. Mais comme nul ne peut prévoir précisément
comment évoluera la conjoncture, s’il est important de
tenir le cap, il est également important d’être capable
d’ajuster les voiles.
Je terminerai en insistant sur l’importance de bien
apprécier les échelles de temps. La prospective ne
s’intéresse pas qu’au long terme, y compris parce que,
pour y arriver, il faut passer par le court et le moyen
terme. La prospective exploratoire part du présent pour
aller explorer le spectre des possibles ; la prospective que
l’on appelait auparavant normative (et désormais
stratégique) part d’un objectif pour revenir vers le
présent. Il est tout aussi important d’être capable de fixer
des ordres de grandeur. Elaborer des scénarios sans qu’ils
soient assortis de cheminements conduit à de nombreuses
erreurs et n’a guère de vertu opérationnelle. Or la
prospective doit pouvoir être utile à l’exercice du
pouvoir, donc à la décision et à l’action.
1
/
3
100%