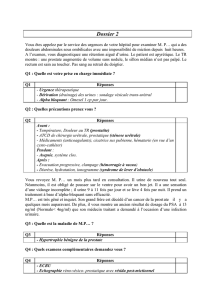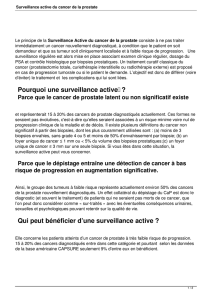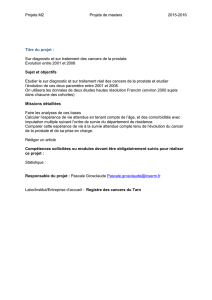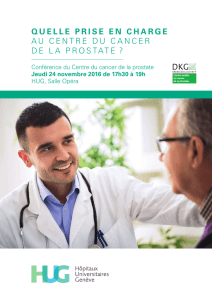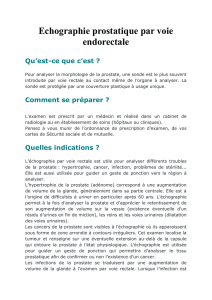Télécharger cette fiche au format PDF

L'imagerie de contraste de la prostate repose sur l’étude de la cinétique
d'un produit de contraste injecté par voie intraveineuse qui est diffé-
rente dans le tissu prostatique normal ou hyperplasique et dans le tissu
tumoral. Elle est complémentaire de la spectroscopie et s’intègre dans
le cadre d’une imagerie fonctionnelle de la prostate. Son objectif est
d’améliorer la fiabilité de l’imagerie en coupes disponible actuelle-
ment pour détecter le cancer. L’échographie et l’écho-Doppler couleur
ont en effet une sensibilité et une spécificité limitées dans la détection
du cancer [1] et l’IRM, plus sensible, est cependant peu spécifique [2]
pour deux raisons désormais bien connues : la fréquence des anoma-
lies hypoéchogènes ou des hyposignaux bénins et l’existence des can-
cers isoéchogènes ou isointenses. On attend de l’imagerie de contras-
te, en particulier de l’IRM, de localiser un cancer de prostate non dia-
gnostiqué par une ou plusieurs séries de biopsies [3], et, en ce qui
concerne l’échographie, de mieux guider les biopsies de prostate pour
augmenter leur rendement à l’occasion de la première série [4, 5]. La
tomodensitométrie, par l'absence suffisante de résolution en contraste
ne permet en revanche qu'une approche limitée de la cinétique du
contraste iodé [6], même avec la technique hélicoidale multibarrettes
et l'utilisation de modèles pharmacocinétiques [7].
IRM PROSTATIQUE AVEC INJECTION DE GADOLINIUM
(IRM DYNAMIQUE)
L’IRM de la prostate repose actuellement sur des séquences en écho de
spin rapide pondérées en T2, à la fois pour localiser le cancer dans la
prostate et pour effectuer le bilan d’extension. La sensibilité de l’ima-
gerie T2 est élevée pour détecter le cancer, mais sa spécificité ne dépas-
se pas 40% [8]. Le but de l'injection de Gadolinium est de d’augmen-
ter la spécificité des hyposignaux bénins et/ou de détecter des anoma-
lies de la cinétique du contraste en faveur d’une tumeur. La base
physiopathologique est la détection de l'angiogénèse intratumorale et
de la différencier de celle du tissu normal ou hyperplasique [9].
Technique de l’IRM dynamique.
-Il faut étudier la cinétique précoce du produit de contraste dans la
tumeur. La cadence des images (résolution temporelle) doit donc
être élevée, avec des paramètres qui permettent l’acquisition de
chaque image en un laps de temps très court. L’injection doit être
réalisée en bolus [10] avec un débit de 2,5ml/s. Les acquisitions
sont enchaînées après l’administration du gadolinium sur une
durée totale de 2 à 3 mn. Ces séquences sont regroupées sous le
terme générique d'écho de gradient. Elles se font toujours au détri-
ment de la résolution spatiale.
-Les deux paramètres les plus importants étudiés après l'injection
du Gadolinium sont la valeur maximale du pic de rehaussement et
l'aspect de la courbe de lavage du produit de contraste. Le résultat
est présenté en forme de courbes en fonction du temps (Figure 1).
Cette mesure semi-quantitative peut être affinée par l'utilisation
d'un modèle mathématique (pharmaco-cinétique) [11, 12] qui per-
met de doser la concentration du Gadolinium dans les tissus. La
méthode devient quantitative mais nécessite des logiciels de labo-
ratoire de recherche non disponibles dans le commerce [13].
Applications cliniques
L'IRM dynamique de la prostate avec séquences en écho de gra-
dient cherche à localiser le cancer et éventuellement à déterminer
son étendue à l'intérieur de la prostate, sans apprécier de façon pré-
cise le volume tumoral [13]. L'indication princeps est la mise en
◆
ARTICLE DE REVUE Progrès en Urologie (2006), 16, 275-280
Place de l’imagerie de contraste dans la détection du cancer de prostate
François CORNUD (1),Xavier REBILLARD (2),Arnauld VILLERS (3),Michaël PEYROMAURE (4),Michel SOULIÉ (5),
(1) Service de Radiologie, Paris, France, (2) Clinique Beausoleil, Montpellier, France, (3) Service d’Urologie, Hôpital Huriez, Lille, France,
(4) Service d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris, France, (5) Service de Chirurgie Urologie, Hôpital de Rangueil, Toulouse, France
RESUME
L’imagerie de contraste de la prostate repose sur l’IRM avec séquences rapide après injection dynamique de
Gadolinium et l’échographie de contraste après injection de microbulles. L’IRM est réalisable en routine sur tous
les appareils disponibles. L’échographie de contraste nécessite un logiciel d’échographie spécifique non encore
disponible sur la totalité des équipements. Les deux techniques ont pour but d’améliorer la fiabilité de l’image-
rie, en complément de la spectroscopie, pour localiser le cancer de prostate. L’IRM peut détecter un rehausse-
ment suspect dans la zone périphérique mais surtout dans la zone de transition après une ou série de biopsies
postérieures négatives pour cibler la nouvelle série de prélèvements. La sensibilité et la spécificité de la technique
sont à préciser. L’objectif de l’échographie de contraste est d’améliorer la détection du cancer à l’occasion de la
première série de prélèvements en multipliant les prélèvements dans les sextants ou la cinétique du contraste
évoque une lésion primitive. Cependant son application ne peut encore être recommandée, car les modalités d’in-
jection des microbulles de dernière génération (bolus ou perfusion) ont besoin d’être évaluées.
Mots clés : Cancer de prostate, détection, IRM, échographie, produit de contraste.
275
Travail du Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie
Manuscrit reçu : février 2006, accepté : avril 2006
Adresse pour correspondance : Dr. F. Cornud, Service de Radiologie, 19, avenue de Tour-
ville, 75007 Paris
e-mail : [email protected]
Ref : CORNUD F., REBILLARD X., VILLERS A., PEYROMAURE M., SOULIÉ M.
Prog. Urol., 2006, 16, 275-280

évidence d'un rehaussement suspect de cancer en cas de PSA élevé
(en règle >10 ng/ml) après une série de biopsies négatives avec
protocole étendu à 10 ou 12 biopsies postérieures. L'IRM dyna-
mique est souhaitable dès que des biopsies dans la zone de transi-
tion sont envisagées, et d'autant plus préconisée que le poids pro-
statique est élevé. Cependant les niveaux de preuve suffisants n’ont
pas encore été atteints pour la recommander en routine car le taux
de biopsies positives sur une cible détectée par IRM dynamique
n’est pas encore connu. L’IRM dynamique concurrence directement
dans cette indication la spectroscopie [14] et a l’immense avantage
d’être beaucoup moins consommatrice de temps (séquence de 3 mn
pour environ 15mn en spectroscopie).
-La série de PADHANI [9] comporte 48 patients avec cancer de pro-
state diagnostiqué par biopsies écho-guidées (36 patients) ou
résection trans-urétrale (12 patients). Aucun patient n'a été traité
par prostatectomie totale. Le paramètre le plus important est dans
cette étude le lavage (wash out) du contraste après le pic de
rehaussement maximal. Le lavage a été considéré comme bénin en
cas d'accroissement régulier du signal dans la région testée (Figu-
res 1 et 2), suspect en cas de plateau après le pic maximum du
rehaussement ou en cas de décroissance tardive, tumoral en cas de
décroissance rapide après le pic maximum de contraste (Figures 1
et 2). L'étude comportait une modélisation quantitative des para-
mètres pour le calcul de la concentration du gadolinium dans les
tissus. Il y avait en revanche un chevauchement complet des para-
mètres entre l'HBP et le cancer,limitant donc fortement, dans
cette étude, la détection des cancers de la zone de transition réali-
sée avec une résolution temporelle d'une image toutes les 11 s. La
limite d'une résolution temporelle > 5s est également soulignée
dans l'étude de ROUVIÈRE [3].
-L’étude de TURNBULL [15] porte sur 12 patients atteints de cancer
de prostate cliniquement localisé et candidats à la prostatectomie
radicale. Le PSA moyen était de 9,5ng/ml (extrêmes : 4,7-15,8).
L'étude dynamique comportait une analyse quantitative des para-
mètres de la cinétique du contraste effectuée à partir d’un logiciel
de modélisation développé à la Mayo Clinic. Il existe une diffé-
rence de cinétique du contraste entre la zone périphérique norma-
le et le cancer postérieur. En ce qui concerne la zone de transition,
le pic du rehaussement d'un cancer antérieur est plus élevé que
celui de l'HBP stromale (en hyposignal sur les séquences en T2)
mais pas différent de celui de l'HBP glandulaire (en hypersignal
hétérogène sur l’imagerie T2). De plus la pente de lavage du
contraste n'était pas discriminative.
-L'une des études les plus récentes semble pourtant s'affranchir de
la limite posée par la zone de transition [13]. Il s'agit d'une série
de 36 patients traités par prostatectomie radicale. Le PSA moyen
était de 10,6 ng/ml (extrêmes : 4,5-38). La corrélation avec l'étu-
de dynamique se faisait à partir de coupes histologiques de pro-
state entière. Seules les tumeurs de plus de 0,5 cc étaient retenues.
Chez les 36 patients étudiés, 55 tumeurs ont été corrélées, 32 can-
cers dans la zone périphérique et 23 dans la zone de transition. La
résolution temporelle était d’une acquisition toutes les deux
secondes. En cas de cancer de la zone périphérique. Le paramètre
le plus prédictif est l'intensité du pic de rehaussement (Figure 2).
Cette information est utile pour caractériser un hyposignal non
palpable dans la zone périphérique. Sur les 32 cancers périphé-
F. Cornud et coll.Progrès en Urologie (2006), 16, 275-280
276
Figure 1. Cinétique du produit de contraste en cas de cancer palpable
de la zone périphérique. Patient de 59 ans. Nodule palpable à l'apex
droit. PSA 6,3ng/ml. (A-B) : Hyposignal dans l'apex droit (flèche) sur
la séquence pondérée en T2. (C) : rehaussement manifeste du nodule
après contraste (flèche). (D) : Cinétique du contraste typique de can-
cer (tracé rouge) et zone périphérique normale (tracé jaune).
Figure2. Cancer antérieur de volume modéré. Homme de 69 ans.
Prostate souple au toucher rectal. PSA 12ng/ml. Deux séries de biop-
sies postérieures négatives. (A-B) : Hyposignal oblong juste derrière
le stroma fibro-musculaire antérieur (*). (B-C) : Rehaussement mas-
sif de l’hyposignal (flèches, D) évoquant une lésion antérieure. (E-F):
courbes dynamiques. Rehaussement précoce de la zone suspecte avec
lavage du produit de contraste (courbe bleue) confirmant de façon
plus spécifique la présence du cancer antérieur (score de Gleason 7)
diagnostiqué par une résection trans-urétrale a minima.

riques, 31 avaient un pic plus élevé que celui de la zone périphé-
rique saine. Il existe un taux de faux positifs incompressible lié au
rehaussement de certains hyposignaux bénins visibles sur la
séquence pondérée en T2. En cas de cancer de la zone de transi-
tion, le paramètre le plus prédictif est la pente de lavage du
contraste, observée dans 16 des 23 tumeurs (Figure 3). On peut
comprendre, compte-tenu de l’hypervascularisation physiologique
del’HBP, qu'un pic élevé dans l'hyperplasie manque de spécifici-
té. Associé à un lavage du contraste, la spécificité augmente sub-
stantiellement. Le taux des faux positifs du lavage ne sont pas
connus, par manque de données sur la cinétique du contraste chez
des patients sans cancer.
-L'étude récente de BUCKLEY [12] fait appel à un modèle pharma-
co-cinétique qui étudie d’autres paramètres qui sont la concentra-
tion du produit de contraste dans les secteurs vasculaire, cellulai-
re et extracellulaire (interstitium). Le travail porte sur 22 patients,
stade T3 pour 14 d'entre eux et stade T1c ou T2 pour les 8 autres.
La corrélation s'est faite avec les biopsies. La résolution tempo-
relle de la séquence dynamique est élevée (une image toutes les
2,3 s). Les valeurs calculées sont très significativement plus éle-
vés dans le cancer que dans le tissu sain de la zone périphérique.
-Conclusion-Perspectives. En routine clinique, l'IRM dynamique
de la prostate n'est actuellement réalisée en France que de façon
semi-quantitative sans modèle mathématique pour le calcul quan-
titatif de la concentration de Gadolinium dans les tissus. Une réso-
lution temporelle raisonnablement élevée comme celle que nous
utilisons (une image toutes les 10s) procure une bonne résolution
spatiale et permet l'étude des deux paramètres utiles (pic de
rehaussement et lavage du produit de contraste) pour les deux
zones prostatiques. On peut espérer un gain de spécificité si un
modèle mathématique simple permettant d’estimer la concentra-
tion de Gadolinium dans les tissus perfusés devient disponible sur
les machines d’IRM actuellement utilisées.
Echographie de contraste de la prostate. Applications cliniques
au cancer de la prostate
La finalité de la recherche développée autour des produits de
contraste ultrasonores (PCUS) et appliquée à l’étude de la prostate
est d’augmenter la sensibilité et la spécificité de l'échographie pour
la détection du cancer prostatique. Les objectifs sont d'augmenter la
spécificité des nodules hypoéchogènes et d'essayer de déceler la
présence de cancers isoéchogènes postérieurs ou antérieurs. La base
physiopathologique est, comme pour l’IRM, l’étude de la micro-
vascularisation spécifique du cancer. Cependant les microbulles se
limitent à l’étude du secteur vasculaire, car elles ne diffusent pas
dans l’interstitium, comme le fait le Gadolinium.
Les résultats des études réalisées après perfusion intraveineuse à
débit lent (environ 2ml/mn) des microbulles (volume 10 ml) avec
les agents de contraste de première génération (microbulles conte-
nant de l’air) ne sont pas tous convaincants.
-Une des études réalisées [16] porte sur 85 patients très vraisem-
blablement sélectionnés, car la majorité d’entre eux (73/85, 86%)
ont un toucher rectal suspect, expliquant la prévalence élevée du
cancer dans la série (54/85, 64%). Les résultats du Doppler cou-
leur avant injection de produit de contraste ne sont pas typiques,
puisque la moitié seulement des cancers palpables hypoéchogènes
sont hypervasculaires, pour un taux habituel de 85% dans la litté-
rature [1, 17] Les auteurs montrent donc sans difficulté que les
microbulles rehaussent la vascularisation des cancers palpables,
mais il n’est pas possible de tirer de conclusion sur son utilisation
pour un diagnostic précoce chez des patients sans anomalie pal-
pable et avec une prévalence du cancer qui est celle observée en
cas d’augmentation du taux de PSA.
-Une autre étude [4] utilisant le même protocole de perfusion, rap-
porte les résultats d’un programme de dépistage du cancer de pro-
state basé sur un taux de PSA>1,25 ng/ml ou un taux de fraction
libre <18% sans tenir compte du toucher rectal chez 230 patients
volontaires. Un premier opérateur réalisait des biopsies guidées
uniquement par les zones rehaussées en limitant le nombre de pré-
lèvements à 5 dans le ou les sextants anormaux. Le deuxième opé-
rateur réalisait avec un autre appareil d’échographie une série de
biopsies avec un protocole à 10 biopsies avec, par lobe, 4 biopsies
postérieures (apex : 2, partie moyenne : 1 base : 1) et 1 biopsie
antérieure. Un cancer a été détecté chez 69 patients (69/230, 30%)
avec un taux de PSA moyen de 4,6ng/ml. Les biopsies dirigées par
échographie de contraste ont détecté 56 cancers (24,4%) et les
biopsies systématisées 52 (22,6%). La sensibilité de détection des
cancers par les biopsies dirigées était de 81% et de 72% pour les
biopsies systématisées. La différence devient significative, en
faveur des biopsies dirigées si l’on ne tient compte que des can-
cers postérieurs détectés (exclusion de quatre cancers antérieurs
diagnostiqués par les biopsies systématisées). Les auteurs font
F. Cornud et coll.Progrès en Urologie (2006), 16, 275-280
277
Figure3. Cancer palpable apical droit (stade T2a). Patient de 58 ans.
PSA à 5 ng/ml. Score 6 de Gleason. Coupe sagittale. (A) : avant
contraste, on distingue la zone périphérique, le nodule et la zone de
transition. (B) : rehaussement intense du nodule (flèche) plus marqué
que celui de la zone de transition (ZT). La zone périphérique (ZP) ne
se rehausse pas. (C) : lavage précoce du produit dans la tumeur (flè-
che), 15s après injection du contraste. Les bulles sont encore large-
ment détectables dans la zone de transition (ZT).

valoir que le taux de détection du cancer dans un sextant tumoral
est multiplié par 2,6 quand plusieurs prélèvements sont réalisés
dans le sextant ciblé, ce que seul le produit de contraste permet de
faire. Ils montrent par ailleurs que le score de Gleason des cancers
détectés par les biopsies dirigées dans les sextants hypervasculai-
res est significativement plus élevé que celui des cancers détectés
par les biopsies systématisés, ajoutant donc une valeur pronos-
tique à la valeur diagnostique de l’examen.
-Au moins deux autres études [16, 17] ont également rapporté
l'augmentation significative de la sensibilité dans la détection de
zones suspectes, en utilisant le Levovist en perfusion et le Doppler
couleur ou puissance. Dans l'une d'elles [17], la sensibilité passe
de 38% sans le produit de contraste à 85% avec l'injection en per-
fusion de Levovist. La sensibilité devient même supérieure à celle
de l'échographie en mode B, car en l'absence de nodule hypo-
échogène, un rehaussement focal a pu être détecté, correspondant
àla moitié des cas à un cancer. La spécificité n'est pas affectée par
le produit de contraste et se maintient à 80% avant comme après
contraste.
L’utilisation de microbulles de deuxième génération est venue
confirmer la sensibilité supérieure de l’échographie de contraste
par rapport aux modes B et couleur pour détecter le cancer de
prostate.
-Une étude porte sur 60 patients [18] sans anomalie palpable pour
la majorité d’entre eux, chez qui 37 sextants tumoraux ont été
détectés chez 20 patients. Un sextant était considéré comme
suspect sur l’échographie avant contraste s’il était hypoéchogène
et/ou spontanément hypervasculaire en Doppler couleur. Après
contraste, tous les sextants qui se rehaussaient étaient considérés
comme suspects. Six biopsies en sextant étaient réalisées latérale-
ment (en dehors du plan médio-lobaire) dans la ZP en cas d’écho-
graphie négative et des biopsies supplémentaires étaient réalisées
dans tous les sextants suspects après contraste. La sensibilité de
l’échographie avant contraste était de 38% (14/37 sextants tumo-
raux) et celle de l’échographie de contraste de 65% (24/37 sex-
tants tumoraux). Les spécificités respectives étaient de 83%
(267/323 sextants bénins) et de 80% (257/323 sextants bénins).
L’étude spécifie que 10 sextants non suspects avant contraste (c'est
àdire isoéchogènes et hypovasculaires) se rehaussent après
contraste, illustrant la possibilité de détecter des cancers posté-
rieurs stade T1c.
-Ces résultats ont été confirmés par le même groupe sur une série
de 12 pièces de prostatectomie radicale [19]. Trente et un foyers
tumoraux ont été recensés. Pour la zone périphérique, la sensibili-
té de l'échographie de contraste était de 48% (10/21 tumeurs
détectées) contre 24% (5/21 tumeurs détectés) avant contraste.
Pour la zone de transition, seuls trois cancers antérieurs (3/10) ont
été détectés, tous visibles sur l’échographie avant contraste. Le
produit de contraste, injecté en perfusion dans cette étude, entraî-
ne un rehaussement diffus et intense de la zone de transition qui
empêche de déceler un rehaussement tumoral spécifique.
-La plus large étude avec le seul produit disponible en Europe
(Sonovue, Bracco) est autrichienne [5] et a été réalisée par le
même groupe que celui de l’étude de FRAUSCHER [4]. Les 380
patients de cette deuxième étude ont été enrôlés dans le program-
me de dépistage du cancer de prostate dans la région du Tyrol. Les
valeurs du PSA sont comprises entre 4 et 10 ng/ml (moyenne :
6,2). Le toucher rectal ne fait pas partie des critères de sélection.
Le volume prostatique moyen est de 35cc (extrêmes 18-175).
L’âge moyen des patients est de 60,7 ans (extrêmes 41-77). Le
protocole est le même que celui utilisé par FRAUSCHER [4] en rem-
plaçant le Levovist en perfusion par le Sonovue injecté en bolus.
Les biopsies dirigées détectent autant de cancers (27%) que les
biopsies systématiques, mais le taux passe à 37,6% si les deux
techniques sont utilisées. On arrive donc à la notion de complé-
mentarité et pas à la notion de substitution des biopsies systéma-
tiques par les biopsies dirigées par le produit de contraste, comme
l’avaient initialement suggéré les auteurs [4]. Le taux de positivi-
té d’une biopsie dans un sextant qui se rehausse étant trois fois
plus élevé que celui d’une biopsie systématique, les auteurs
recommandent fortement la réalisation de la première série de
biopsies avec ce protocole.
Depuis l’utilisation des microbulles, on assiste à un développe-
ment de logiciels d’échographie qui cherchent à améliorer la fia-
bilité des produits de contraste échographique. Des procédés de
soustraction des tissus pour ne laisser apparents que les vaisseaux
(comme en angiographie conventionnelle) et des séquences d’ima-
gerie dites harmoniques pour la réception du maximum de signal en
provenance des bulles quand elles passent sous le faisceau d’ultra-
sons sont en train d’être mis au point. Notre expérience personnel-
le repose sur une centaine d’échographies avec biopsie réalisées
après injection de Sonovue en utilisation un programme développé
spécifiquement pour l’échographie de contraste (ESAOTE, France).
On attend de ces nouveaux logiciels une sensibilité bien supérieure
àcelle du Doppler-couleur pour la détection d’une microvasculari-
sation tumorale.
-Il existe des contraintes d'utilisation du Sonovue. Les microbulles
forment une émulsion instable. Pour pouvoir l’utiliser en perfu-
sion, il faut disposer d’un injecteur qui agite en permanence l’é-
mulsion pendant la perfusion du produit. Il existe par ailleurs des
contraintes spécifiques à la prostate. La glande est vascularisée
F. Cornud et coll.Progrès en Urologie (2006), 16, 275-280
278
Figure 4. Cancer stade T2 non palpable de la zone périphérique.
Patient de 62 ans. Prostate souple au toucher rectal. PSA : 7,9 ng/ml.
Score 7 de Gleason sur deux sextants gauches (base et partie moyen-
ne). (A) : avant injection, aspect globalement hypoéchogène de la pro-
state. Le nodule (flèche) n'est pratiquement pas visible. (B) : rehaus-
sement synchrone (7s) des macrovaisseaux visibles dans le nodule
(flèche) et dans la zone de transition (tête de flèche). (C) pic du
rehaussement (15s) dans le nodule (flèche) presque identique à celui
des macrovaisseaux de l'HBP (tête de flèche). (D) : lavage précoce du
nodule (flèche), et persistance de plusieurs macro-vaisseaux dans la
zone de transition (têtes de flèche). Rehaussement minime (*C,D) de
la zone périphérique.

par des artères de petit calibre et l'absence de recirculation des
microbulles, à l'inverse du foie, rend préférable l’injection du pro-
duit en bolus pour avoir une bonne qualité de rehaussement, mais
avec un temps d’étude de la cinétique du produit de moins de 30s.
Il n’est pas donc pas possible de balayer toute la prostate, car le
rehaussement à détecter est précoce. Le repérage d’une cible est
nécessaire pour y tester visuellement la cinétique du contraste.
Une fois la cible localisée, le plan de coupe doit être maintenu fixe
pendant le temps de passage du produit.
-Rehaussement d'une prostate normale ou hyperplasique (Figure
4). Les macro-vaisseaux de l'HBP sont opacifiés précocement et
des vaisseaux de plus petit calibre sont opacifiés secondairement.
La vascularisation de la partie antérieure de la zone de transition
est incomparablement mieux appréciée qu'en Doppler puissance
ou couleur. Dans une forme typique, la zone périphérique reste
hypovasculaire.
-Le cancer palpable de la zone périphérique. Le rehaussement des
cancers palpables visibles à l’échographie et de surcroît spontané-
ment hypervasculaires en Doppler est flagrant (Figure 3), ce qui
permet de se faire une idée de la cinétique du rehaussement dans
le cancer de prostate : la tumeur est caractérisée par une apparition
et un lavage précoces du produit, phénomènes qui n'étaient pas
détectables avant l'utilisation des microbulles. L'appréciation de
cette cinétique est visuelle et donc semi-quantitative. La vascula-
risation de la prostate adjacente sert de référence.
-L'application de cette cinétique aux nodules non palpables pour
différencier les nodules malins des nodules bénins est encore à l'é-
tude. La transposition de la cinétique du produit de contraste aux
cancers non palpables est possible (Figure 4) dans certaines obs-
ervations, mais avec une sensibilité et une spécificité qui restent à
définir.
-En l’absence de cible, la mise en évidence d’un rehaussement dans
un sextant postérieur isoéchogène est possible (Figure 5). Cepen-
dant, la brièveté du temps disponible pour l'étude en bolus ne per-
met pas de tester les six sextants. Il faut en effet interrompre le
balayage et maintenir la sonde fixe en choisissant l’apex, la partie
moyenne ou la base. Pour examiner toute la prostate, il faut réin-
jecter du contraste à chaque étage (apex, partie moyenne et base),
ce qui nécessite l'injection de trois ampoules de produit (le flacon
de Sonovue coûte 90 euros). Une autre façon de procéder est de
faire l’injection sur une coupe sagittale passant par la partie laté-
rale de la zone périphérique pour tester la partie externe des trois
sextants en même temps. Une des indications potentielles est
représentée par le microcancer détecté sur une première série de
prélèvements. L’étude de la cinétique du contraste dans le territoi-
re du microfoyer pourrait différencier un cancer latent d'un cancer
significatif et guider au mieux les nouvelles biopsies.
-Cancer de la zone de transition. La localisation des cancers de la
zone de transition est théoriquement un des objectifs de l'injection
de produit de contraste. Cependant, comme l'HBP est caractérisée
par une hypervascularisation quasi-constante, il est très difficile
d'y déceler une hypervascularisation tumorale. Dans des indica-
tions sélectionnées, on peut étudier le paramètre qui évoque le
plus le cancer représenté par le lavage précoce des microbulles
d'une zone hypervasculaire. En cas de bénignité, on n'observe pas
de lavage précoce. En cas de cancer, le lavage du contraste dans la
tumeur est plus précoce que dans l'HBP adjacente. Les limites de
la technique sont encore plus flagrantes que pour la zone périphé-
rique : il faut une cible, très difficile à localiser dans la zone de
transition, pour étudier la cinétique du contraste.
Quelles sont les conclusions que l’on peut tirer pour l’instant du
rôle de l’échographie de contraste dans le guidage des biopsies de
prostate ?
-Il n’est pas encore possible de se prononcer sur la fiabilité de l’in-
jection de contraste pour détecter les véritables cancers stade T1c
(sans nodule visible) de la zone périphérique. Cette donnée n’ap-
paraît pas dans les deux articles du groupe d’Innsbruck [4, 5]. Une
telle information chiffrée constituerait la seule vraie justification
àmultiplier le nombre de prélèvements dans un sextant suspect,
car la présence d’un nodule hypoéchogène est déjà une indication,
sans utiliser de technique échographique complémentaire, à réali-
ser de un à trois prélèvements supplémentaires dans le sextant ou
se trouve le nodule. Cette façon de procéder a montré que 15% de
cancers supplémentaires peuvent être détectés par ces biopsies
dirigées [20].
-La localisation tumorale ne peut-être améliorée que par l'utilisa-
tion des microbulles de deuxième génération en perfusion pour
étudier la totalité de la prostate. Si l'injection de produit de
F. Cornud et coll.Progrès en Urologie (2006), 16, 275-280
279
Figure 5a : Cancer isoéchogène du sextant moyen droit. Echo-Dop-
pler puissance. Bande hypoéchogène latérale sous capsulaire attri-
buée à un volumineux vaisseau sous capsulaire (têtes de flèche). La
zone périphérique a une échostructure normale.
Figure 5b : Cancer isoéchogène du sextant moyen droit. Injection de
contraste. (A-D) : rehaussement de tout le sextant (flèche), dépassant
largement le territoire du vaisseau sous capsulaire. Toutes les biopsies
passant par le sextant étaient positives (score 6 de Gleason).
 6
6
1
/
6
100%