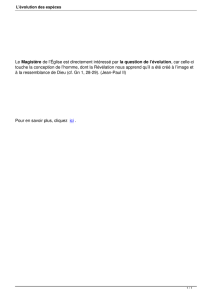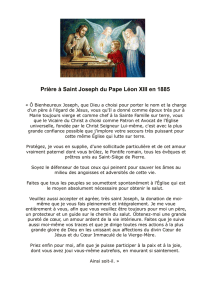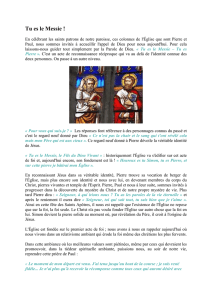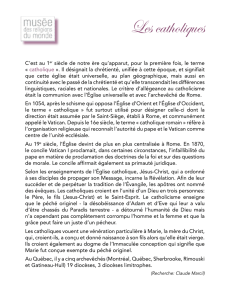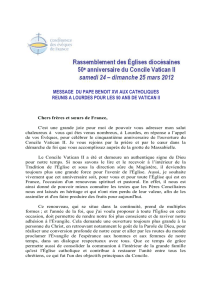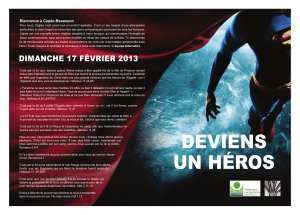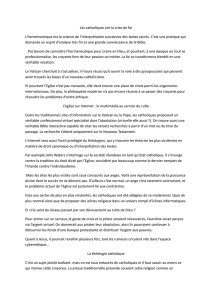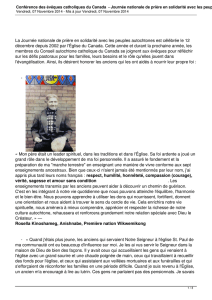MARIE

MARIE
Je voudrais reprendre en commençant les questions posées sur l’invitation. La place donnée
à Marie dans nos Églises serait-elle un obstacle ou au contraire une stimulation pour l’unité des
chrétiens à Lyon ? En posant cette alternative, nous raisonnons en bons occidentaux, habitués aux
relations entre catholiques et protestants. Il y a quelques semaines, j’ai participé à une rencontre
interconfessionnelle à Damas, un chrétien syriaque orthodoxe de Jérusalem est venu avec des
cadeaux pour chacun des participants, il nous a offert, en autres, ce que les catholiques appellent un
chapelet ou un rosaire, les réformés et luthériens ont remercié mais ont été un peu encombrés par ce
cadeau… Nous sommes allés ensemble dans un monastère orthodoxe où les chrétiens orientaux
vénèrent une icône de la Vierge, très ancienne et considérée comme miraculeuse ; encore une fois,
les protestants n’étaient pas très à l’aise… C’est dire que la fracture, si fracture il y a, ne passe pas
entre catholiques et protestants sur ce sujet. La différence se trouve entre des chrétiens s’inscrivant,
peu ou prou, dans la continuité de la tradition ancienne, et des chrétiens d’après la Réforme ayant
rompu avec des pratiques considérées par eux comme idolâtres…
N’imaginons pas non plus que tous les catholiques ont la même piété mariale. Les “équipes
du Rosaire“ et la “légion de Marie” n’ont pas les mêmes pratiques que l’Action Catholique Ouvrière
davantage portée davantage sur le militantisme que sur le culte, ou que des groupes bibliques
œcuméniques centrés sur l’Écriture. Personnellement, réciter le Rosaire, mettre des fleurs ou des
cierges devant une statue de la Vierge Marie, aller à Lourdes en pèlerinage,… ne font pas partie de
ma vie spirituelle, mais lire et méditer la Bible, ainsi que la participation régulière à l’eucharistie,
oui !
Quelques éclairages théologiques
La “hiérarchie des vérités” du concile Vatican II :
Dans le décret sur l’œcuménisme, le concile Vatican II affirme : « En exposant la doctrine,
les théologiens catholiques se rappelleront qu’il y a un ordre ou une “hiérarchie” des vérités de la
doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec les fondements de la foi chrétienne » (n°
11) C'est-à-dire que toutes les vérités n’ont pas la même place dans le mystère du salut. En effet,
quand les symboles de foi parlent de la Vierge Marie, ils confessent ainsi la divinité du Christ ;
quand le concile d’Éphèse proclame Marie “mère de Dieu” (theotokos), il porte le regard sur la
personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et déduit que la mère de Jésus peut être reconnue aussi
mère de Dieu. Ces affirmations sont christologiques, elles se rapportent au Christ Sauveur de
l’humanité. Ce que les siècles suivants, en particulier dans la piété populaire, ont pu dire de Marie,
n’a pas la même portée théologique, car plus loin du cœur de la foi chrétienne.
Pour continuer avec des éclairages théologiques, j’aime bien citer un texte du cardinal
Ratzinger, devenu aujourd’hui Benoit XVI, à propos des apparitions à Fatima au Portugal. En effet,
l’ancien préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi propose des distinctions intéressantes.
Trois formes de perception ou de vision
Une première distinction qui peut nous éclairer, c’est le cas de le dire : la distinction entre
trois formes de perception ou de vision.
« L'anthropologie théologique distingue en ce domaine trois formes de perception ou de
“vision” : la vision des sens, donc la perception externe corporelle, la perception intérieure et la
vision spirituelle. Il est clair que, dans les visions de Lourdes, Fatima, etc., il ne s'agit pas de la

Marie
- 2 -
perception normale extérieure des sens : les images et les figures qui sont vues ne se trouvent pas
extérieurement dans l'espace, comme s'y trouve par exemple un arbre ou une maison. De même, il
est évident qu'il ne s'agit pas d'une “vision” intellectuelle, sans images, comme on le trouve dans les
autres degrés de la mystique (cf. Thérèse d’Avila utilise ce vocabulaire de la vision intellectuelle). Il
s'agit donc de la catégorie intermédiaire, la “perception intérieure”, qui a certainement pour le
voyant une force de présence, laquelle équivaut pour lui à la manifestation externe sensible. » Donc
les catholiques ne croient pas que les voyants de Lourdes ou Fatima aient vu de leurs yeux la Vierge
Marie en chair et en os…
Ensuite on peut utiliser une autre distinction faite par le cardinal, distinction entre révélation
publique et révélation privée.
Révélation publique et révélation privée.
On parle de révélation publique de Dieu pour désigner la révélation consignée par écrit dans
la Bible, révélation qui culmine en Jésus-Christ. Dans cette révélation progressive, Dieu se fait
connaître, se révèle à l’humanité. Un texte de St Jean de la Croix, cité par le catéchisme de l’Église
catholique affirme : « Dès lors qu'Il nous a donné son Fils, qui est sa Parole, Dieu n'a pas d'autre
parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule Parole [...] ; car ce
qu'il disait par parties aux prophètes, Il l'a dit tout entier dans son Fils [...]. Voilà pourquoi celui qui
voudrait maintenant l'interroger, ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une
folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher
autre chose en quelque nouveauté » (CÉC, n. 65: S. Jean de la Croix, Montée au Carmel, 2, 22).
Mais alors que peut-on dire des révélations “privées” de Marie à Lourdes ou à Fatima ? Le
cardinal répond : « l’autorité des révélations privées est substantiellement différente de l’unique
révélation publique : cette dernière exige notre foi… La révélation privée est une aide pour la foi…
une aide offerte mais dont il est nullement obligatoire de faire usage ». Je traduis : aucun catholique
n’est tenu d’adhérer au message de la Vierge Marie à La Salette ! Le préfet pour la doctrine de la foi
poursuit son raisonnement et ses distinctions : « le critère pour la vérité et pour la valeur d’une
révélation privée est donc son orientation vers le Christ lui-même. » Autrement dit : Marie ne peut
pas dire quelque chose de contraire à l’Évangile !
Ces distinctions faites, je vous propose d’entrer dans le dernier document du comité mixte
baptiste-catholique sur Marie, document publié en octobre de cette année.
Le document du comité mixte baptiste-catholique
En bonne théologie œcuménique on commence toujours par redire avec force ce que nous
pouvons dire ensemble et puis on explique ensuite ce qui nous sépare. C’est ce que fait le comité
mixte baptiste-catholique en France.
Que peut-on dire ensemble ?
- Marie est une femme d’Israël, bénie entre toutes.
- Marie est Vierge et Mère : affirmation biblique et christologique (Jésus est Fils de Dieu).
- Marie, mère de notre Seigneur : Marie n’est pas seulement mère de la “nature humaine”
du Christ, elle est la mère d’une personne, le Verbe éternel, c’est pourquoi le concile
d’Éphèse au début du V
e
siècle la confesse comme “mère de Dieu”.
- Marie, servante du Seigneur, accueillant la Parole.

Marie
- 3 -
Les points qui font difficulté
- La coopération de Marie au salut
« Les catholiques ne craignent pas de dire que Marie a coopéré au salut réalisé par et en
Jésus-Christ. Cette coopération s’est déployée dans sa vie terrestre depuis l’acceptation de sa
mission exceptionnelle, son Fiat, jusqu’à sa présence au pied de la croix, en passant par sa maternité
et le rôle qu’elle joue auprès de son fils. En s’exprimant ainsi, les catholiques ne nient pas que le
salut est l’œuvre exclusive du Christ. Marie n’échappe pas à l’économie globale de la rédemption.
Elle n’ajoute rien à l’œuvre du Christ, mais elle en est la première bénéficiaire car elle a besoin
d’être rachetée comme tous les hommes. C’est par la qualité de sa réponse libre dans la foi qu’elle
constitue un modèle pour nous.
1
»
- La virginité perpétuelle de Marie
Au cours de l’histoire on a compris que « si Marie était la mère de Jésus et si Jésus était
confessé comme le Fils Unique de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, alors Marie était reconnue
comme Mère de Dieu (theotokos). Dans le même mouvement la mère virginale de Dieu était
comprise comme la mère toujours vierge de Dieu. La raison donnée était doctrinale : celle qui avait
tissé dans son sein virginal l’humanité du Fils de Dieu lui avait consacré de ce fait toute sa
personne.
2
» Parler ainsi est une radicalisation du témoignage évangélique. C’est bien la Vierge, ou
même “Marie toujours vierge” qui est invoquée dans la liturgie ancienne, toujours employée dans le
monde orthodoxe comme catholique.
- L’immaculée conception de Marie :
C’est la question de la sainteté de Marie qui est exprimée ainsi, “la toute sainte et bénie…”
honorée dans les liturgies orientales. L’Occident, après la doctrine du péché originel formulée par St
Augustin, se pose la question : Marie a-t-elle été préservée de ce péché originel ? Dans un premier
temps, on répond : non, car Marie appartient à l’humanité pécheresse, et en tant que telle, elle a
besoin de la rédemption universelle apportée par le Christ. C’est au XIV
e
siècle qu’un théologien
nommé Dun Scot formulera une réponse plus nuancée : « Marie a été rachetée du péché originel au
même titre que tous les hommes, mais elle l’a été non pas sous la forme de la purification, mais sous
celle de la préservation en vue des mérites de la passion du Christ
3
» On voit ici se poursuivre une
préoccupation continuelle : ne rien dire sur Marie qui serait incompatible avec “l’honneur du
Seigneur”. C’est la formulation de Dun Scot qui sera finalement promulguée dans le dogme du 8
décembre 1854 par le pape Pie IX :
« La bienheureuse Vierge Marie a été, dans le premier instant de sa conception, par une grâce
singulière de Dieu et par privilège, en vue des mérites de Jésus Christ sauveur du genre humain,
préservée de toute souillure du péché originel. »
- L’Assomption de Marie
« L’Assomption de la Vierge Marie après sa mort, en son corps et en son âme, est le répondant
de son Immaculée Conception au début de son existence. Celle qui n’a pas été marquée par la
corruption du péché originel n’est pas non plus soumise à la corruption du tombeau. Marie,
préservée de la mort spirituelle, est aussi préservée des conséquences de la mort corporelle. Ce
destin exceptionnel est la conséquence de sa maternité divine. Le corps de la mère appartient à
son Fils : celle qui a tissé en son sein la chair assumée par le Verbe de Dieu ne pouvait voir son
propre corps séparé du corps de son Fils. Par la puissance de la résurrection du Seigneur, son
1
Comité mixte baptiste-catholique, Marie, Documents épiscopats n° 10 / 2009, n° 26, p. 9.
2
Ibid. n° 30 p. 29.
3
Formulation du comité mixte, n° 39, p. 12.

Marie
- 4 -
corps a déjà revêtu l’incorruptibilité dont parle saint Paul.
4
» Cette foi dans ce mystère de
l’Assomption de Marie est présente dans le peuple chrétien bien avant la promulgation du
dogme par Pie XII en 1950. Elle a une signification ecclésiologique : Marie en son corps
anticipe ce qui est promis à tous lors de la résurrection finale, elle dit la vocation de l’humanité
sauvée par la résurrection du Christ.
- Le culte marial
Les théologiens du comité mixte baptiste-catholique s’appuient sur une exhortation
apostolique du pape Paul VI au sujet justement du culte marial. Ils rappellent que le culte marial
doit être biblique, liturgique, œcuménique (c'est-à-dire : « éviter avec soin toute exagération
susceptible d’induire en erreur les autres frères chrétiens sur la doctrine authentique de l’Église
catholique ») et anthropologique (Marie de Nazareth était une vraie femme). Le culte marial fait
partie du patrimoine catholique et demande à être régulé pour renvoyer au Christ unique médiateur.
L’Église catholique accueille la piété populaire et propose, « notamment dans les sanctuaires
marials, des moyens de purification de cette piété par la conversion au Christ ». Et le document cite
les propos du cardinal Ratzinger sur la distinction entre révélation publique et révélation privée, et
conclut sur ce sujet : « les apparitions mariales font partie de ces révélations privées et c’est comme
telles qu’elles sont appréciées par l’Église et recommandées ou non à la dévotion des fidèles, sans
jamais être imposées à leur foi.
5
»
- Marie et l’Église
Après quelques débats, le concile Vatican II a choisi de traiter de Marie dans la constitution
sur l’Église appelée Lumen Gentium. La mariologie n’est donc pas un traité à part, le concile aborde
le rôle de Marie dans son rapport à l’Église. Marie est présentée comme modèle de l’Église qui est,
elle aussi, « vierge, mère et sainte », vierge dans sa consécration totale au Christ, mère dans
l’engendrement des enfants de Dieu à la foi, sainte car sanctifiée par le Christ. Marie a été qualifiée
de “mère de l’Église” par le pape Paul VI en 1964, le pape prenant appui sur la scène évangélique
où Jésus sur la croix confie le disciple bien-aimé à sa mère : « voici ta mère » (Jn 19,27).
Je termine par quelques notes plus personnelles.
Quelques réflexions personnelles
Je vous propose quelques lectures de textes bibliques où je m’identifie volontiers à Marie
pour y découvrir d’autres visages de l’Église.
Marie à la Visitation comme figure de l’Église
Christian de Chergé, qui fut le prieur des moines de Tibhirine assassinés en Algérie en 1996,
méditait souvent cet évangile de la Visitation pour y chercher la place de l’Église en terre d’islam. Il
n'hésitait pas à s'identifier à Marie portant en elle « un secret vivant qui est encore celui que nous
pouvons abriter nous-mêmes, une Bonne Nouvelle vivante » disait-il. Sr. Bénédicte commente dans
un ouvrage à paraître : « Marie après l'Annonciation n'a pas d'idées à transmettre ou de projet à
bâtir ; lorsqu'elle se rend chez sa cousine, son sein cache le Fils de Dieu. La Bonne Nouvelle dont
elle est la messagère, c'est un tout petit bonhomme de quelques jours à peine. L'Évangile, c'est une
personne, une personne à présenter à d'autres personnes. » La “visitation” peut devenir ainsi une
4
Ibid. n° 47, p. 14.
5
Ibid. n° 52, p. 16.

Marie
- 5 -
figure de la mission de l’Église : porteurs au plus profond de notre chair de notre expérience de
Dieu (la figure de Marie enceinte de manière non visible), aller vers les autres qui sont eux aussi
détenteurs d’un message de la part de Dieu (c’est la figure d’Élisabeth dans le récit évangélique),
habités les uns et les autres par un message de vie, et dans la rencontre jaillit le Magnificat, l’action
de grâce.
Marie aux noces de Cana comme figure de l’Église
Dans la même ligne, on peut voir dans le rôle de Marie à Cana une figure de l’Église au
service des noces entre Dieu et l’humanité. Marie est elle aussi invitée à ces noces, noces
accomplies dans le Christ qui transforme l’eau des jarres pour la purification en vin d’alliance
nouvelle et éternelle. Marie est là, rappelant aux disciples de Jésus, serviteurs des tables : « quoi
qu’il vous dise, faites-le », puis s’effaçant. Cette figure décentre l’Église, Dieu se révèle tout au long
de l’histoire de l’humanité, et l’Église est au service de ce dialogue entre Dieu et l’humanité.
Marie, une place de femme dans l’Église.
Il est de bon ton dans l’Église catholique de définir “la dignité et la vocation de la femme, de
toutes les femmes” (pour utiliser des termes de Jean-Paul II) à partir de la figure de Marie.
Personnellement j’ai longtemps résisté à cette idée, parce qu’on m’a souvent dit : « Marie retenait
tous ces événements dans son cœur (sous-entendu : elle ne les exprimait pas à haute voix !), donc le
rôle des femmes dans l’Église n’est pas de prendre la parole en public ! » Petit à petit, j’ai appris à
faire la différence entre la place que mon Église donne aux femmes dans son organisation, et une
vie spirituelle proprement féminine. Et s’identifier à Marie, c’est vivre sa foi au féminin, en tant que
femme. Il me semble que la lecture de la Visitation que je vous ai proposée, bien qu’inspirée d’un
homme, est celle d’une femme, faisant l’expérience de Dieu au creux de sa chair.
J’ai constaté aussi la lecture différente qu’hommes et femmes pouvaient faire d’un autre
texte, celui de Marie et Jean au pied de la croix. Je connais des hommes qui s’identifient à Jean, et
s’entendent dire par Jésus : « voici ta mère », la Vierge Marie devient leur mère, la mère de l’Église.
Pour ma part, je me reconnais volontiers en Marie à qui Jésus confie son disciple bien-aimé :
« femme, voici ton fils ». J’ai expérimenté dans mes responsabilités pastorales auprès des jeunes
que Jésus me confiait quelques uns de ses disciples, j’ai été au service de leur relation avec lui, je
les ai aidés à grandir dans la foi, je les ai nourris, et je les ai laissés partir…, c’est ce qu’on appelle
de manière traditionnelle la “maternité spirituelle”. Et j’aimerais pouvoir dire comme le Christ au
soir de sa vie disait à son Père en parlant de ses disciples : « je les ai protégés et aucun d’eux ne
s’est perdu » (cf. Jean 17,12).
Anne-Noëlle Clément
Unité Chrétienne.
Lyon, 24 novembre 2009.
1
/
5
100%