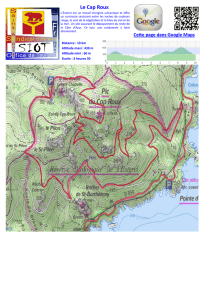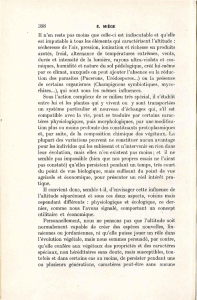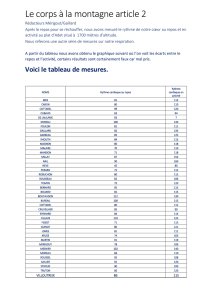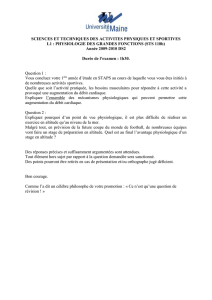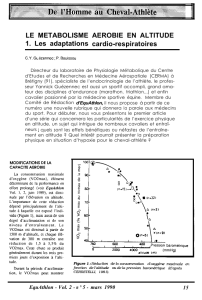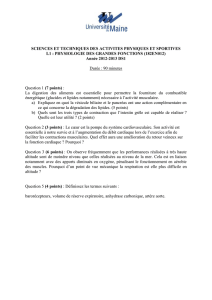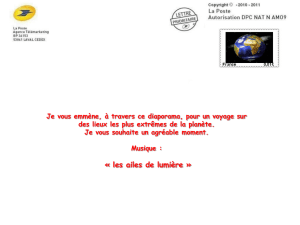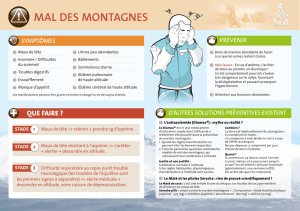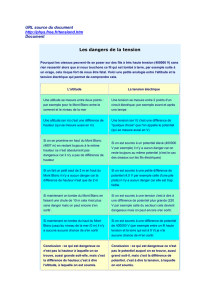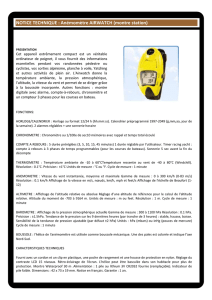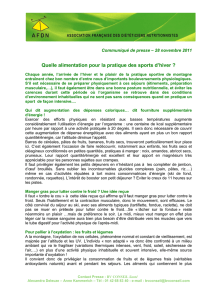Table ronde n° 3 : L`activité sportive en altitude Entraînement en

103
XIème Conférence nationale médicale interfédérale
Paris, 24 septembre 2014
Table ronde n° 3 : L’activité sportive en altitude
Docteur Paul ROBACH, Responsable du Pôle Recherche biomédicale Ecole Nationale des
Sports de Montagne, Chamonix ;
Professeur Jean-Paul RICHALET, Hôpital Avicenne. CHU Bobigny. Université Paris 13.
Docteur Laurent GERGELE, Service de réanimation polyvalente et neurologique – CHU de
Saint-Etienne ;
Entraînement en altitude
Docteur Paul ROBACH
Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier les
organisateurs de ce symposium et plus particulièrement les Docteurs MAGALOFF et
ROUSSEAUX-BIANCHI pour m’avoir invité à cette table ronde. L’entrainement des
athlètes en altitude constitue un sujet controversé.
Je vous décrirai brièvement les différentes méthodes d’entrainement en altitude
actuellement en vigueur au sein de la population des athlètes.
Puis, je procèderai à une mise au point succincte sur l’efficacité en matière de
performance de chacune de ces méthodes. Enfin, je fournirai quelques
recommandations d’actualité.
Globalement, nous pouvons relever trois grandes méthodes d’entrainement en
altitude. La première, dite classique ou historique, consiste pour les athlètes à résider et
à s’entrainer en altitude pendant plusieurs semaines.
La seconde, qui constitue une variante de la première, est intitulée « vivre en
haut/s’entrainer en bas ». La dernière est l’entrainement en hypoxie, qui consiste à vivre
en plaine et à s’entrainer dans un environnement d’altitude généralement simulé.
Il est admis depuis plusieurs années que le volume total de globules rouges circulant
dans le corps forme un facteur clé de la performance en endurance.
Or, l’altitude, dans la mesure où elle engendre une situation d’hypoxie et, ce faisant,
stimule l’érythropoïétine, permet d’augmenter le volume total de globules rouges
présents dans le sang.
La méthode dite classique présente un avantage hématologique. En effet, une
augmentation du volume total de globules rouges a pu être observée dans ce cadre,
même chez des athlètes de très haut niveau.

104
XIème Conférence nationale médicale interfédérale
Paris, 24 septembre 2014
Exposition continue à 3500 mètres (28 jours)
En revanche, aucune étude scientifique contrôlée n’a montré d’effet positif de cette
méthode chez les athlètes élite. L’hypothèse avancée généralement pour expliquer ce
phénomène est que la diminution des capacités d’aérobie engendrée par l’altitude
perturbe l’entrainement à haute intensité. Toutefois, celle-ci n’a jamais été vérifiée
expérimentalement.
La méthode « vivre en haut/s’entrainer en bas » repose sur l’hypothèse selon
laquelle il est possible de bénéficier de la stimulation de l’érythropoïèse tout en
s’affranchissant des contraintes liées à l’entrainement en altitude.
Vivre en haut – s’entraîner en bas
S’agissant de l’évaluation de cette méthode en altitude réelle, une seule étude
contrôlée, menée en 1997 par Lévine, existe à ce jour.
Celle-ci a conclu à une meilleure performance du groupe test sur 5 000 mètres par
rapport au groupe contrôle et au groupe s’étant entrainé avec la méthode dite classique.
En ce qui concerne l’évaluation en altitude simulée, plusieurs études contrôlées ont mis
en évidence une légère amélioration du volume total de globules rouges et de la
consommation maximale d’oxygène, sans toutefois établir d’effet significatif de la
méthode sur la performance en endurance.

105
XIème Conférence nationale médicale interfédérale
Paris, 24 septembre 2014
Centre national de ski nordique
Prémanon-Jura
L’entrainement en hypoxie repose sur une hypothèse périphérique selon laquelle
une amélioration de la fonction musculaire peut être escomptée en combinant le stress
de l’exercice musculaire et le stress hypoxique.
Entraînement en hypoxie
Vivre en bas – s’entraîner en haut
Celui-ci a fait l’objet de nombreuses études, réalisées principalement en altitude
simulée. Toutefois, seuls 50 % d’entre elles ont établi une amélioration de la
performance.

106
XIème Conférence nationale médicale interfédérale
Paris, 24 septembre 2014
En résumé, la méthode classique apparait particulièrement populaire, bien que son
efficacité ne soit pas prouvée sur le plan scientifique. A l’inverse, la méthode « vivre en
haut/s’entrainer en bas » semble offrir des garanties plus importantes.
Quant à l’entrainement en hypoxie, s’il apparait simple à mettre en œuvre, ses
effets positifs sont pour le moins sujets à caution.
Si la méthode choisie est celle intitulée « vivre en haut/s’entrainer en bas », il faut
garder à l’esprit que la dose totale d’hypoxie doit être importante, ce qui n’est possible
qu’avec un séjour de trois semaines minimum et une exposition quotidienne à l’hypoxie
la plus longue possible.
Plus Hbmass de base est élevé, moins la méthode « vivre en haut – s’entraîner en bas » a d’effet sur Hbmass
En ce qui concerne la fourchette d’altitude recommandée, celle-ci varie entre
2 000 mètres et 2 500 mètres.
Résultats négatifs en dépit d’une dose d’hypoxie élevée si l’altitude est trop élevée (3000 m)
Enfin, les scientifiques recommandent d’organiser la compétition immédiatement
après l’entrainement, tandis que les entraineurs estiment qu’un délai de deux semaines
est préférable.

107
XIème Conférence nationale médicale interfédérale
Paris, 24 septembre 2014
Je vous remercie de votre attention.
Actualités sur les pathologies et les traitements liés à la haute altitude
Professeur Jean-Paul RICHALET
Je tiens tout d’abord à adresser mes remerciements à Patrick MAGALOFF et à
Marie-Philippe ROUSSEAUX-BIANCHI de me donner l’opportunité d’évoquer les
pathologies liées à l’altitude. Je tiens tout d’abord à préciser que, à l’inverse de la haute
montagne, la moyenne montagne ne présente que peu de risques.
Les pratiquants de la haute altitude
Parmi les pathologies liées à la haute altitude, nous pouvons citer :
x Le mal aigu des montagnes ;
x Les œdèmes pulmonaires et cérébraux, qui forment autant de complications
du mal aigu des montagnes ;
x Les maladies hémorragique, ischémique et thromboembolique ;
x La polyglobulie chronique d’altitude.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%