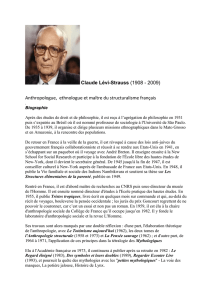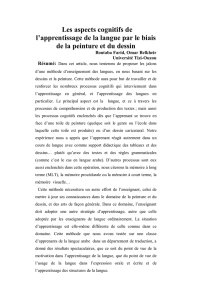Sciences cognitives : fil d`Ariane ou lit de Procuste pour l`anthropologie

Intellectica, 2008/3, 50, pp
.
103-174
© 2008 Association pour la Recherche Cognitive.
Sciences cognitives : fil d’Ariane ou lit de Procuste pour
l’anthropologie ?
Lucien Scubla
« Seule une voie synthétique, qui s’efforce de remonter à la
source commune de l’organisation du monde et du sujet
pensant le monde, a quelque chance de réussir. »
René Thom. Modèles mathématiques de la morphogenèse,
Paris, Christian Bourgois, 1981, p. 297.
R
ÉSUMÉ
: L'auteur reprend ici la critique qu'il adressait, il y a déjà vingt ans, au
programme de recherche cognitiviste appliqué à l'anthropologie des phénomènes
religieux. Ce programme visait notamment à pallier les limites indéniables des
théories structuralistes du sémiotique. Mais, la théorie de l'apprentissage, qui permet à
un auteur comme D. Sperber de rabattre l'anthropologie sur la psychologie cognitive,
n'a lui-même presque rien à dire sur l'universalité des formes symboliques, qui tient
non pas aux seules caractéristiques de l'esprit humain mais plutôt à des conditions
générales que seule une philosophie de la nature est capable de mettre au jour.
Mots-clés : critique de l'anthropologie cognitive; critique du relativisme culturel;
critique de la psychologie cognitive; théorie du sacrifice rituel ; traitement symbolique
et traitement rationnel.
A
BSTRACT
: The Birth of Divinity and of Insanity. The author goes back to the
criticisms he had already addressed to the research program of cognitivism applied to
the study of religion twenty years ago. This program was motivated by the limits of
the structuralist theories of semiosis. But the theory of learning which would allow an
author like D. Sperber to limit the study of anthropology to cognitive psychology has
nothing say about the universality of symbolic forms, which depends not only on the
features of the human mind but also on features that only a philosophy of nature is
able to reveal.
Keywords: criticism of cognitive anthropology; criticism of cultural relativity ;
criticism of cognitive psychology; theory of ritual sacrifice symbolic and rational
processing
Avant-propos : vingt ans après
Il y a exactement vingt ans, le centre de recherche auquel l’auteur de ces
lignes appartient opérait un « tournant cognitif ». Il entendait ainsi, non seule-
ment s’ouvrir aux sciences de la cognition, mais les ériger en voie royale des
sciences de l’homme et de la société. Jugeant qu’une « approche cognitive du
social », si légitime fût-elle, risquait d’être trop restrictive pour l’anthropologie,
nous écrivîmes alors un long texte pour expliciter nos réticen-
CREA-École polytechnique, 1 rue Descartes, 75005 PARIS.

104 L. SCUBLA
ces à l’égard de toute subordination du social au cognitif. Pour ne pas nous
perdre dans des généralités, nous choisîmes de limiter notre critique à un exa-
men exhaustif et détaillé des écrits de Dan Sperber, qui était, et demeure, dans
notre pays, un des avocats les plus déterminés d’une anthropologie résolument
cognitive et même cognitiviste.
C’est ce texte, à peine retouché, que nous publions ici. Nous l’avions rédigé
pour le colloque « Approches de la cognition », tenu à Cerisy-la-Salle, en juin
1987, où il ne fut cependant pas présenté en séance publique, mais remplacé
par une communication plus brève qui répondait point par point à celle de
Sperber. Cette dernière fut publiée dans les Actes du colloque
1
, et le texte
originel parut dans les Cahiers du CREA
2
. Ni l’une ni l’autre n’eurent d’écho
dans les cercles cognitivistes, ni ne donnèrent lieu à débat. Nous en restâmes
donc là, pensant avoir suffisamment contribué à la controverse scientifique sur
ces questions
3
.
Deux décennies ont passé. Les adeptes de l’anthropologie cognitive ont
accumulé travaux et publications, dont plusieurs tentatives d’explication des
phénomènes religieux, mais sans faire, à notre connaissance, de découverte
majeure qui nous obligerait à réviser nos positions. Quant à l’engouement pour
les sciences cognitives, avec son cortège d’espoirs chimériques et de conduites
opportunistes, il est tout naturellement retombé, comme celui que la théorie de
l’information et la linguistique avaient soulevé quelques décennies plus tôt.
Signe des temps, dans une de ses dernières livraisons, L’Homme a publié un
article au titre provocateur, qui se réfère à notre texte d’il y a vingt ans
4
.
Comme celui-ci est devenu difficile d’accès, c’est pour nous l’occasion de
l’exhumer.
Comme le titre de cet article le laisse entendre, nous doutons fort que le
développement des sciences cognitives soit appelé à exercer une influence
décisive sur le destin de l’anthropologie. Selon nous, c’est plutôt
l’anthropologie qui pourrait contribuer à élargir l’étude des processus cognitifs.
Partir de postulats cognitivistes pour tenter de reconstituer toute
l’anthropologie, c’est se donner une définition trop pauvre de la nature
humaine, d’où dérivent nécessairement des théories incomplètes des phénomè-
nes culturels.
Pour justifier ce sentiment, nous allons faire une lecture critique des travaux
de Dan Sperber qui, on le sait, défend explicitement la thèse inverse, et même
n’est pas loin, dans ses derniers écrits, de réduire l’anthropologie à la psycho-
logie cognitive. En reprenant un à un les matériaux qu’il utilise pour étayer ses
analyses, nous tenterons de montrer qu’ils échappent presque tous aux filets
d’une théorie cognitiviste de la culture, si l’on entend par là une théorie soute-
nant que « les capacités d’apprentissage spécifiques à l’espèce humaine »
suffisent à limiter et à organiser le champ relativement restreint des « varia-
1
« Sciences cognitives, matérialisme et anthropologie ». In Introduction aux sciences cognitives, sous la
direction de D. Andler, Paris : Gallimard, 1992, pp. 441-446.
2
« Sciences cognitives : fil d’Ariane ou lit de Procuste pour l’anthropologie ? ». Cahiers du CREA, n°
12, Paris : École polytechnique, 1988, pp. 179-288.
3
Pour une présentation plus générale de notre conception de l’anthropologie, voir « Sciences cognitives
et anthropologie culturelle », Cahiers du CREA, n° 10, 1986, pp. 9-90, article repris et développé, en le
dépouillant de sa gangue cognitive, dans « Diversité des cultures et invariants transculturels », Revue du
MAUSS n° 1, 1988, pp. 96-121, et n° 2, 1988, pp. 55-107.
4
F. Affergan, « L’anthropologie cognitive existe-t-elle ? », L’Homme, 184, 2007, pp. 85-106.

Sciences cognitives : fil d’Ariane ou lit de Procuste pour l’anthropologie ? 105
tions culturelles » (1973, pp. 118-119 ; 1974, pp. 9 et 158)
5
. Mais, le bilan ne
sera pas totalement négatif, car, nous verrons que les mêmes matériaux ont des
traits communs récurrents qui suggèrent une autre conception possible de la
culture et de l’anthropologie.
A
NTHROPOLOGIE ET CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Au préalable, nous croyons utile, pour mieux situer le débat, d’examiner
nos principaux points d’accord et de désaccord sur des questions d’ordre géné-
ral qui touchent à la nature même du savoir anthropologique.
La critique du relativisme culturel
Sur deux points, au moins, nous avons des positions voisines de celles de
Sperber. En premier lieu, nous approuvons, sans réserves, son rejet du relati-
visme culturel (1978, 1982 : chap. 2), qui n’est ni un principe rationnel, ni une
vérité d’expérience. En effet, puisque tous les hommes appartiennent à la
même espèce biologique, il est plus légitime de postuler l’unité culturelle de
l’humanité. C’est au relativisme que revient la charge de la preuve. Or, exami-
nés de près, tous les arguments empiriques avancés en sa faveur se retournent
contre lui
6
. Berlin et Kay, par exemple, ont définitivement ruiné la thèse selon
laquelle chaque langue découperait arbitrairement le spectre des couleurs
(1978, pp. 33-34) – thèse qui fut longtemps, on le sait, le paradigme dominant
de toute anthropologie relativiste. Les vocabulaires des couleurs dont nous
avons une bonne description se laissent tous ordonner par inclusion. Alors que
le relativisme impliquerait une variété indéfinie de cultures, « l’image qui se
dégage de la littérature ethnographique accumulée », note Sperber, est « plutôt
celle de variations extrêmement élaborées à l’intérieur d’un éventail qui semble
arbitrairement restreint » (1978, p. 27). En fait, le relativisme est une sorte de
dogme, sans autre assise que l’argument d’autorité, une sorte de mot de passe,
contribuant à fédérer tant bien que mal la communauté anthropologique.
Structures de code et structures de réseau
En second lieu, nous partageons le souci de Sperber de bien circonscrire
l’objet de l’anthropologie (1978, 1982). Son essai sur le structuralisme, petit
chef d’œuvre d’intelligence et de clarté, propose à cet égard des distinctions
5
Pour alléger les références aux travaux de Dan Sperber, nous donnerons seulement leur date de
publication et leur pagination. En voici la liste :
« Le structuralisme en anthropologie », in Qu’est-ce que le structuralisme ?, 2
e
éd., augmentée d'une
« Postface », Paris : Seuil, coll. Points, 1973.
Le symbolisme en général, Paris : Hermann, 1974.
« Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement ? »,
L'Homme, XV, 2, 1975, pp. 5-34.
« Contre certains a priori anthropologiques », in L'unité de l'homme, colloque de Royaumont, 2
e
éd.,
Paris : Seuil, coll. Points, vol. 3, 1978, pp. 25-41.
« La pensée symbolique est-elle pré-rationnelle ? » dans La fonction symbolique, essais d'anthropologie
réunis par M. Izard et P. Smith, Paris, Gallimard, 1979, pp. 17-42.
Le savoir des anthropologues, Paris : Hermann, 1982.
«Anthropology and Psychology: towards an Epidemiology of Representations », Man (N-S), 20, pp. 73-
89.
6
L. Scubla, « Diversité culturelle et unité de l'homme », Critique n° 437, 1983, pp. 796-818 ;
« Diversité des cultures et invariants transculturels », Revue du MAUSS n° 1, 1988, pp. 97-108.

106 L. SCUBLA
fort utiles. Lévi-Strauss, montre-t-il, confond « structures de réseau » et
« structures de code » (1973, pp. 71-77). Mettre sur le même plan l’échange de
femmes et l’échange des mots revient à assimiler la langue (le « code »)
employé pour envoyer et recevoir des messages et le réseau téléphonique qui
permet de les transmettre. La langue est un objet mental, elle appartient en
propre à l’esprit humain. Mais, le réseau téléphonique a une structure tout à fait
indépendante de l’esprit humain, quand bien même il aurait été construit sui-
vant un plan précis ou un calcul d’optimisation et, à plus forte raison, s’il s’est
formé de proche en proche, au fur et à mesure des demandes d’abonnement des
usagers. Or, la seconde hypothèse a valeur générale : il y a, dans toute société,
formation incessante d’une multitude de réseaux (relations de parenté, de voi-
sinage, de camaraderie, relations commerciales, etc.) dont la structure n’a été
voulue ni conçue par personne, même si elle est, en principe
7
, toujours
concevable par l’esprit humain.
Dans l’ensemble des structures concevables par l’esprit humain, il faut
donc faire une première distinction, entre celles qui sont disponibles aux hom-
mes, c’est-à-dire « aptes à régir les manifestations humaines », et celles qui ne
le sont pas, puis, parmi les structures disponibles aux hommes, une seconde
distinction, entre celles qui sont disponibles à l’esprit humain et celles qui ne le
sont pas (1973 : 107). Alors que, dans les Structures élémentaires de la parenté
et l’Anthropologie structurale, Lévi-Strauss attribue toutes les structures qui
sont à l’œuvre dans les sociétés humaines à l’activité de l’esprit humain
8
,
Sperber lui objecte, avec raison, que « les dispositifs mentaux de l’homme […]
ne sont pas les seuls à régir les systèmes socioculturels » (1973, p. 106). Le
langage, par exemple, est une faculté individuelle, « même si elle ne se mani-
feste qu’en collectivité », mais « les systèmes de communication complexes,
tels le politique et le rituel, peuvent impliquer des dispositifs qui
n’appartiennent pas à l’esprit d’un homme. » (1973, p. 107)
Psychologie, sociologie, anthropologie
Nous ne pouvons qu’acquiescer à ces propos, en les retouchant toutefois
légèrement. Tout d’abord, en substituant le terme classique et neutre
d’ « institution » à l’expression « système de communication », reprise de
Lévi-Strauss, qui a l’inconvénient d’assimiler d’entrée de jeu les diverses ins-
titutions d’un peuple à sa langue, et de réduire le langage lui-même à un moyen
de communication. Ensuite, en précisant qu’une société humaine présente non
pas deux, mais trois types d’objets différents
9
, correspondant chacun à un point
7
Nous disons « en principe », car il se pourrait, comme le soutient Hayek, que les sociétés humaines
soient constituées d’interactions si nombreuses et si complexes qu’aucun esprit humain, ni même
calculateur idéal, ne puisse les intégrer.
8
Dans la Pensée sauvage, Lévi-Strauss reconnaît l’autonomie de certaines structures sociales, mais les
exclut ipso facto du champ de l’anthropologie, qui se trouve dès lors réduite à une étude des
superstructures, et même à une psychologie. L’anthropologie structurale demeure l’étude des produits
de l’esprit humain. Mais, fort logiquement, elle ne s’intéresse plus qu’aux mécanismes intellectuels à
l’œuvre dans les mythes et les systèmes de classification. L’anthropologie cognitive donne l’impression
de vouloir maintenant récupérer tout ce qui a été abandonné par Lévi-Strauss, mais sans se départir de
ses présupposés intellectualistes. C’est impossible.
9
On remarquera que nous parlons ici d’objets différents et non de réalités distinctes. En effet, chaque
objet est défini par un point de vue théorique sur la société, mais tous n’ont pas le même degré de
réalité. Les phénomènes collectifs (démographiques, économiques, etc.), qui font l’objet des sciences
sociales proprement dites, n’ont pas de réalité propre, ne forment pas stricto sensu une composante de la

Sciences cognitives : fil d’Ariane ou lit de Procuste pour l’anthropologie ? 107
de vue théorique distinct. En premier lieu, des individus vivant en commun,
dotés de dispositions et d’aptitudes spécifiques, à procréer, parler, imiter,
échanger, etc., et relevant, à ce titre, de la biologie, et surtout, pour leurs qua-
lités proprement humaines, de la psychologie. En deuxième lieu, des
phénomènes collectifs, par exemple démographiques ou économiques, résul-
tant des actions et interactions des individus, mais ne dépendant pas de l’esprit
humain, et pouvant par là même, comme le notait déjà Cournot, faire l’objet
d’une véritable « physique sociale » (lois de Lotka-Volterra, théorie de
l’équilibre général, etc.). En troisième lieu, des systèmes de régulation de ces
phénomènes individuels et collectifs, comme les institutions familiales, politi-
ques ou rituelles, qui, tout en étant propres aux hommes, sont régis par des
principes qui, eux non plus, – c’est l’hypothèse défendue ici par Sperber et
aussi la nôtre – ne dépendent pas tous de l’esprit humain. C’est pourquoi
l’anthropologie, qui étudie ces dispositifs spécifiquement humains, est une
discipline distincte aussi bien de la psychologie que de la sociologie
10
. C’est
société, n’étant que l’effet ou la résultante des actions et interactions des individus et des groupes. Pour
nous, comme pour Sperber (du moins dans le texte ici commenté), il n’y a que deux composantes
véritables : les individus et leurs mécanismes ou « dispositifs » mentaux, d’une part, les institutions et
les mécanismes ou dispositifs non mentaux dont elles procèdent, d’autre part. Sperber ne dit rien de
précis sur la nature de cette seconde composante et son articulation avec la première. Nous faisons,
quant à nous, l’hypothèse que les individus et les phénomènes collectifs qui en résultent constituent la
matière, au sens aristotélicien du terme, de la société, alors que l’ensemble des institutions (la culture,
au sens anthropologique du terme), représente sa forme, son vinculum substantiale.
10
Même si cette tripartition est familière, et bien ancrée dans nos mœurs et institutions scientifiques,
elle a des implications ontologiques qu’il n’est pas facile de justifier intellectuellement. La distinction
de la psychologie et de la sociologie ne pose pas de problème particulier, car il est toujours possible de
réduire le social au collectif, c’est-à-dire à un effet de composition des actions et interactions des
individus. L’autonomie épistémique du social n’entraîne pas son autonomie ontologique. Même
Durkheim, qui passe pour holiste, en raison de son exigence de toujours expliquer le social par du
social, s’en tient à cette façon de voir : dans les Formes élémentaires de la vie religieuse, le sentiment
du sacré et les représentations collectives qui l’accompagnent, comme les institutions qui en dérivent,
sont engendrés mécaniquement par les interactions des individus au sein d’une foule en effervescence.
Il est plus délicat, en revanche, de reconnaître l’autonomie de l’anthropologie, car cela suppose cette
fois l’autonomie ontologique de ce que Durkheim appelle encore la société ou le social, mais qu’il vaut
mieux appeler la culture, pour en marquer clairement la nature et la spécificité. C’est ce que postule le
structuralisme, quand il se donne pour objectif de dresser une table de Mendeleïev des cultures, c’est-à-
dire un inventaire systématique des formes structurellement stables de toutes les sociétés réelles ou
possibles. Comme celles des atomes, ces formes culturelles ne résulteraient pas, elles non plus,
d’agrégations contingentes et d’interactions aveugles, mais seraient déterminées par des principes
structuraux fixant a priori les configurations permises et interdites aux éléments qui leur sont
subordonnés. Les partisans de l’individualisme méthodologique refuseront d’hypostasier ainsi la
culture, et tenteront de montrer qu’il s’agit seulement d’un être de raison, toujours réductible au social
tel qu’il a été défini précédemment, c’est-à-dire au collectif. Les processus sociaux, diront notamment
les économistes, présentent souvent des dynamiques différentes. Les prix des biens et des services, par
exemple, peuvent très bien relever d’une dynamique rapide, et les règles de droit, qui encadrent les
échanges commerciaux, d’une dynamique lente. Cette différence de régime peut donner l’impression
que les différents effets des processus sociaux ne sont pas tous de même nature, et que certains sont
transcendants par rapport à d’autres, mais ce serait une illusion. Pour répondre à ce genre d’objection, il
faudrait pouvoir montrer que les principes organisateurs de la culture ont des propriétés spécifiques,
tandis que les lois gouvernant les processus sociaux proprement dits ont des propriétés génériques,
c’est-à-dire communes à tous les agrégats (au sens leibnizien du terme), indépendamment de la nature
de leurs éléments, comme le suggèrent les lois de l’économie qui utilisent les mêmes équations que la
mécanique. La distinction, faite par Pierre Auger, entre « lois intégrales » et « lois différentielles »
(L’homme microscopique, Essai de monadologie, Paris : Flammarion, 1952) conforte cette idée et
montre la voie à suivre (cf. L. Scubla, « Classification des sciences et philosophie de la nature,
Prolégomènes à une épistémologie des sciences de l’homme et de la société », Cahiers du CREA, n° 15,
1992, pp. 49-91).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%