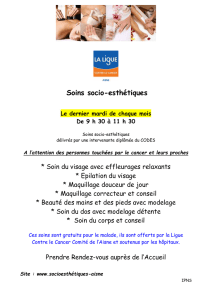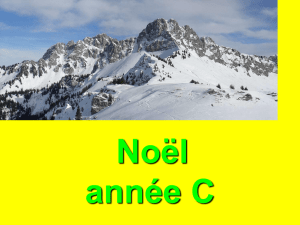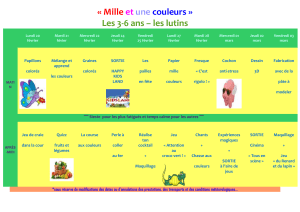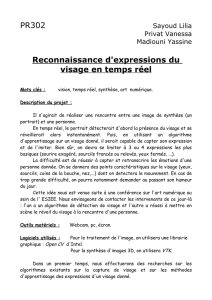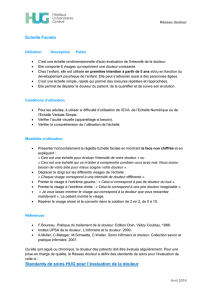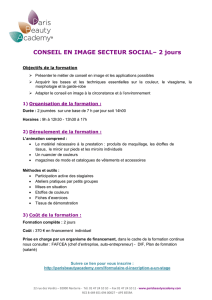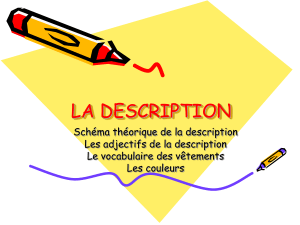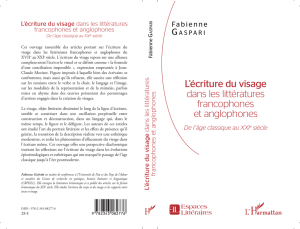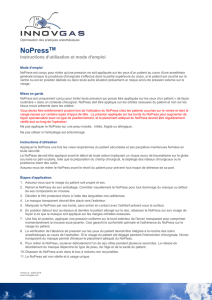Les dess(e)ins du visage féminin

Les dess(e)ins
du visage féminin
Une anthropologie du maquillage
L
e maquillage est loin de n’être
que ce phénomène superficiel et
frivole souvent décrit, cette prati-
que que l’on n’envisage que du point de
vue esthétique, oubliant sa discrète part
anthropologique. Pour dépasser l’appa-
rente futilité, il faut alors se plonger en
cet art de l’apprêt par l’entremise de
celles qui quotidiennement s’adonnent
à ses effets.
Cet article se propose d’exposer les
conclusions d’une enquête consacrée au
maquillage quotidien, menée auprès de
40 femmes par entretiens semi-direc-
tifs. Les femmes interrogées étaient de
professions et de milieux sociaux variés
(étudiantes, commerciales, institutrices,
professeurs, conseillères d’orientation,
secrétaires, etc.) et de situations matri-
moniales diverses (célibataires, mariées,
divorcées). Elles étaient âgées de 20 à 55
ans, cet éventail favorisant une analyse
diachronique des pratiques cosmétiques
au fil de l’existence individuelle, depuis
l’adoption du maquillage, alors qu’il est
encore en chantier et toujours changeant,
jusqu’à son épanouissement lorsque
l’idéal esthétique – l’harmonie des fards
et du visage – paraît en quelque sorte
abouti. Chaque enquêtée était amenée
à évoquer ses débuts cosmétiques, ses
sources d’inspiration passées et présen-
tes, la composition et l’évolution de son
maquillage, ainsi que ses attentes envers
le visage paré, sa relation au visage nu, la
complémentarité, la distinction ou l’op-
position de ces deux faces. De nombreu-
ses femmes, certes, usent de fards plus
rarement ; certaines ne se maquillent
jamais : celles-ci demeureront un instant
spectatrices puisque l’enquête ici présen-
tée ne s’intéresse volontairement qu’à la
pratique quotidienne. L’abstinence cos-
métique, son opposé, serait alors l’objet
d’une nouvelle recherche.
Le maquillage est une pratique riche
du point de vue anthropologique
1
puis-
qu’il parvient de manière inédite à con-
juguer l’intime et le social, l’individuel
et le culturel, mêlant le visage de l’être
à son paraître, mariant l’originelle appa-
rence à d’artificielles parures. Au-delà
d’un pur narcissisme, il accède aux pro-
fondeurs sociales et culturelles de la
société. Il est une extrapolation du visage
féminin, un double remanié de soi, une
seconde figure. Il est une modification
corporelle à part et à part entière, une
transformation faciale particulière car
il laisse peau et chair indemnes, se con-
tentant de les recouvrir sans jamais les
entrouvrir. La modification cosmétique
appartient à une esthétique de l’éphé-
mère : le maquillage est un visage pro-
visoire. Jeu entre mise en lumière et
dissimulation, il masque autant qu’il
dévoile. Le maquillage, encore, inter-
roge la distinction – qui parfois se fait
confusion – entre visage intime et visage
social : la socialité appelle-t-elle tou-
jours la parure, le visage apprêté pour
l’altérité ? Et la figure de la solitude
est-elle toujours dénudée, libérée de tout
cosmétique apprêt ? N’existerait-t-il pas
de faces ambivalentes, hors des schémas
classiques – visages parés malgré l’iso-
lement ou figures satisfaites du naturel
en plein cœur du relationnel ?
Le maquillage
en tout sens ■
Le maquillage métamorphose le visa-
ge par un jeu de fards : il agit à la maniè-
re d’une illusion cosmétique. Dès lors, sa
connotation négative devient limpide :
perçu comme spécieux, il reste l’art de
la falsification ainsi qu’en témoignent
encore ses nombreuses définitions.
La beauté est un art légué, dit la
Genèse, par l’ange Azaël qui, après la
50
LAURENCE PFEFFER
Laboratoire “Cultures et sociétés en Europe”
(UMR du CNRS n° 7043)
Université Marc Bloch, Strasbourg
RSS33.indb 50 25/04/05 14:55:59

51
chute d’Ève, montra aux femmes l’art
de se peindre le tour des yeux à l’an-
timoine. Le maquillage est une prati-
que ancestrale ; à l’origine il était censé,
à la manière d’un masque, protéger le
visage nu des agressions maléfiques :
« Le maquillage des lèvres avait pour
but d’empêcher le diable de pénétrer
dans la bouche ; de même, le khôl proté-
geait du mauvais œil »
2
. Le maquillage
se focalisait autour des orifices du visage
(œil, bouche), comme s’il pouvait les
protéger en empêchant tout démon de
pénétrer en leurs vulnérables béances.
Les représentations du maquillage peu à
peu se sont modifiées jusqu’à se teinter
de négativité : son caractère magique,
capable de métamorphoser la nature,
petit à petit en suppôt du diable l’a con-
verti. Selon Saint Jérôme, « Le masque du
maquillage représente l’image du diable
appliquée sur le visage que Dieu a pétri.
Ainsi, au jour du jugement dernier, le
Christ ne reconnaîtra pas la coquette
et l’enverra en Enfer »
3
. Le maquillage
alors n’était qu’offense envers Dieu et
son œuvre, immoralité, coupable vanité :
farder son visage représentait le péché de
celui qui sans mesure se vautrait dans la
luxure. Car l’être vertueux, quant à lui,
s’abandonnait volontiers aux mains de
son Créateur, préservant précieusement
le visage originel qu’il lui avait dessiné,
ne pensant qu’à embellir son âme
4
: « La
beauté ne peut être «recherchée» puis-
qu’elle est «donnée» par Dieu »
5
.
Dans le sens commun, le maquillage
persiste à faire mauvaise figure : il est jeté
du côté de l’orgueil, de la luxure, de la
prostitution. La femme maquillée serait
fausse, hypocrite et tricheuse. À moins
qu’elle n’use des fards avec finesse, s’or-
nant d’un maquillage discret – paupiè-
res colorées avec nuance, bouche rosie
avec délicatesse et sans excès : car dans
les imaginaires, le maquillage distingué
paradoxalement est celui qui ne se dis-
tingue pas du visage mais s’y fond ; il est
cette parure sincère et légère qui préserve
la face sans la muer en masque ; il s’y
pose doucement jusqu’à s’y confondre,
avec sensibilité plutôt qu’avec grossièreté
ou trivialité. Car le maquillage vulgaire,
quant à lui, est celui qui, criard – bouche
outrageusement rougie, regard abusive-
ment peinturluré – se détache insolem-
ment et brutalement du visage, imposant
sans mesure l’artifice au détriment de
l’originelle figure, perdant la beauté natu-
relle des traits derrière des ornements
trop épais. Et si, malgré les apparences,
n’existait en soi ni maquillage vulgaire
ni fard distingué, et que ne subsistaient
que des femmes naturellement insolen-
tes ou élégantes : « Les frontières sont
plus confuses aussi, où l’artifice pourrait
basculer entre plusieurs signes pour une
même personne : de celui de l’élégance
à celui de la grossièreté ou même de
la prostitution. Pepys […] peut avouer
suivre une femme soupçonnée d’être une
«fille de joie» dont il trouve le « visage
joli et paré» […]. Il reconnaît en revan-
che « détester » brusquement une amie
proche en apprenant qu’elle «se peint
le visage», au point de lui «inspirer du
dégoût » […]. Le thème du fard hante, à
vrai dire, l’évocation de la prostituée au
XVIIe siècle. »
6
. Maquillage distingué et
maquillage vulgaire, élégance ou mœurs
dépravés par les fards esquissés, peut-être
finalement ne serait-ce là que pures vues
de l’esprit ?
Même si le blâme à l’encontre du
maquillage, artifice des femmes légè-
res, ne s’exprime plus avec la même
verve qu’autrefois, sa mauvaise réputa-
tion survit dans l’imaginaire social
7
et
jusque dans certaines définitions du mot.
D’après le Grand Larousse encyclopédi-
que, le maquillage est, au sens propre,
« une technique ayant pour objet de modi-
fier le modelé d’un visage à l’aide de pro-
duits que l’on applique sur la figure, les
yeux, les cils, les sourcils et les lèvres :
le maquillage doit être adapté au teint de
la personne et à la forme de son visage ».
Le maquillage apparaît comme un pro-
cédé magique capable de métamorphoser
le visage, d’en changer la configuration
originelle. Il bouleverse l’ordre facial
préétabli en contrant la nature, tout en
respectant l’unicité de chaque femme, de
chaque face : « Les cosmétiques suivent
la même interrogation sur la physionomie
au XVIIIe siècle. Les fards, par exemple,
sont censés s’adapter à chacun : il faut un
rouge «qui vous dise quelque chose» »
8
.
Parallèlement, « maquiller, c’est accen-
tuer la beauté d’un visage en dissimulant
ses imperfections et en mettant en valeur
ses qualités esthétiques ». De procédé
magique, le maquillage rapidement se
meut en falsification : la modification
faciale, aussi superficielle soit-elle,
reste remaniement de l’image que l’on
Estelle Schweigert, La salle de bain, 1994,
photographie couleur marouflée sur plaque
d’aluminium. Collection Frac Alsace. © Agence
culturelle d’Alsace
Laurence Pfeffer Les dess(e)ins du visage féminin
RSS33.indb 51 25/04/05 14:56:01

52 Revue des Sciences Sociales, 2005, n° 33, “Privé– public : quelles frontières ?”
donne à voir, tricherie esthétique. Le
maquillage, aux « intérêts correcteurs »
(Vigarello), devient un masque derrière
lequel se tapissent de honteuses imper-
fections, susceptibles de faire perdre la
face. La femme tend à mettre en valeur
ses atouts physiques pour faire bonne
figure : elle chemine vers un idéal esthé-
tique du visage. En outre, au sens propre,
maquiller, revient aussi à « farder son
visage pour le faire apparaître autre qu’il
n’est. Exemple : une femme se maquille
pour se rajeunir ». Le maquillage reste
abordé comme une savante modification
du visage : sa finalité n’est que tromperie
puisqu’il agit sur la perception. La femme
fardée n’est pas innocente
9
: elle met en
scène son visage de manière calculée
pour faire brillamment face dans l’inte-
raction.
Si le sens propre du terme était évo-
cateur, ses sens figuratifs et dérivés le
sont plus encore. « Maquillage : action
de donner une apparence trompeuse, fal-
sification. Exemple : le maquillage d’une
automobile volée. » ; « Falsifier, truquer :
maquiller un passeport » ; « Maquiller les
brèmes : tricher au jeu ». Les sens figura-
tifs de maquillage et maquiller désignent
exclusivement tricherie et falsification :
actions malfaisantes, ils ont pour fina-
lité le mensonge et l’illusion ; ils ne sont
que modifications apparentes destinées
à abuser l’œil et le jugement de l’Autre.
En réalité, le terme maquillage apparaît
à la fin du XVIe siècle et comporte alors
un sens péjoratif, propre à la tricherie et
au truquage, qu’il conservera jusqu’au
XIXe siècle. D’autres termes d’origine
cosmétique ont également, par exten-
sion, désigné le mensonge : un maquilleur
n’est-il pas un tricheur, un faussaire ?
Le fard ne signifie-t-il pas, au-delà de
cette poudre teintée, la feinte, le dégui-
sement ainsi que des dehors spécieux ?
On peut parler sans fard, c’est-à-dire sans
feinte, directement, ou farder la vérité en
cachant ce qui peut déplaire. Pour rester
dans cet univers falsificateur, l’on peut
encore parler de la photographie, qui
fait du maquillage « une opération cor-
rective consistant à appliquer au dos du
cliché une substance absorbant la lumière
en certaines régions, pour améliorer le
rendu de l’image ou corriger quelques
imperfections qui ne justifient pas une
retouche ». Le maquillage, ingénieux
artifice capable d’améliorations esthéti-
ques, sublime l’image à la manière d’un
trompe-l’œil. Il apparaît en outre comme
une technique corrective superficielle car
pour de plus graves défauts, il s’avère
insuffisant : l’image requiert alors une
retouche. Entre le maquillage et la retou-
che d’une photographie se jouent les
mêmes écarts qu’entre le maquillage et la
chirurgie d’un visage : le premier est une
modification de surface, un jeu de dessins
tégumentaires, tandis que la seconde est
une modification radicale plus profonde,
davantage réalité qu’illusion.
L’éphémère
du maquillage ■
Le maquillage est une modification
corporelle à part : il tient sa spécificité
des traces éphémères qu’il dépose sur le
visage. Écriture sans cesse renouvelée sur
le parchemin tégumentaire, le maquillage
s’inscrit dans une esthétique du renou-
vellement.
Chaque jour, un visage se dessine sur
le visage originel, s’y superpose avant
d’être effacé. La femme se donne à voir
à travers un masque éphémère qui se fait
et se défait, paraît et disparaît, infiniment.
La spécificité du maquillage à l’égard
d’autres inscriptions corporelles, tient
de ce schéma geste-trace-geste inédit,
déjà défini par Jean-Thierry Maertens
dans Le dessein sur la peau. « De toutes
les inscriptions corporelles connues, le
maquillage est la seule qui non seulement
s’efface mais que l’on efface sciemment
dans un nouveau rite d’après-trace, le
démaquillage. […] Au schéma geste-trace
caractéristique des autres inscriptions
tégumentaires, le maquillage oppose le
schéma geste-trace-geste »
10
. Le carac-
tère éphémère de la trace peinte engendre
la nécessité d’une reconnaissance immé-
diate par l’Autre car l’identité créée n’a
de sens que dans son regard et à l’instant
présent : bientôt le masque de fards glis-
sera hors du visage et ne sera plus que
souvenir. Chaque soir effacé inlassable-
ment chaque matin il renaît.
Pour bien des femmes interrogées,
la séance de maquillage représente une
étape quotidienne appréciée qui ne sau-
rait être supprimée : elle ne constitue en
rien une journalière corvée mais bien un
plaisir solitaire dont elles ne sauraient se
passer. Il s’agit de substituer au visage
nocturne et secret son noble double, ce
visage diurne et remodelé. Le déma-
quillage d’ailleurs parfois est évoqué à
la manière d’un étrange dépouillement,
car il signe la perte temporaire de cette
parure de fards à fleur de peau. Il est
effacement du visage dessiné, si bien que
la femme démaquillée peut exprimer le
sentiment d’avoir perdu la face. Elle tend
alors à retracer sans relâche son visage
réinventé, réapparaissant dans le miroir
sous des traits enjolivés : chaque jour elle
se recrée et, soulagée, se retrouve à tra-
vers une image d’elle perfectionnée, aux
contours accentués. Se fardant chaque
matin, elle se réapproprie son visage et
émerge ainsi doucement du sommeil qui
engloutit le corps. Le visage quotidien-
nement est redessiné ; c’est ainsi qu’il se
reconnaît en son reflet.
Puisque le maquillage est recons-
truction perpétuelle de soi, le rejet du
maquillage permanent s’envisage aisé-
ment. Les femmes interrogées tendent
majoritairement à s’opposer à ce type de
parure (tatouage des lèvres, des sourcils,
teinture des cils…) : “Je ne veux rien
de définitif” ( Joëlle), “Je préfère lar-
gement recommencer chaque jour à me
maquiller plutôt que d’être prisonnière
d’un visage”(Sarah). Rejeter le maquilla-
ge permanent, c’est se raccrocher à la
spécificité du maquillage, modification
éphémère et malléable : revêtir un mas-
que statique et indélébile serait perdre
la faculté de jouer avec son visage. Se
laisser dessiner un visage serait se perdre
derrière les traits grossiers d’un masque
esquissé par un étranger. Le tatouage
des lèvres ou des yeux serait atteinte à la
liberté d’expression et à la réappropria-
tion corporelle journalière que représente
le maquillage ; en ce sens, cette capti-
vité esthétique ne saurait être envisagée.
Le maquillage permanent devient geôle
symbolique en laquelle est conservée à
jamais le visage d’un instant, d’un autre
temps, figé pour l’éternité.
« La “ligne” vise l’instant (le regard)
ou se place dans un espace de temps bref.
Le résultat souhaité est visible, pres-
que immédiat. C’est également quelque
chose d’éphémère qu’il faut sans arrêt
remodeler : […] un maquillage doit être
recommencé chaque jour »
11
. La femme
fardée se redessine perpétuellement dans
un culte cosmétique quotidien : elle fait et
RSS33.indb 52 25/04/05 14:56:02

5353
défait son image ; elle sculpte son visage
mais son œuvre est brève et périssable,
destinée à disparaître chaque soir pour
réapparaître aux lueurs de l’aube.
Pile ou face : du visage
brut au visage idéal ■
Si le maquillage est renaissance de
soi à travers un visage quotidiennement
redessiné, il est aussi construction fantas-
magorique d’une image idéale
12
: trans-
formant minutieusement ses traits, la
femme maquillée avoue tendre vers une
certaine représentation de la perfection.
Elle efface son visage brut derrière les
fards pour atteindre une figure imaginaire
idéalisée, jaillissant peu à peu des tou-
ches cosmétiques appliquées. « La séance
de maquillage se déroule tout entière sur
la scène de l’imaginaire. La souplesse
de l’usage du fard amène la femme à se
modeler un visage qui la rapproche un
peu de son idéal ».
13
Pour accéder à cet idéal, le maquillage
se fait stratégie : il s’élabore peu à peu, au
fil des rencontres et des regards, se cons-
truit par imitations, inspirations ; tour à
tour il met en valeur et dissimule, jusqu’à
faire naître cette harmonie vers laquelle
éperdument il tend. Dès les prémices du
maquillage, la femme devient artiste, tra-
vaillant de ses mains son visage devenu
support artistique, esthétique. S’inspirant
du monde et des figures qui l’entourent,
elle tend à se modeler un visage idéal, un
masque de beauté. Ses sources d’inspira-
tion papillonnent autour d’elles – mères,
sœurs, amies, collègues – avant de venir
lentement se poser sur sa figure offerte.
Le maquillage se forme et se trans-
forme à partir de parcelles d’autres
maquillages qui se fondent jusqu’à ne
plus pouvoir s’extirper du nouvel ensem-
ble visagier ainsi créé. Comme le peintre
mélange sur sa palette les teintes et les
couleurs pour obtenir l’accord parfait, la
femme fardée mélange les éléments de
divers maquillages entrevus pour créer
un maquillage personnel et harmonieux :
parmi les enquêtées, certaines d’ailleurs
évoquent le visage à la manière d’« une
toile de fond » (Joëlle) dont elles endui-
sent la surface pour ensuite pouvoir tra-
vailler le matériau cosmétique. D’abord
primaire et simpliste, le maquillage se
complexifie au fil du temps et des rencon-
tres : introduisant de nouveaux éléments
dérobés sur les visages côtoyés, il devient
addition d’une multitude de maquillages.
Dépouillé à ses débuts – soulignant dis-
crètement le regard – au fil des années
il évolue, ajoutant au seul mascara des
touches de fards à joues ou d’ombres à
paupières, des traits d’eye-liner ou des
nuances de rouge-à-lèvres.
Chaque femme élabore sa propre
parure cosmétique. À portée de sa main
gravitent autant de composantes qui se
laissent docilement happer et s’unis-
sent en une combinaison achevée, en un
visage idéal. La femme inlassablement
peint ce portrait retouché sur la toile
vivante de son visage. Le maquillage
devient masque malléable dont elle peut
changer la forme, les couleurs, les tex-
tures et les détails pour l’ajuster aux
impératifs physiques qui la guident et la
contraignent. Le maquillage se construit
sur mesure : si la femme ne peut choisir
son visage, elle a néanmoins le pouvoir
de l’embellir à souhait. Ces lèvres fines
souvent citées et qui font le désespoir
de certaines, sous l’effet du rouge mira-
culeusement deviennent pulpeuses ; ces
yeux considérés trop ronds soudainement
d’un trait de crayon s’affinent jusqu’à
prendre cette forme d’amande que l’on
estime plus séduisante. Chaque enquêtée,
ainsi, conte son visage transfiguré à sa
manière, car chacune souhaite en accen-
tuer ou en dissimuler certains traits, dans
un ouvrage tout particulier. Cessant ainsi
d’être passive face au visage imposé, la
femme a désormais les moyens de se le
réapproprier.
Le maquillage est aussi l’art du voi-
lement et du dévoilement : il est trom-
pe-l’œil, jeu d’adresse, recherche d’un
équilibre entre mise en lumière et mise en
ombre. La plupart des femmes maquillées
tendent à accentuer leur regard : les yeux
sont envisagés comme siège de la rela-
tion, fenêtre ouverte sur l’âme et les sen-
timents. Ils s’ouvrent sur l’esprit, disent
l’inexprimable. Le maquillage illumine
le regard pour attirer sur lui l’oeil de
l’Autre.
Mais le maquillage n’est pas que
mise en valeur : il est aussi dissimula-
tion. Nombreuses sont les femmes qui
admettent ainsi masquer leur tégument
et ses imperfections : le fond de teint
uniformise la surface du visage, affine
le grain de la peau, efface ses défauts.
Car tout défaut tégumentaire est exprimé
comme une offense à la dignité du visage
dont il abîme l’ensemble et nuit à l’har-
monie : il reflète une part d’impureté qu’il
s’agit d’éliminer. Le maquillage vient
alors rehausser l’éclat du visage, masquer
les écueils de l’existence. Il voile tout
signe d’une vie «malsaine», estompe ces
malheureuses cernes qui disent la fatigue
et le manque de sommeil, gomme ces
navrants boutons qui à tout moment tra-
hissent mauvaise alimentation ou hygiène
défaillante ; la pâleur maladive – long-
temps associée à l’absence de fluide
vital – sous le blush se métamorphose
en vivante et vibrante couleur. En outre,
le maquillage efface les empreintes du
temps qui passe. Dans une société qui
rejette la vieillesse, la jeunesse perdue
se dissimule, déguisée sous des dehors
juvéniles plus valorisés : la ride toujours
effraye car elle est préfiguration de l’iné-
luctable vieillissement. Dans une culture
qui honore le beau et déconsidère le laid,
le maquillage vient soutenir l’embellisse-
ment corporel auquel, au sein de la gente
féminine, aspire une majorité
14
.
Le maquillage est un geste de nar-
cissisation par lequel la femme élabore
le visage idéal qu’elle souhaite donner
à voir aux autres. Accentuant ses atouts
naturels tout en estompant ses défauts
les plus flagrants, elle attire le regard sur
ces zones soulignées pour leur dignité et
leur esthétique supériorité : le maquillage
invite l’œil à s’attarder sur les plus nobles
détails du visage tout en le détournant de
ses disgracieux éléments. Il est un jeu
d’équilibre entre atténuations et d’ac-
centuations.
Le maquillage : une
mise en scène de soi ■
« La transformation de l’apparence
du visage, son embellissement rituel,
vise à favoriser la relation aux autres et
la reconnaissance pour la femme d’un
charme qui s’impose à elle comme un
devoir-être. En changeant le dessin des
traits et en leur adjoignant de minces
traces colorées, le maquillage modifie
leur tonalité, il adoucit ou durcit, voile ou
met en évidence. Ce faisant, il dispense
des touches non seulement sur le visage
Laurence Pfeffer Les dess(e)ins du visage féminin
RSS33.indb 53 25/04/05 14:56:03

54 Revue des Sciences Sociales, 2005, n° 33, “Privé – public : quelles frontières ?”
54
qu’il met en scène, mais aussi et sur-
tout sur l’image que la femme souhaite
donner aux autres »
15
. Le maquillage
est une savante mise en scène de soi : à
travers lui, la femme modèle son visage
selon l’image qu’elle souhaite offrir à
voir aux autres. Il se fait préparation
narcissique à l’interaction, identitaire
construction. Le maquillage du comé-
dien ne s’apparente-t-il pas d’ailleurs en
certains points au maquillage féminin ?
Cette dernière n’est-elle pas une actrice
sociale qui chaque jour en sa loge s’ins-
talle, endossant face au miroir le visage
du personnage qu’elle s’est lentement
créé et que quotidiennement elle remet au
monde ? « Cependant commence l’heure
du maquillage. En apparence, un geste
technique, une habileté ? Pas du tout.
C’est déjà l’épreuve. Tous les jours, les
comédiens vont d’abord s’effaçant dans
le miroir, se déconnaissant, se défaisant.
On ne doit plus se reconnaître. Cela
prend beaucoup de temps. Enfin, on n’est
plus là, et maintenant, dans la nuit de
l’imagination, on cherche le visage de
l’autre. Une heure, une heure et demie,
l’on nage dans cette nuit amniotique,
cherchant à amener à la lumière le nou-
veau-né, créant lentement le visage de
Toi. […] Il y a des maquillages ratés. […]
Qu’est-ce qu’un maquillage raté ? C’est
le dépouillement de soi qui n’a pas été
fait. “Moi”, dit encore le visage fardé.
Car il y a quelqu’un dans le comédien qui
refuse de s’en aller […]. Et le maquillage
réussi ? Il n’est plus. Le maquillage a dis-
paru. Un visage s’est formé sur l’ancien
visage. Le comédien est devenu quel-
qu’un. […] Alors le comédien peut être
fier de l’enfant qu’il a mis au monde et
qu’il est. Il sourit doucement pour saluer
l’apparition du nouveau-venu »
16
. De
l’univers théâtral à l’univers social, il n’y
a qu’un pas. À la manière du comédien,
le maquillage ordinaire raté alors est
conté par les enquêtées comme un déca-
lage entre la représentation imaginaire du
visage et sa triste réalité. L’artifice ne leur
offre pas cet autre visage vers lequel elles
tendaient mais leur renvoie une image
déformée, bien éloignée de cette perfec-
tion en l’esprit esquissé. Malgré l’apprêt,
l’on continue à avoir « une sale gueule »,
l’on « ne se plaît pas » : il n’est rien à
faire, le fard ne parvient à avoir raison
de ce visage déplaisant que l’on aimerait
aujourd’hui plus que jamais effacer. Il
y a déception dès que les modifications
cosmétiques ne renforcent pas l’identité
mentalement construite. Le maquillage
réussi, quant à lui, est évoqué par les
femmes interrogées comme l’élaboration
d’un visage parfait, ressemblant au visage
désiré : il glisse l’être paré dans la peau
de son double idéalisé, sans décalage ni
délai. Et alors, dans le reflet, tout sim-
plement l’on se plaît : rien dans la réalité
du visage ne vient entacher ce à quoi en
l’imaginaire l’on aspirait.
Au fil de l’existence, malgré d’im-
mobiles apparences, le maquillage ne
cesse de recouvrir de nouveaux sens. À
l’aube de la vie, il s’élabore lentement
jusqu’à devenir mise en scène d’une
féminité naissante. Mais au soir de la
vie, il devient restauration de soi et de la
jeunesse enfuie.
À l’adolescence, nombreuses sont
celles qui entreprennent de se maquiller
pour approcher les emblèmes féminins
et leur ressembler, trichant avec l’âge par
l’artifice du maquillage. Instrument de la
femme-enfant, il est ce masque derrière
lequel se cache un visage encore enfantin
qui se laisse entrevoir sous des traits plus
féminins. La transition de l’adolescence
à la féminité peut se servir du maquillage
mais rarement elle est aisée ou spontanée :
« Je me maquillais en cachette de mes
parents, parce que je le faisais le temps
de l’internat, de la semaine. Le diman-
che, je ne me maquillais pas à la maison,
mes parents n’en savaient rien » (Joëlle).
À l’internat, le maquillage souligne la
rupture familiale, l’indépendance, le che-
minement vers la féminité ; de retour au
foyer parental, le démaquillage ramène
l’adolescente, lui restituant son visage
naturel. Deux faces alors s’affrontent, qui
disent les ambiguïtés de l’adolescence,
le déchirement entre enfance et monde
adulte.
Au-delà de la mise en scène d’une
féminité encore en construction, le
maquillage peut agir comme une res-
tauration du visage : pour les plus âgées
parmi les femmes interrogées, il permet
d’effacer ces rides que les années douce-
ment ont creusées. Le maquillage devient
extériorisation d’une crainte grandissante
des sociétés occidentales : les hommes,
apeurés devant la mort, rejettent toute
trace de vieillissement
17
. Le visage est
livré à un impératif de jeunesse auquel il
parvient par l’intermédiaire du maquilla-
ge, devenu instrument d’effacement de
l’empreinte temporelle. Les produits cos-
métiques symbolisent cette lutte contre
le vieillissement « soit par effacement
pur et simple des signes de la décré-
pitude, soit par tendance à remplacer,
dès la jeunesse, le visage, futur jouet du
flétrissement, par une espèce de masque
fixe et séparé du temps, attirant comme
la plus gracieuse de toutes les statues,
mais intangible comme une idole »
18
.
Au fil de l’existence, le maquillage peu à
peu devient préservation de l’apparence.
La vieillesse qui se laisse voir effraye
quiconque l’observe car elle est le reflet
de son propre devenir, de son visage dans
l’avenir.
Le maquillage est cet enduit destiné à
restaurer le visage perdu de la jeunesse ; il
« étale son eau de jouvence sur le visage,
il manipule le temps et la chair »
19
. Il
consiste en une mise en scène cosméti-
que par laquelle enfin la femme renaît et
se reconnaît sous des traits rafraîchis et
renouvelés : le visage fané doit s’effacer
pour laisser paraître le visage d’autre-
fois.
20
.
Machine à remonter le temps, le
maquillage recueille dans le passé le
visage antérieur pour le reconstituer
dans le présent, pour modeler le visage
d’aujourd’hui sur le souvenir de son
double juvénile. Il rend à la femme l’il-
lusion de sa jeunesse : « Peut-être qu’on
essaye de retrouver le physique de ses
20 ans, d’utiliser le maquillage pour
effacer les traces du temps » (Marlène),
« pour essayer de retrouver la jeunesse
qu’on n’a plus » (Mireille). Le maquilla-
ge donne les moyens, aussi illusoires
soient-ils, de restaurer les traits abîmés :
il est dissimulation, restauration ; il est ce
masque qui cache le visage vieillissant
tant redouté, tant rejeté. « Et sans doute
le maquillage est-il toujours une restau-
ration de l’image de soi accomplie dans
l’imaginaire »
21
.
Du visage intime
au visage social ? ■
« La face est physique, donc per-
sonnelle, et pourtant elle est parfois
maquillée, parée, esclave de la mode. Elle
est publique mais également profondé-
ment privée et intime »
22
. Le maquillage
RSS33.indb 54 25/04/05 14:56:05
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%