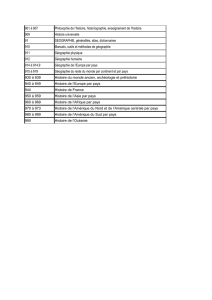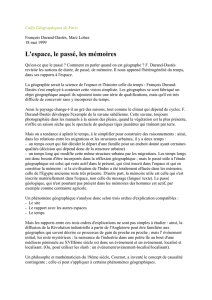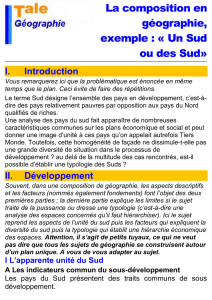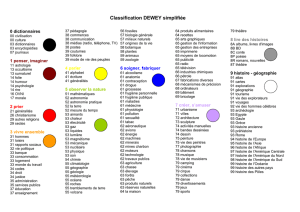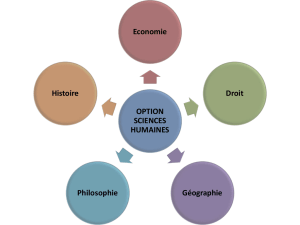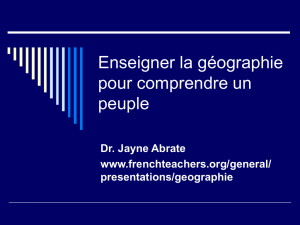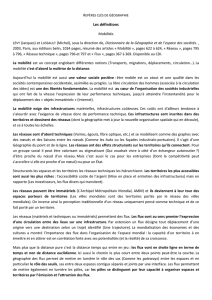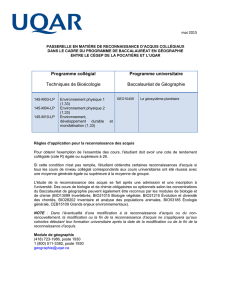L`idéologie du territoire en géographie : incursions féminines dans

L’idéologie du territoire en géographie : incursions féminines dans
une discipline masculiniste
Claire Hancock
maîtresse de conférences en géographie, université Paris-XII-Val-de-Marne
groupe de recherche ATIR (Acteurs Territoires Identités Représentations)
La présence des femmes en géographie est-elle une anomalie ? La sagesse populaire, diffusée
par de nombreuses publications de vulgarisation, atteste du fait que « les femmes ne savent
pas lire les cartes », que leurs « aptitudes spatiales » sont bien moins développées,
naturellement, que celles des hommes1. Sûrement, alors, ces femmes qui insistent pour faire
de la géographie vont contre la nature, s’aventurent dans un domaine que biologiquement
elles ne sont pas équipées pour aborder ? Il me semble plutôt que c’est la construction même
de ses méthodes et concepts-clé qui fait de la géographie un « territoire » masculin dans
lequel les femmes peinent à se faire une place.
Je partirai ici d’une note récente de Numa Broc dans cette institution de la géographie
française que sont les Annales de Géographie2. Cette note intitulée « Géographie au féminin :
les premières collaboratrices des Annales de Géographie (1919-1939) » n’a en apparence rien
que de très descriptif, il s’agit d’une histoire de la percée progressive des femmes dans la
géographie française dans l’Entre-deux-guerres, d’un constat très neutre de leur faible
représentation dans la publication étudiée ; mais elle se termine par une question très
rhétorique : « On pourrait enfin se demander s’il existe une façon féminine de faire de la
géographie ». A quoi l’auteur répond : « Un examen assez attentif des textes, nous a montré
que les géographes françaises se sont parfaitement coulées dans le moule vidalien, et l’on
chercherait en vain chez elles une manière spécifique de choisir des sujets et de traiter les
problèmes géographiques »3.
Je ne doute pas un seul instant que l’auteur de la note, en s’intéressant à la présence des
femmes en géographie, ait voulu faire œuvre utile. Je voudrais montrer, en m’appuyant sur
1 Voir par exemple A. et B. Pease, 2001, ou l’analyse plus scientifique de Eleanor MacCoby et
Carol Jacklin, 1986.
2 Revue qui, en ce début 2002, réalise l’exploit de ne toujours compter aucune femme ni dans son
comité de rédaction, ni parmi ses correspondants étrangers.
3 Annales de Géographie n°618, 2001, p. 180.
les travaux de géographes anglophones comme Liz Bondi et Mona Domosh, quels sont les
présupposés criticables sur lesquels repose sa réflexion. Je soulignerai ensuite un certain
nombre de traits de la pratique géographique contemporaine qui me semblent relever d’un
biais masculiniste4, et j’essaierai de montrer pourquoi la notion même de territoire me paraît
suspecte de ce point de vue.
une « géographie au féminin » ?
Le fait de s’intéresser à la présence (numérique) des femmes dans une profession donnée
reflète des préoccupations qui ont pu être celles du féminisme « libéral » (Bondi-Domosh),
qui conçoit la sous-représentation ou l’absence des femmes des sphères du pouvoir (ou, en
l’occurrence, du savoir) comme étant le problème principal dans l’inégalité des sexes. Cette
façon de voir ignore de ce fait l’ensemble des pesanteurs sociales qui font que la parité en
droit reste souvent théorique si les schémas culturels dominants font des positions de
pouvoir et d’autorité des attributs spécifiquement masculins, que les femmes, par auto-
censure, parce qu’elles sont éduquées d’une certaine façon, ne brigueront pas, ou brigueront
en nombre bien moins élevé que les hommes. Dans les termes de Bondi et Domosh, cette
position revient à ignorer la façon dont pouvoir et autorité sont construits socialement, sur
des bases essentiellement masculines.
Décrire la lente arrivée des femmes dans la géographie française sans soulever la question
des pesanteurs, des réticences qu’elles ont pu rencontrer, c’est donc occulter un aspect
essentiel, et laisser à penser que leur absence ne relevait que d’un hasard malheureux. En
outre, présenter l’accès de la première femme (Jacqueline Beaujeu-Garnier) à un poste
d’assistante à la Sorbonne en 1942 comme la fin du « dernier verrou », comme le fait N. Broc,
relève d’un optimiste démesuré. L’édition 2002 du Répertoire des géographes français comporte
moins d’un tiers de notices de femmes (31,3%)5, et nul doute que les données concernant les
professeurs d’université ou les directeurs de recherche reflèteraient une présence encore bien
moindre.
4 Suivant Michèle Le Dœuff et Gillian Rose (1993, p.4) , je définirai comme « masculiniste » un travail
qui « tout en se prétendant exhaustif, omet l’existence des femmes et ne s’occupe que de la position
des hommes ».
5 Le Répertoire des géographes français 2002, édité par l’UMR 8586 du CNRS (PRODIG, Pôle de
Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique) recense les géographes
enseignants-chercheurs dans le supérieur, chercheurs, enseignants du secondaire ou des
professionnels qui pratiquent la recherche ou des activités d’animation scientifique en géographie.

Le deuxième point a trait à la pratique scientifique que pouvaient avoir des femmes dans la
période de l’entre-deux-guerres : il ressort clairement de témoignages comme celui de
Simone de Beauvoir6 qu’une femme, si elle voulait avoir la moindre chance de se voir
reconnaître sur le plan scientifique, n’avait d’autre choix que de se « couler » très
scrupuleusement dans les moules de sa discipline, et ce avec une rigueur bien plus absolue
que ses collègues masculins — parce qu’une femme serait suspecte, de par son sexe, de
frivolité, de légèreté, de manque d’application, et toutes les autres infériorités que les
autorités auraient trouvé bon de lui prêter. Comme l’écrivent Bondi et Domosh, parce que le
sujet géographique est implicitement masculin, les femmes ne peuvent prendre la parole et
se faire entendre en géographie qu’en reniant ce qui fait leur différence d’avec les hommes.
Tenir un discours différent reviendrait à s’exclure du domaine scientifique, travailler sur des
objets non validés et par des méthodes non conventionnelles exposerait à l’isolement et à la
non-reconnaissance. S’étonner de la conformité, voire du conformisme des femmes, c’est
ignorer la contrainte, souvent inconsciente, qu’elles ont pu ou peuvent subir, au même titre
d’ailleurs que d’autres originalités.
Faut-il d’ailleurs nécessairement supposer qu’il y aurait une originalité féminine à exprimer
en l’absence d’une telle contrainte ? En fait, comme le soulignent Bondi et Domosh, un
féminisme « radical » a pu prétendre qu’existaient deux types de savoir, l’un masculin,
l’autre féminin : il s’agissait d’affirmer que la pensée masculine, qui s’était arrogé
l’exclusivité du statut de sujet rationnel, n’était qu’une des modalités possibles de la pensée.
Or il semble qu’on ne peut guère souscrire à cette idée d’un type de savoir féminin
spécifique, qu’on pourrait opposer au savoir masculin, parce qu’elle postule que la division
homme/femme est primordiale et fondamentale et aussi parce qu’elle renvoie, de façon
inquiétante, à la construction de l’« éternel féminin », ces idiosyncrasies féminines qui ne
peuvent manquer d’affecter leur façon de penser. Comme le rappellent Bondi et Domosh, la
psychanalyse a bien montré que la division masculin/féminin, sur le plan psychique, n’a rien
de si primordial ; abondant dans ce sens, Valentine souligne que la catégorisation biologique
par sexes, outre qu’elle relève pour une part de l’arbitraire, n’a pas de lien nécessaire avec le
« genre » et les constructions sociales masculin/féminin (qu’on peut dater historiquement
dans la culture occidentale).
le paradoxe du géographe : entre mise à distance et implication
6 Voir par exemple Le Deuxième Sexe, 1949, ou les Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958.
On peut considérer cependant que ces constructions sociales du masculin et du féminin ont
été mises en œuvre, de façon inconsciente, dans la conception de la discipline géographique.
Dans le couple mythique de la géographie, l’Homme et la Terre, l’Homme en question n’est
certes pas l’être humain quel qu’il soit, mais bien son avatar masculin ; l’élément féminin
n’est nullement absent de ce couple, puisque la Terre, féconde et passive, attendant d’être
connue, conquise et fécondée, se voit dotée de toutes les qualités symboliquement associées à
la féminité. La construction des lieux comme allégories féminines (Marianne, ou les statues
de femmes nues représentant les villes de France sur les gares…) est caractéristique de cette
pensée : la mère-patrie, la nation, sont représentées comme des corps féminins que les
hommes ont pour tâche de préserver dans leur pureté, inviolées7.
Le sujet de la connaissance en géographie doit se doter de qualités dont se prévaut le sujet
masculin, en s’identifiant comme regard désincarné, distancié, seul capable d’objectivité
scientifique (par opposition aux défauts associés au féminin, corporel, émotionnel, subjectif)8.
Cette construction du sujet rationnel des Lumières a pris un visage particulier en géographie,
qui s’est donné pour tâche la description exhaustive du monde d’une façon qui l’a rendue
complice de l’européocentrisme et du colonialisme : la géographie, science de la conquête et
de l’appropriation de l’espace, était marquée dans sa conception même par un biais sexué.
Les sociétés de géographie refusent longtemps de reconnaître qu’un récit de voyage écrit par
une femme puisse avoir valeur de contribution scientifique et ne les admettent pas comme
membres9. La découverte et la domestication de « terres vierges » se raconte sur un mode
héroïque, qui met en valeur non seulement l’avancée de la « civilisation » dans une nature
sauvage féminisée, mais aussi le plaisir viril de la pénétration et de la possession10.
Ce qui est frappant en géographie, c’est la façon dont les pratiques et discours des chercheurs
actuels tardent à se défaire de la fiction du sujet objectif, tendent même dans certains cas à se
crisper sur elle ; le géographe persiste à se présenter comme pur esprit et pur regard, alors
même que d’autres disciplines des sciences humaines reconnaissent la part de la positionalité
dans la constitution des savoirs. Non seulement la dimension physique du sujet géographe
est généralement occultée, mais il ne prendra guère la peine de dire qui il est et d’où il parle :
7 Voir Nast, 1998, p. 195.
8 Voir Bondi et Domosh, 1992.
9 Rose, 1993, p. 9.
10 Voir par exemple Peter Jackson, 1989, rendant compte des travaux de d’A. Kolodny (p. 109) : « …
the New World was consistently envisaged as a source of male gratification, a virgin land to be tamed
if not wilfully violated by the forces of male aggression. »

il peut paraître paradoxal que le géographe n’intègre pas cette interrogation sur la
position/la localisation du lieu de production du savoir11.
La discipline cultive un certain nombre de techniques de mise à distance de ses objets,
destinées à nier l’implication personnelle, tout en plaçant le chercheur dans la position
conventionnelle d’un Dieu omniscient et détaché : la carte est bien sûr un des plus
traditionnels outils dont dispose le géographe pour distancier et normer son propos sur
l’espace, l’utilisation de l’image fixe ou mobile (photo aérienne, panorama, film
documentaire…) en est un autre. L’arsenal s’est enrichi avec la diffusion en géographie des
analyses quantitatives et de la modélisation, et on peut voir dans les SIG (Systèmes
d’Information Géographique), leur utilisation d’images satellitaires, et le grand
enthousiasme qu’ils suscitent, le dernier avatar de ce positivisme anachronique.
On peut se demander dans quelle mesure de telles techniques sont nécessaires au géographe
afin de se défendre des effets déstabilisants pour sa subjectivité de la pratique de la
discipline. En effet, l’envers de toutes ces techniques de mise à distance (de mise à l’abri du
sujet), c’est l’implication personnelle du chercheur, souvent piégé par l’inévitable
« immersion » dans ce qu’on appelle son « terrain »12. Alors que le géographe est souvent
« nomade », pris entre deux univers de références contradictoires, au lieu d’utiliser cette
position d’entre-deux , il va prétendre, à son retour, n’avoir pas été modifié par l’expérience
qu’il a faite d’un « ailleurs ». Paradoxalement, pour une discipline qui dispose de tant de
méthodes de mise à distance, un des modes de légitimation du discours en géographie, c’est
d’être parti loin, s’être mis en danger (parfois physiquement), s’être confronté à l’ « Autre » :
comme le souligne F. Driver, le savoir géographique est constitué par le biais d’une
implication physique13. Le « terrain » lointain joue un rôle de validation scientifique, et
comme en Nouvelle-Zélande14, le travail empirique est masculinisé, la théorie féminisée :
tout se passe comme si c’était par la confrontation au féminin de la « nature » ou de
l’ « ailleurs » bruts, offerts à ses instruments de connaissance, que le géographe se valide
comme pleinement masculin.
Dernier point qui évoque pour moi une crispation sur un territoire disciplinaire, la façon
dont certains géographes défendent jalousement ses limites disciplinaires ; le couperet « ce
n’est pas de la géographie » tombe avec une grande facilité sur ceux dont les travaux ne se
conforment pas au modèle empirique/technicien, adoptent des méthodes plus qualitatives,
11 Voir Christine Chivallon, 2001.
12 Voir le chapitre d’Anne Volvey, 2000.
13 Felix Driver, 2000.
14 Berg, 1994.
se soucient d’élaboration théorique ou flirtent dangereusement avec les sciences sociales. Ce
que je voudrais montrer maintenant, c’est qu’y compris parmi ceux des géographes qui
défendent l’idée que la géographie décrit des espaces « perçus » ou « vécus », et non
seulement les espaces abstraits de la carte et de l’image satellitaire, le biais masculiniste
existe également.
masculinisme de la géographie humaniste
En fait, mon analyse de la géographie française rejoint celle que propose Gillian Rose de la
géographie de langue anglaise : pour elle, les hétérosexuels blancs de classe moyenne
qu’attire la géographie projettent sur leur objet tout ce qu’ils nient chez eux, ce qui relève du
physique, de l’émotionnel, de la passivité et de l’irrationnel. Affirmer la neutralité de son
regard, c’est se nier comme sujet sexué, et à la fois construire un « Autre » féminin auquel on
s’abstient de faire référence tout en prétendant produire une science universelle : ce point de
vue est celui de la géographie de l’espace (et renvoie à ce que Gillian Rose appelle
« masculinité social-scientifique »).
Il existe une autre modalité masculiniste, que Gillian Rose qualifie de « masculinité
esthétique » qui privilégie l’expérience sensible du géographe, et féminise l’objet de cette
expérience (la nature, la terre, mais aussi le lieu, le territoire). Dans les géographies de langue
anglaise, c’est le lieu, « place », qui fait l’objet de cette idéalisation et de cette « extase
connaissante » du sujet masculin15. On peut en trouver un parallèle français dans le texte
classique d’Eric Dardel, L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique, paru en 1952 :
L’homme cherche la Terre, il l’attend et l’appelle de tout son être. Avant même de l’avoir
rencontrée, il va au-devant d’elle et la reconnaît.(…) Ce que l’homme cherche ainsi dans la
Terre, c’est un « visage », un certain accueil. C’est pourquoi il exprime sa déception
quand elle ne lui tend que la pure objectivité d’un existant brut. (p. 60)
Dans sa conduite et dans sa vie quotidienne, dans une sagesse laconique toute chargée
d’expériences, l’Homme manifeste qu’il croit à la Terre, qu’il se confie en elle ; qu’il
compte absolument sur elle. C’est là, dans son horizon concret, qu’une adhérence
presque corporelle lui assure son équilibre, sa norme, son repos. (p. 128)
15 « Place is the feminized Other, idealized as Woman, and discussed as lost mother – place is
mysterious, unknowable, feminine » : Richard Peet, 1999, rendant compte des travaux de Gillian Rose,
p. 286.

Au-delà de l’anthropomorphisme, c’est bien une relation érotisée, la relation d’un sujet
masculin à une terre féminisée, qui prend même une figure maternelle, qui se fait jour ; pour
ces géographes œdipaux, la terre est une femme qu’on habite.
La construction de la notion de « territoire » offre un parallèle de la construction du « lieu »
par les géographes humanistes anglophones : c’est le terme qu’on utilise pour parler
d’espaces appropriés symboliquement et matériellement, investis de sens par les sociétés qui
les habitent et s’y identifient. On n’est plus ici face à l’espace abstrait des sigologues, il s’agit
d’une approche qui valorise l’expérience individuelle et sociale de l’espace ; mais les
expériences à partir desquelles elle se construit sont, me semble-t-il, des expériences
exclusivement masculines. J’en prendrai pour exemple l’ouvrage de Guy Di Méo, Géographie
sociale et territoires (Nathan, 1998) : la quatrième de couverture annonce clairement le propos,
« vécu tout autant que produit, le territoire traduit (…) le lien primordial de l’Homme et de
la Terre ». Cet « Homme » doté d’une majuscule est-il, en 1998, moins masculin et plus
inclusif de l’ensemble du genre humain que ses prédécesseurs en géographie ? Nullement,
puisqu’il n’est pas fait une référence aux possibles différences de genre dans les relations au
territoire ; si le travail de Doreen Massey est brièvement cité (p.6), la préoccupation du genre
qu’elle associe, dans son travail, à celle de l’expérience du lieu n’est jamais évoquée16.
Il me semble que la construction de la notion de territoire que propose Guy Di Méo,
prétendûment asexuée, universelle, reproduit le biais masculiniste de la discipline, comme
beaucoup des travaux se référant à la phénoménologie. On peut s’étonner que le recours
qu’il fait à l’éthologie (la territorialisation animale) ne lui ait pas inspiré de se poser la
question de la différence de comportement entre mâles et femelles d’une même espèce17. On
se trouve ici face à un cas de ce que J.-L. Piveteau appelle la bibliographie « en creux » sur la
dimension sexuée de la territorialité, ces « textes de géographie sociale dont on attendrait
qu’ils abordent le sujet et qui n’en soufflent mot »18.
Face à de tels exemples, on est amené à se demander si la notion même de territoire n’est pas
intrinsèquement masculine, et si les relations aux lieux décrites par la géographie humaniste
ne dérivent pas de préoccupations propres au sexe masculin. J.-L. Piveteau a montré en quoi
16 En outre, les travaux de Jacqueline Coutras, qui a été une des premières et reste l’une des seules
géographes françaises à placer la question du genre au centre de sa réflexion (voir par exemple 1996)
ne sont jamais cités et ne figurent pas en bibliographie, alors même que le chapitre de G. Di Méo sur
« les fondements humains de la territorialité », et particulièrement sur « la maison », aurait pu s’en
enrichir considérablement.
17 Le manuel de Gill Valentine, Social Geographies (2001), offre un contraste frappant avec celui de Di
Méo.
18 Jean-Luc Piveteau, 1996, p. 70.
la territorialisation est un « corrélat de longue durée de la sexuation » ; il postule cependant
une « identité de réactions fondamentales, chez l’homme et chez la femme, face au
territoire », une identité également des « expériences de relation aux paysages », sans étayer
un tel postulat, qui paraît criticable19. Je ne dispose que de bribes d’éléments de réflexion là-
dessus, comme par exemple l’étude empirique d’une anthropologue de Toulouse qui montre
la propension des hommes à s’enraciner dans le lieu, alors que les femmes préservent la
mémoire des personnes plus que des lieux ; elle conclut : « Les hommes, ce n’est plus à
démontrer, se veulent les garants zélés de l’attache au sol. Reste à vérifier si la mémoire
déclinée au féminin est compatible ou pas avec le principe de l’enracinement. Sa perméabilité
à l’oubli nous donne a priori toute licence pour répondre par la négative »20.
Il me semble également que ce n’est pas un hasard si Rosi Braidotti place la figure du
nomadisme au cœur de sa réflexion sur le féminisme contemporain21. Cette réflexion sur les
identités féminines réunit en tout cas suffisamment d’indices concordants pour s’inscrire en
faux contre la proposition universalisante de Di Méo, « nous retenons pour principe qu’il
n’existe pas d’individu ou de groupe social, à l’un quelconque des âges de l’humanité, qui
n’ait (sic) échappé, dans la logique même de son procès vital, au principe de territorialisation
tel que nous allons l’aborder dans cet ouvrage » (p. 12). Est-ce qu’une telle proposition ne
reviendrait pas à faire du « territoire » un nouveau méta-récit de la géographie ?
Je l’ai dit, il n’y a sans doute pas de façon « féminine » de faire de la géographie qu’on puisse
opposer à une façon « masculine ». Il y a cependant une construction masculiniste du sujet
de la connaissance en géographie que tous les praticiens de la discipline, hommes ou
femmes, gagneraient sans doute à interroger. Si je devais proposer quelques pistes
permettant à la géographie de dépasser ce biais masculiniste, je suggèrerais d’abord qu’on
renonce à la fiction selon laquelle la géographie se préoccupe des relations entre « l’Homme
et son Milieu » ou « l’Homme et la Terre » — qu’on renonce à toutes ces majuscules
objectivantes qui symbolisent bien les travers universalisants de la géographie, depuis ses
productions les plus classiques jusqu’à ses flirts récents avec la philosophie et la
19 Jean-Luc Piveteau, 1996.
20 Sylvie Sagnes, 2000, p. 160.
21 Rosi Braidotti, 1994, « As far back as 1938 Virginia Woolf was raising the issue : « As a woman I
have no country, as a woman I want no country, as a woman my country is the whole world ». The
identification of female identity with a sort of planetary exile has since become a topos of feminist
studies » (p. 21).

phénoménologie. Je demanderais un examen de conscience honnête à tous ceux qui utilisent
les notions de « paysage » ou de « territoire », qui les amènerait à préciser leur position et
leur rôle personnel dans la construction de ces notions : parce que le géographe appartient à
la catégories des « experts » investis d’une certaine autorité, il ne peut ignorer le fait qu’il
contribue à faire exister ce qu’il décrit. La géographie la plus intéressante qui se pratique à
l’heure actuelle, à mon sens, celle qui réussit à communiquer avec les autres sciences
humaines et sociales, est celle qui reconnaît comme son objet les relations sociales, les enjeux
de pouvoir, d’identité, tout en gardant comme entrée principale dans ces questions les
traductions spatiales des processus.
Note : je tiens à remercier ceux de mes collègues qui m’ont fait part de leurs remarques sur
une version précédente de ce texte, notamment E. Jaurand, G. Palsky et A. Volvey, les
organisateurs et participants du colloque qui ont manifesté leur intérêt, notamment V.
Veschambre, et enfin J. L. Piveteau qui a eu la gentillesse d’accepter d’échanger des idées
avec moi sur ces questions.
Références bibliographiques
BERG, Lawrence D., « Masculinity, Place and a Binary Discourse of ‘Theory’ and ‘Empirical
Investigation’ in the Human Geography of Aotearoa/New Zealand », pp. 245-260 in Gender,
Place and Culture, vol. 1, n°2, 1994
BONDI, Liz, Mona DOMOSH, « Other figures in other places : on feminism, postmodernism
and geography », in Environment and Planning D : Society and Space vol. 10, 1992 (traduit en
français par D. Ganderton, in J. F. S
TASZAK (ss dir.), Géographies anglo-saxonnes. Tendances
contemporaines, pp. 63-79, Belin, 2001).
BRAIDOTTI, Rosi, Nomadic subjects. Embodiment and sexual difference in contemporary feminist
theory. New York , Columbia University Press, 1994.
BROC, Numa, « Géographie au féminin : les premières collaboratrices des Annales de
Géographie (1919-1939) », pp. 175-181 in Annales de Géographie n°618, 2001.
CHIVALLON, Christine, "Fin des territoires ou nécessité de conceptualisations autres ?",
Géographie et cultures, n°31, 1999.
CHIVALLON, Christine, « Les géographies féministes. Un plaidoyer convaincant pour la
constitution de connaissances ‘situées’ », pp. 57-62 in J.-F. STASZAK (dir), Géographies anglo-
saxonnes. Tendances contemporaines. Belin, 2001.
COUTRAS, Jacqueline, Crise urbaine et espaces sexués. Armand Colin, 1996.
DARDEL, Eric, L’homme et la terre. Nature de la réalité géographique. PUF, 1952.
DI MEO, Guy, Géographie sociale et territoires. Nathan, 1998.
DRIVER, Felix, « Fieldwork in geography », pp. 267-268 in Transactions of the Institute of British
Geographers, vol. 25, n°3, 2000.
JACKSON, Peter, Maps of Meaning. Londres, Routledge, 1989.
MACCOBY, Eleanor, Carol JACKLIN, « La psychologie des différences de sexe », pp. 117-143 in
M.-C. HURTIG et M.-F. PICHEVIN, La différence des sexes. Tierce, 1986.
MASSEY, Doreen, Space, Place and Gender. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994.
NAST, Heidi, « Unsexy Geographies », pp. 191-206 in Gender, Place and Culture, vol. 5, n°2,
1998.
PEASE, Allan et Barbara, Why men don’t listen and women can’t read maps, Orion, 2001.
PEET, Richard, Modern Geographical Thought. Oxford, Blackwell, 1998.
PIVETEAU, Jean-Luc, « Notre territorialité n’est-elle pas essentiellement masculine ? », pp. 69-
80 in Géographie et cultures n°20, 1996.
ROSE, Gillian, Feminism and Geography : the Limits of Geographical Knowledge. Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1993.
SAGNES Sylvie, « L’enracinement ou l’œuvre mémorielle des sexes », pp. 153-162 in M.
MEMBRADO, A. RIEU (ss dir), Sexes, espaces et corps. De la catégorisation du Genre. Toulouse, ,
éditions universitaires du Sud, 2000.
VALENTINE, Gill, Social Geographies. Space and Society. Harlow, Prentice Hall, 2001.
VOLVEY, Anne, « L’espace, vu du corps », pp. 319-332 in J. LEVY, M. LUSSAULT (ss dir.),
Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy. Belin, Mappemonde, 2000.
1
/
5
100%