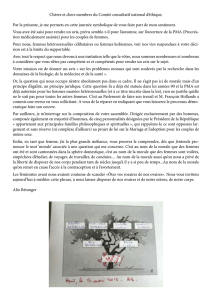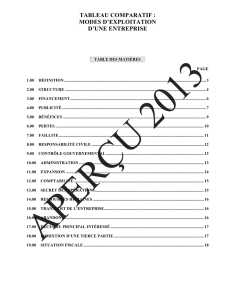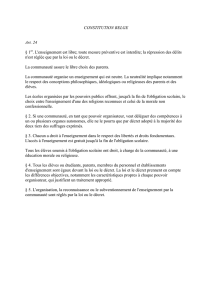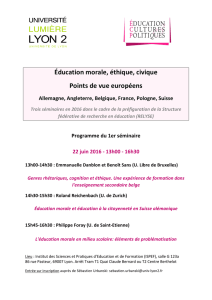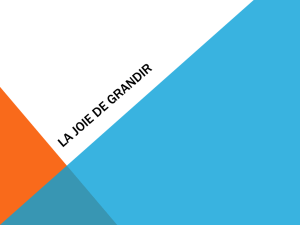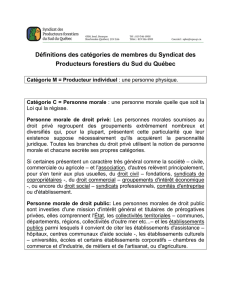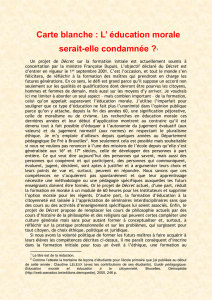économie morale » et protestation

« ÉCONOMIE MORALE » ET PROTESTATION - DÉTOURS AFRICAINS
Johanna Siméant
Belin | Genèses
2010/4 - n° 81
pages 142 à 160
ISSN 1155-3219
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-geneses-2010-4-page-142.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siméant Johanna, « « Économie morale » et protestation - détours africains »,
Genèses, 2010/4 n° 81, p. 142-160.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin

Johanna Siméant « Économie morale » et protestation – détours Africains
Dans les études africaines, en histoire et
en science politique singulièrement, le
concept d’«économie morale» semble incon-
tournable. Cette faveur y est d’ailleurs anté-
rieure au regain d’intérêt généralisé pour le
terme. Autre curiosité: alors que ce concept
est généralement ignoré des travaux mains-
tream de la sociologie des mobilisations et de
la protestation en Occident, c’est entre autres
dans ce domaine qu’il est mobilisé dans le
champ des études africaines. Comment expli-
quer le succès géographique d’un concept ini-
tialement appliqué aux révoltes frumentaires
dans l’Angleterre de la fin du XVIIIesiècle, et
aux paysans de Birmanie? Peut-il être d’une
quelconque utilité pour comprendre les
«Économie morale» et protestation –
détours africains
Johanna Siméant
pp. 142-160
142
POINT CRITIQUE
▲
ABDULLAH, Ibrahim. 1994. «Rethinking
the Freetown Crowd: The Moral Economy
of the 1919 Strikes and Riot in Sierra Leone»,
Canadian Journal of African Studies,
vol. 28, n° 2: 197-218.
FASSIN, Didier. 2009. «Les économies morales
revisitées», Annales. Histoire et sciences sociales,
vol. 64, n° 6: 1237-1266.
LONSDALE, John. 1992. «The Moral Economy
of Mau-Mau: The Problem» et «The Moral
Economy of Mau-Mau. Wealth, Poverty
and Civic Virtue in Kikuyu Political Thought»,
in Bruce J. Berman et John Lonsdale, Unhappy
valley. Conflict in Kenya and Africa. Londres,
James Currey (Eastern African studies): 265-504.
LUBECK, Paul M. 1985. «Islamic Protest under
Semi-Industrial Capitalism: “Yan Tatsine”
Explained», Africa. Journal of the International
African Institute, vol. 55, n° 4: 369-389.
MOODIE, Dunbar T. 1986. «The Moral
Economy of the Black Miners’ Strike of 1946»,
Journal of Southern African Studies,
vol. 13, n° 1: 1-35.
POSUSNEY, Marsha Pripstein. 1993. «Irrational
Workers: The Moral Economy of Labor Protest
in Egypt», World Politics, vol. 46, n° 1: 83-120.
SCOTT, James C. 1976. The Moral Economy
of the Peasant. Rebellion and Subsistence
in Southeast Asia. Londres, Yale University Press.
THOMPSON, Edward P. 1971. «The Moral
Economy of the English Crowd
in the Eighteenth Century», Past & Present,
n° 50: 76-136 [trad. fçse, «L’économie morale
de la foule dans l’Angleterre du XVIIIesiècle»,
in Guy-Robert Ikni et Florence Gauthier (éd.),
La Guerre du blé au XVIIIesiècle. La critique
populaire contre le libéralisme économique.
Montreuil, Éd. de la Passion, 1990 : 31-92].
— 1993. Customs in Common: Studies
in Traditional Popular Culture. New York,
New Press.
ZELEZA, Paul T. 1995. «The Moral Economy
of Working Class Struggle: Strikers,
the Community and the State in the Mombasa
General Strike», Africa Development,
vol. 20, n° 3: 51-87.
Ouvrages commentés
0000_03_xp_p128_176 9/11/10 9:44 Page 142
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin

formes de l’action collective, sur le continent
africain ou ailleurs? À oublier à quelles ques-
tions entendaient répondre ceux qui ont forgé
ce concept, ne risque-t-on pas de favoriser
une nouvelle routine interprétative dans les
sciences sociales?
Le propos de cet article n’est donc pas de
se limiter aux terrains africains, mais d’essayer,
en étudiant l’usage et la circulation de la
notion dans les études africaines, de com-
prendre jusqu’à quel point elle peut ou non
être utile à la sociologie de la protestation.
Thompson et Scott: indignations
populaires et économie morale
La double origine du terme (Moral Eco-
nomy), mobilisé à quelques années d’inter-
valle par Edward Thompson et James Scott,
permet de mieux comprendre les conver-
gences et à l’inverse les malentendus autour
de son usage.
La foule face au marché: enchâssement de
l’économie dans le social et tensions dans
l’histoire marxiste britannique
Si le terme d’économie morale apparaît
déjà dans The Making of the English Working
Class, (1968: 68, 222), Thompson ne lui
donne un statut central que dans son article
de 1971. Traitant des révoltes autour du prix
des céréales dans l’Angleterre de la seconde
moitié du XVIIIesiècle, l’historien entend
combattre une conception «spasmodique» et
mécanique (stimulus => protestation) de la
foule et de l’émeute, pour restituer ce que ces
révoltes exprimaient de conceptions popu-
laires de la légitimité et de la justice en
matière de transactions économiques. Unani-
mité et croyances partagées sont centrales: il
s’agit d’étudier un consensus communautaire.
Par son refus de désenchâsser les rap-
ports d’échange et de production de leur
environnement social, le recours au terme
d’économie morale s’oppose clairement au
lexique de l’économie politique. L’affinité
avec Karl Polanyi (1944) est manifeste.
Mais, dans le champ d’une histoire sociale
britannique dont la revue centrale est Past
and Present, fondée par le groupe des histo-
riens du Parti communiste de Grande-Bre-
tagne, Thompson, qui avait lancé une revue
de discussion au sein du parti, The Reasoner
(puis The New Reasoner), s’oppose, bien que
de façon inégalement explicite selon ses
écrits, à Louis Althusser (Thompson 1978)
et aux althussériens britanniques (comme
Perry Anderson). Entre les lignes, l’article
de 1971 dans Past and Present s’oppose à
une conception «top-down» du consente-
ment qui procéderait par des appareils idéo-
logiques d’État. C’est que Thompson, dès
1963, incarne un marxisme attentif aux
dimensions morales de la classe en train de
se faire: la communauté est autant produite
par ses conditions de vie qu’elle se produit
elle-même par un travail moral et politique.
Les rapports d’échange et de production ne
peuvent être séparés des conceptions
morales qui en procèdent partiellement et
leur donnent sens.
Thompson pense la révolte populaire en
temps de transition et de bouleversements
économiques (la révolution industrielle et
l’avènement du marché), alors que reste pré-
sente une mémoire des arrangements
anciens, structurés par un modèle paternaliste
et protecteur dans lequel les autorités sont
supposées subvenir aux besoins en cas de
crise ou de disette. En arrière-plan se dessine
la possibilité d’une intimidation populaire à
l’égard des autorités qui ne se conforment pas
à ce modèle arrimé à l’idée de droits tradi-
tionnels. Thompson (1993, pp. 260-261)
propose à la fois un modèle de protestation,
de culture politique (et/ou de mentalité, ces
deux termes sont employés) et de relations
entre élites et dominés.
Genèses 81, décembre 2010
143
POINT CRITIQUE
▲
0000_03_xp_p128_176 9/11/10 9:44 Page 143
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin

Les paysans vus par James Scott:
éthique de la subsistance, dépendance
personnelle et micropolitique
des résistances au village
Si Thompson, historien de la classe
ouvrière, traite des acheteurs/consommateurs
de grain et de pain, en particulier en milieu
urbain, Scott (1976) se concentre sur les pro-
ducteurs (Adas 1980). Avec d’autres (Wolf
1969), il travaille sur le monde paysan dans les
sociétés colonisées ou anciennement colonisées
(dans cet ouvrage Scott traite de la Birmanie et
du Vietnam). Issues de l’anthropologie écono-
mique telle que l’a pratiquée Raymond Firth
(1967), ses réflexions s’inscrivent dans un débat
très actif sur les économies paysannes de sub-
sistance. Scott entend comprendre certaines
des grandes révoltes paysannes qui se sont pro-
duites en Asie du Sud-Est pendant la dépres-
sion des années 1930, en saisissant l’économie
morale des paysans: «leur conception de la jus-
tice économique et leur définition opératoire
de l’exploitation – ce qui est tolérable ou intolé-
rable en matière de prélèvement sur leur pro-
duction» (p. 3). Cette économie morale est
pour lui généralisable à d’autres sociétés pay-
sannes, et permet de mieux comprendre les
«racines normatives des conceptions politiques
paysannes», et la façon dont les transforma-
tions économiques et politiques de l’époque
coloniale ont remis en cause les conceptions
paysannes de l’équité sociale, aboutissant à ce
qu’une «classe à “faible caractère de classe” en
venait à fournir, bien plus souvent que le pro-
létariat, les troupes de choc de la rébellion et de
la révolution» (p. 4).
Comme chez Thompson, «économie
morale» renvoie à une conception de l’échange
entre peuple et élites, appuyée sur des normes
de réciprocité et de droit à la subsistance ins-
crites dans les routines quotidiennes. La notion
d’éthique de subsistance est centrale chez
Scott, et désigne des comportements marqués
par une prudence absolue liée à l’impératif de
survie, et supposant des arrangements sociaux
et techniques qui évitent le risque (modes de
culture plus sûrs que d’autres…). En découle
une conception du juste: le dirigeant légitime
ne l’est pas selon sa richesse ou sa frugalité,
mais selon qu’il comprend ou pas les besoins
des paysans et leur laisse assez pour vivre. Mais
solliciter ce que le riche patron présente
comme une faveur, même si l’on considère que
c’est un droit, c’est encourager publiquement la
légitimation à laquelle l’on fait stratégiquement
appel (Scott 1976, p. 204). La lutte de sens
prend place presque entièrement dans le cadre
normatif du vieux système agraire. Scott ana-
lyse ainsi la subsistance qui se fait au prix de la
dépendance, et la certitude pour les riches que
des pauvres abandonnés sont dangereux. Il
traite moins de l’émeute en tant que telle que
de la menace potentielle que constituent les
pauvres (par la foule et la rumeur, jeu sur la
réputation des riches et moyen d’affirmer et de
prouver qu’ils violent des normes). Ces micro-
conflits sont la condition de mobilisations plus
étendues.
L’approche de Scott est plus structurale
et moins historienne que celle de Thompson:
à la limite, toute situation de subsistance de
par le monde produit son éthique de la sub-
sistance, ce qui ne dit rien de sa traduction
concrète, au point que l’on peut reprocher à
Scott de prendre insuffisamment en compte
les déclinaisons locales et… morales de son
économie morale. Scott a d’ailleurs failli ne
pas utiliser cette notion qui n’a ni organisé ni
orienté sa démarche de recherche : son
ouvrage s’intitulait à l’origine The Political
Economy of the Subsistence Ethic: Peasant
Rebellions in Southeast Asia1. C’est alors qu’il
révisait une première mouture de son ouvrage
en 1973-1974 qu’il découvrit l’article de
Thompson et modifia son titre (Scott 2000).
Comme Thompson, qui avait collaboré avec
ce dernier, une de ses références était alors le
travail de Richard Cobb (1970) sur les
émeutes à Paris et les «subsistances».
Johanna Siméant « Économie morale » et protestation – détours africains
144
POINT-CRITIQUE
▲
0000_03_xp_p128_176 9/11/10 9:44 Page 144
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin

Un concept pour penser contre
Malgré plusieurs différences et malen-
tendus dans le recours à la notion, liés au fait
que les auteurs mobilisent deux biblio-
thèques assez différentes et s’inscrivent dans
des débats distincts, l’intérêt d’économie
morale est:
- de récuser une conception éruptive de
la foule qui a longtemps handicapé l’analyse
de l’action collective, sans à l’inverse recourir
aux routines utilitaristes de la sociologie des
mouvements sociaux;
- d’envisager la domination sans suppo-
ser l’intériorisation inconditionnelle du
consentement. «Économie morale» suppose
une conception relationnelle de la légitima-
tion qui invite à penser ensemble contesta-
tion et paternalisme, patronage et rumeur,
déférence à l’égard des autorités et injonction
à ce que ces dernières se comportent comme
de «bonnes autorités».
- d’éviter tout réductionnisme écono-
mique et de contester l’idée d’un marché et
d’une économie autonomes à l’égard du
monde social. Ce faisant, elle permet non
seulement de penser la façon dont des socié-
tés ont vécu la généralisation du capitalisme
et du marché, mais elle propose également de
cerner les conceptions populaires du juste et
de l’injuste en matière économique.
- Enfin, parce qu’économie morale
entraîne une référence à l’œuvre entière de
Thompson et de Scott, le terme renvoie au
halo bibliographique d’une part d’une histoire
sociale détachée du «marxisme vulgaire »
(Bayart 1994b: 138), attentive à restituer le
sens des illégalismes populaires et de l’inven-
tion de la tradition (Hobsbawm 1959, 1969;
Hobsbawm et Ranger 1983)2, d’autre part à
une anthropologie des résistances et «discours
cachés» (hidden transcripts), thèmes qui seront
développés plus tard par Scott (1985, 1990),
mais qui arriment les usages d’«économie
morale» à ces notions alors que peu de ceux
qui s’en réclament se sont confrontés aux
considérations parfois très techniques de
l’ouvrage de 1976.
Paysans, révoltes populaires
et économie morale du religieux
dans les études africaines
Comment comprendre l’acclimatation de
ce terme dans les études africaines, et dans
quels domaines cette acclimatation a-t-elle
été privilégiée?
Un débat partiellement connecté:
l’économie de l’affection et la paysannerie
(in)capturée
«Économie morale» est peu utilisée pour
ce qui concerne la protestation paysanne dans
les études africaines3.C’est davantage la
notion de résistances quotidiennes ou cachées,
et auparavant la référence au banditisme social
(Hobsbawm 1969), qui sont mobilisées.
Solidarités paysannes, rapport au marché
et à l’État, restitution de la capacité de résis-
tance des dominés à la fois contre et en dehors
de l’ordre officiel: on retrouve pourtant des
thèmes classiques des tenants de l’économie
morale chez Goran Hyden (1980) sur l’«éco-
nomie de l’affection» et la paysannerie «non
capturée» en Tanzanie. Hyden, qui ignore
superbement Thompson, se revendique de
Polanyi et s’inscrit dans le débat sur les modes
africains de production (Coquery-Vidrovitch
1969; et sur la question du mode de produc-
tion lignager Meillassoux 1964 et Terray
1972). Pour Hyden, si à chaque mode de pro-
duction correspond son économie, c’est à une
économie de l’affection que correspond le
mode de production précapitaliste des sociétés
africaines: un rapport à l’économie dans lequel
les liens basés sur l’origine ou la descendance
commune prévaudraient, dans une action éco-
Genèses 81, décembre 2010
145
POINT CRITIQUE
▲
0000_03_xp_p128_176 9/11/10 9:44 Page 145
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
Document téléchargé depuis www.cairn.info - ens_ulm - - 129.199.144.202 - 23/02/2012 11h53. © Belin
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%