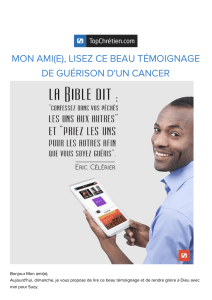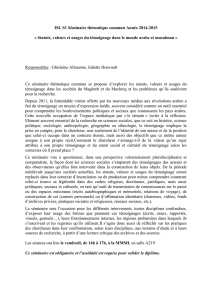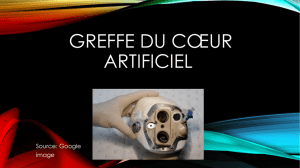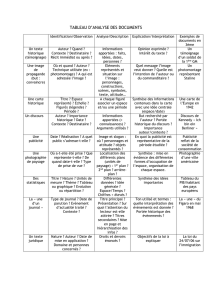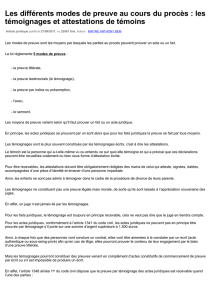Accréditation du témoignage - Crisco

Accréditation du témoignage
Dominique Legallois, Université de Caen, CRISCO, EA 4255
Yannick Malgouzou, Université de Toulouse, L.L.A., EA 4152
Luc Vigier, Université de Poitiers, FORELL, EA 3816
Ce numéro de Champs du Signe consacré à une réflexion pluridisciplinaire sur la
notion d’accréditation du témoignage1, sonde les différents parcours interprétatifs liés à la
complexité de phénomènes connexes et complémentaires. En effet, la notion d’accréditation
transcende incontestablement celles d’attestation (le fameux j’y étais du témoignage) et de
réception. Comme nous le montrons dans cette présentation, la question de l’accréditation est
pertinente dans toutes les étapes constitutives du témoignage.
Les deux grandes acceptions du verbe accréditer proposées par le Trésor de la Langue
Française Informatisé (TLFI), autorisent une analyse complexe de la notion d’accréditation 1)
Faire reconnaître quelqu'un comme son représentant / donner l'autorité nécessaire ; 2) Faire
accepter quelque chose, faire croire à la vérité d'une chose. La première acception, centrée
sur la réception, souligne le rôle éthique du témoin qui se voit investi d’une responsabilité :
celle de transmettre l’expérience, parce que lui, le témoin, est accrédité / autorisé / reconnu
pour le faire. Si la seconde acception, centrée sur la production, est directement liée au
dispositif argumentatif de tout discours, la réflexion doit porter également sur la finalité
éthique. L’analyse s’enrichit de surcroît lorsqu’on considère d’une part, l’engagement du
témoin pour l’événement, et, d’autre part, l’engagement du récepteur pour le témoignage.
Pour présenter plus sûrement la thématique à laquelle répondent les contributions de
ce volume, ainsi que la complexité à laquelle nous avons fait allusion, partons d’une réflexion
des épistémologues Steven Shapin et Simon Schaffer, qui, dans leur ouvrage devenu un
classique, Leviathan et la pompe à air, posaient ainsi le problème de l’accréditation2 des
expériences scientifiques du XVIIe siècle :
Si, comme l’affirmaient Boyle et d’autres expérimentateurs anglais, les connaissances devaient
être empiriquement fondées, il fallait que les expériences qui en étaient la base soient attestées par des
témoins oculaires. De nombreux phénomènes, et notamment ceux allégués par les alchimistes, étaient
difficiles à accréditer.
Recourir au témoignage oculaire comme critère de sûreté posait un problème de discipline.
Comment imposer un ordre aux comptes rendus des témoins de façon à éviter un individualisme radical ?
Etait-on obligé d’accréditer un compte rendu sur la foi de n’importe quel témoin ?3
Cette citation fait elle aussi référence à deux niveaux d’accréditation directement corrélés à
deux niveaux d’engagement :
- l’accréditation des faits de laboratoire par des témoins instrumentalisés : il y a bien un
engagement du témoin dans l’expérience à laquelle il « participe », qui consiste à croire ce
qu’il a vu ou vécu (pourrait-on témoigner de ce que l’on ne croit pas ?). La responsabilité
éthique du témoin accrédité (ici, instrumentalisé) consiste à transmettre la description de
l’événement.
1 Ce recueil est un des nombreux fruits des concertations et colloques menés dans le cadre de l’ACI
« Témoignage », programme du réseau des MSH (Caen, Poitiers, Toulouse).
2 Rappelons que cet ouvrage porte sur l’invention du laboratoire au XVIIe siècle, et plus précisément sur les
expériences de Boyle sur la pompe à air.
3 Steven Shapin et Simon Schaffer, Léviathan et la pompe à air, Hobbes et Boyle entre science et politique,
Paris, La Découverte, 1993, p. 59.Ce sont les auteurs qui soulignent.
1

- L’accréditation des témoignages par le public, ou par des experts non présents. Non pas
seulement, répétons-le, la simple réception, mais l’engagement du destinataire dans l’acte de
comprendre l’objet du discours, car ce destinataire est lui-même éthiquement engagé dans la
réception. Et à ce titre, il possède également une responsabilité, puisqu’il doit répondre au
discours témoignage.
Donc, la notion d’accréditation du témoignage, par l’ambiguïté sémantique du génitif,
est plurielle : elle renvoie, d’une part, au rapport du témoin face aux faits : présence,
compréhension, attestation. Reconnu comme témoin, le sujet parlant est habilité – accrédité –
à parler. Elle renvoie, d’autre part, à la réception du discours du témoignant, à sa place et à sa
pertinence dans un champ interprétatif, et à l’engagement du destinataire dans la réception.
A présent, reprenons les différents points pour les développer succinctement.
Le témoin accrédité
Un fait devient un événement pour un sujet, si ce fait – qui n’est déjà plus un fait brut –
devient une expérience touchant aux destinées personnelles qu’elle engage. Engagé, le témoin
possède une responsabilité éthique fondamentale :
Le témoignage attire l’attention sur l’authenticité et la sincérité de l’engagement d’un sujet dans son dire.
Le témoignage authentique est une fidélité à soi dont la fidélité au dire est l’expression.4
La garantie de l’accréditation tient, d’une part, à l’engagement dans l’événement – la
liaison du témoin et du réel, première condition pour une interprétation de l’authenticité -, et à
l’engagement éthique et discursif (fidélité à soi) qui constitue le fondement de l’acte de
témoigner : non pas un simple rapport des faits, mais une responsabilité – dont on ne saurait
définir les limites – du sujet témoin. Mais l’accréditation du témoignage ne peut être une
réponse symbolique à un acte de langage spécifiquement configuré par l’engagement de
l’énonciateur. Ainsi, s’il suffit de dire je te promets que…/je te jure que…/ je te souhaite
que…etc. pour qu’instantanément soit engagée la parole du sujet, et de là, l’accréditation d’un
engagement, l’emploi du verbe témoigner dans les conditions grammaticales de la
performativité (un « je » énonciateur, conjugaison au présent de l’indicatif, présence implicite
ou explicite d’un allocutaire), ne garantit pas le faire croire. En effet, il faut à l’emploi
performatif de témoigner les normes d’une institution aussi « marquée » que l’institution
religieuse, par exemple, pour fonctionner. On trouve la majorité des occurrences du
performatif témoigner dans la double profession de foi musulmane : « je témoigne qu'il n'y a
de divinité que Dieu, et je témoigne que Mohammed est son envoyé ». Ici, l’engagement – la
soumission du croyant- participe autant de la fidélité à Dieu et Mohammed, qu’à la fidélité à
soi dont parle Jean Philippe Pierron : une accréditation du sujet dans son acte de croyance, qui
le conduit vers l’horizon éthique d’un devoir de témoigner. Hormis la profession de foi
musulmane, les rares emplois performatifs de témoigner ont peu à voir avec le témoignage.
Dans cette citation empruntée à Si le grain ne meurt, Gide se souvient de son enfance
d’écolier :
Je témoigne que nulle page d'Aphrodite ne put troubler nul écolier autant que cette métamorphose de
Gribouille en végétal le petit ignorant que j' étais.
Nulle trace ici d’un véritable témoignage, mais plutôt celles, plus élémentaires, de l’attestation
et de l’affirmation. La grammaire du verbe témoigner nous contraint donc à chercher les
modalités de l’accréditation testimoniale ailleurs que dans une performativité directe et
4 Jean-Philippe Pierron, Le passage de témoin. Une philosophie du témoignage, Paris, Ed. du Cerf, 2006, p. 54.
2

explicite. Et c’est l’accréditation du témoin par autrui qui fournit une réponse. Le témoin ne
peut être témoin que si une instance le reconnaît comme tel. Autrement dit, si témoigner n’est
pas un acte de langage « directement » explicite – c’est-à-dire visible en tant que tel – c’est
parce que ce discours requiert une instance accréditée. Autrement dit encore, il ne suffit pas
de dire je témoigne pour témoigner. Il faut en plus être reconnu comme témoignant par une
instance « réceptrice ». Selon la belle expression de Mirna Velcic-Canivez (ici-même), cette
instance est une écoute dans le texte qui ne correspond jamais à tous les destinataires, mais
qui, engagée dans le témoignage, accrédite le témoin et participe ainsi au processus
testimonial.
Il est important de jumeler la légitimation du témoin et de son témoignage avec,
comme nous l’avons dit, une sorte d’auto-accréditation : cette fidélité à soi-même nécessaire
dans l’engagement éthique, liée à la relative identification du sujet avec la signification de
l’événement. Commencée dans l’expérience, passée dans l’acte discursif, elle lui confère sa
force d’engagement. Accréditation et auto-accréditation sont nécessaires, de sorte qu’un
témoignage anonyme ne constitue pas véritablement un témoignage.
Faire croire
L’accréditation peut encore être envisagée du point de vue perlocutoire. Faire croire à
la vérité de nos discours est une modalité inhérente à toute production linguistique. C’est là un
aspect que la philosophie du langage et la pragmatique (qui découle de cette philosophie) ont
très souvent relevé – sans oublier, évidemment, la tradition rhétorique de l’argumentation. La
vérité semble inexorablement ficelée, d’une manière ou d’une autre, au message linguistique.
Et la problématique du témoignage, de sa vérité et de son accréditation, est particulièrement
exemplaire du débat sur l’éthique linguistique. Si accréditer et accroire sont
morphologiquement apparentés, le dernier verbe renvoie à l’acte de faire croire à quelqu'un
quelque chose que l'on sait n'être pas vrai (TLFI). Aussi, la forme même d’accréditer nous
renvoie toujours à cette inconfortable méfiance envers les discours : faire accréditer une vérité
ou faire accroire un mensonge, dans les deux cas, c’est faire adhérer. Pourtant, une certaine
philosophie, que l’on peut juger idéaliste, conçoit que cette méfiance reste exceptionnelle.
Citons, bien sûr, Thomas Reid, dans ses Recherches sur l’Entendement Humain :
Le sage et bienfaisant Auteur de la nature, qui voulait que l’homme vécût en société, et qu’il reçut de ses
semblables la plus grande et la plus importante partie de ses connaissances, a placé en lui, pour cette fin,
deux principes essentiels qui s’accordent toujours l’un à l’autre.
Le premier de ces principes est un penchant naturel à dire la vérité […] Le second principe […] est une
disposition à nous confier à la véracité des autres et à croire ce qu’ils nous disent.5
La dépendance épistémique6 – notre savoir est en grande partie fondé sur l’expertise de
l’autre – s’avère non problématique car déterminée par la nature de l’humain communiquant.
Cette conception est différente de celle de Hume, pour qui notre aptitude à croire est fondée
sur l’habitude. Qui plus est, pour Hume, la croyance peut à tout moment être vérifiée. Inutile
d’insister sur la pertinence de cette vérification a posteriori, qui, même si elle était possible,
viderait substantiellement la spécificité même du témoignage. La réflexion d’Agamben sur les
limites du discours historique, montre bien que le témoignage est bien plus qu’un simple
discours sur des faits, même révélés : l’inexorable clivage entre connaître et comprendre.
5 Thomas Reid, Recherches sur l’Entendement Humain, trad. Jouffroy, 1828, p. 346-348.
6 Le terme est emprunté à J. Hardwig., « Epistemic Dependence », in Journal of Philosophy, n° 7, 1985. Cf.
également Gloria Origgi (2004) « Croyance, déférence et témoignage », in E. Pacherie, J. Proust (eds.)
Philosophie Cognitive, Presses de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2004.
3

Les prolongements des conceptions de Reid et Hume, se lisent encore, d’une certaine
façon, dans la théorie coopérationnelle de Grice, lorsqu’il énonce ses maximes
conversationnelles - en particulier celles de quantité et de qualité directement liées à notre
problématique.
Mais une pragmatique plus au fait des réalités cognitives des sujets, se révèle être très
intéressante pour notre réflexion sur le faire croire. Citons, assez longuement Dan Sperber :
Même si un acte de communication où le communicateur dit la vérité et où l’auditeur le croit peut
être avantageux pour l’un et pour l’autre, le jeu de la communication n’a pas de solution générale stable.
Les stratégies optimales varient suivant les circonstances des deux côtés. Il ne suffit pas au
communicateur d’être cru. Encore faut-il que le fait que son message soit cru ait des effets bénéfiques. En
conséquence, les communicateurs ne choisissent pas entre dire le vrai ou dire le faux, mais entre
transmettre ou ne pas transmettre tel ou tel message qui, vrai ou faux, devrait s’il est cru avoir des effets
souhaités. Les destinataires, pour leur part, sachant qu’il n’est pas systématiquement dans l’intérêt des
communicateurs de dire vrai, comprennent qu’il n’est pas dans leur propre intérêt de toujours croire ce qui
est dit.7
Même si Sperber se situe dans une perspective évolutionniste, nous pensons que son
argumentation est pertinente pour notre propos. Précisions que l’argumentation de l’auteur
n’est ni morale ni éthique, mais anthropologique, et en ce sens, dépourvue d’une évaluation
axiologique du témoignage.
Dans la perspective évolutionniste, le témoignant ne sert pas les besoins cognitifs du
destinataire, mais son intérêt propre qui consiste à provoquer des effets. La théorie des actes
de langage parle de visées et d’effets perlocutoires. Mais il reste qu’un témoignage
authentique constitue le moyen le plus pertinent pour provoquer les effets voulus sur
l’auditoire, puisque, dire la vérité est la méthode la plus efficace, à long terme, pour maintenir
une réputation de personne fiable (sans compter, bien sûr, le risque de sanction sociale en cas
de mensonge). Donc :
Un témoignage honnête est très souvent le meilleur moyen, voire le seul, de provoquer les effets voulus
sur l’auditoire, qui dès lors a intérêt à accepter le témoignage comme vrai. A l’inverse, si un destinataire
décidait de faire systématiquement confiance, il serait souvent trompé (et ce d’autant plus que ses
interlocuteurs, s’étant rendus compte de sa crédulité systématique, pourraient embellir la vérité et mentir
sans crainte d’être découverts).8
Il s’ensuit, d’une part, la volonté du témoignant à montrer la véracité de son discours, et,
d’autre part, la volonté du destinataire à évaluer cette véracité à partir d’indices formels. La
monstration et l’évaluation se construisent dans la rationalité de l’argumentation. Autrement
dit, il s’agit pour le témoignant de mettre en évidence la forme de la cohérence de son
discours, forme qui passe par l’emploi d’éléments liés à un espace commun de sens, l’emploi
de connecteurs argumentatifs, une mise en intrigue, la construction discursive d’un éthos, et
par les moyens rhétoriques les plus divers. Par ailleurs, si pour le destinataire, la cohérence
externe (au discours) n’est pas évaluable, la cohérence interne (du discours), en revanche,
l’est. L’accréditation – au sens de faire croire – est donc le résultat d’un jeu d’équilibre, dans
lequel le témoignant donne les preuves formelles de sa bonne foi, de l’authenticité de son dire,
en produisant un discours acceptable, tandis que le destinataire évalue ces indices comme
résultats d’une intention authentique ou non. Nous proposons, en guise d’illustration,
l’exemple des souvenirs de guerre du philosophe Alain :
7 Dan Sperber (2001) « An Evolutionary perspective on testimony and argumentation », Philosophical Topics,
2001, p. 406 – traduction de Nathan Sperber).
8 Idem, p. 408.
4

Je me moque de l’ordre chronologique, n’ayant d’ailleurs aucune note qui puisse me rappeler la suite des
jours. Ainsi, je m’expose, sans aucun souci, aux foudres de Norton Cru, dont l’énorme et patient travail a
d’ailleurs eu d’utiles effets.9
L’effet d’authenticité est patent ici grâce à l’expression directe d’une insouciance face
à la chronologie. Ne pas « avouer » les possibles anachronies des événements auraient, en
revanche, conduit le lecteur à une suspicion. Cette prémunition oratoire signe là la volonté
ostentatoire de produire un discours crédible – « accréditable », même s’il ne répond pas aux
canons du témoignage (par exemple, ceux imposés par Norton Cru).
Par ce processus, évidemment, l’accréditation n’est nullement garantie, mais elle est
rendue possible. On ne peut, en effet, faire croire à la vérité d’un événement en pariant
simplement sur son évidence. Le travail d’accréditation est un travail discursif et argumentatif
qui doit autant à la construction (plus ou moins consciente) rhétorique et argumentative du
texte, qu’au partage de présupposés et de connaissances communes.
La position de Sperber pourrait amender le « principe du témoignage » proposé par
John Hardwig. Ce dernier explique que nous avons des raisons pour croire un témoin qui dit
que P, si nous avons des raisons de croire qu’il a des raisons pour croire P10. En termes
pragmatiques, les raisons de croire qu’un témoin croit P sont décelables au niveau de la
cohérence discursive – la force de conviction par exemple, évaluable par les indices formels
(trop de conviction est nécessairement suspecte). Nous pensons rejoindre les propos de Gloria
Origgi :
Témoigner, ce n’est pas simplement une façon parmi d’autres de fournir des indices directs d’un certain
état de choses. Certes, un comportement verbal peut aussi donner des indices directs de ce qui est en
cause. On me demande si j’ai une voix de soprano et je réponds en chantant l’air de la Reine de la Nuit
avec une voix de soprano : je fournis dans ce cas un indice direct de la tessiture de ma voix. En règle
générale, cependant, un témoignage verbal ne fournit pas d’indice direct en ce sens. La position de
locuteur ne suffit pas à me mettre automatiquement dans une position de source fiable d’information.
C’est par le fait de présenter mon énoncé comme une assertion et l’engagement que cela comporte de ne
dire que ce que j’ai de bonnes raisons de croire vrai que je me constitue activement comme une source
fiable.11
On pourrait critiquer l’aspect trop analytique de ces propos. Mais nous pensons qu’ils
sont complémentaires de remarques énoncées dans une perspective plus herméneutique.
Ainsi, les indices de cohérence ne sont pas, en définitive, si éloignés au niveau fonctionnel en
tous cas, de ce que Jean Philippe Pierron désigne sous le terme de « force figurative »12 du
témoignage. Un témoignage qui veut faire croire construit les conditions du dépassement du
simple compte rendu, pour « forcer le langage à faire signe à ce qui dépasse la capacité des
signes »13. La force figurative du témoignage est donc aussi de construire l’implicite
nécessaire à l’adhésion de l’autre : on le sait, en imposant une participation active du
destinataire, celui-ci, mis à contribution, participe à la construction du discours et à son
accréditation.
L’accréditation du témoignage est donc une problématique à multiples faces, effective
dans le rapport entre le témoin et l’événement (accréditer l’événement), le témoin et son
engagement discursif (auto-accréditation pour une finalité éthique), le témoin et le destinataire
(le témoin accrédité par autrui), le témoin et la finalité de son témoignage (le faire croire).
9 Alain (1933), Souvenirs de guerre, Hartmann, p. 27
10 John Hardwig (1988) « Evidence, Testimony, and the Problem of Individualism -A Reply to Schmitt », Social
Epistemology, 2, 1988, p. 310.
11 Gloria Origgi (2004) « Croyance, déférence et témoignage », op. cit., p. 176.
12 Jean-Philippe Pierron, Le passage de témoin. Une philosophie du témoignage, op. cit., p. 49.
13 Idem, p. 49.
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%