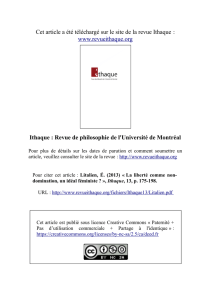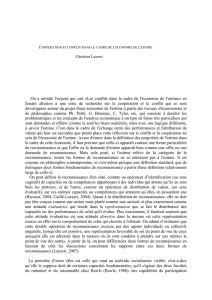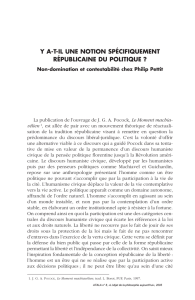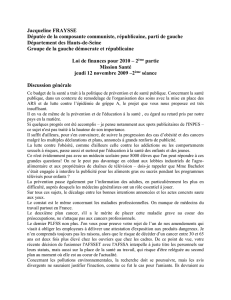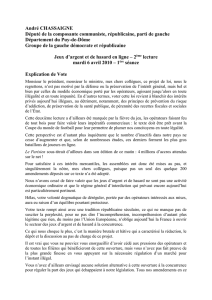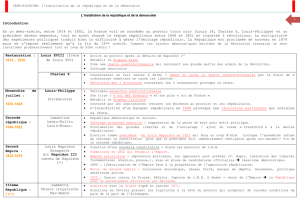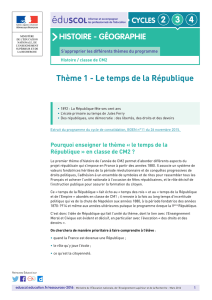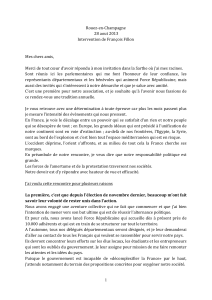DOSSIER_IP_NeoRepublicanisme - Implications philosophiques

1
Dossier
Le
néo-républicanisme :
enjeux éthiques,
sociaux et politiques

2
Sommaire
Introduction :
Théorie de la liberté comme non-domination et renouveau
du républicanisme................................................................................4
Chapitre 1 :
À l’école du néo-républicanisme ......................................................21
Chapitre 2 :
La place des droits dans le républicanisme de Philip Pettit..........41
Chapitre 3 :
La philosophie politique néo-républicaine : immigration et
non-domination..................................................................................57
Chapitre 4 :
Promouvoir l’autonomie par la justice économique et sociale......71
Chapitre 5 :
Le travail des républicains................................................................88

3
Introduction
Théorie de la liberté comme
non-domination et renouveau
du républicanisme
par
Alice Le Goff
1
1
Alice Le Goff est MCF en philosophie sociale et politique à l’Université Paris Descartes – CERSES
(UMR 8137).

4
Théorie de la liberté comme non-domination et renouveau du républicanisme
Alice Le Goff
La tradition républicaine a connu ce qu’on désigne d’ordinaire comme un
renouveau depuis les années 1960. L’élaboration par Philip Pettit d’une théorie de la
liberté politique comme absence de domination a constitué une étape importante de ce
renouveau.
Ce renouveau s’est enraciné dans le courant de recherches historiographiques
initiées par la publication de l’ouvrage de J. G. A. Pocock, Le moment machiavélien
2
.
Commandée par la volonté de contester la prédominance, dans le domaine de la
philosophie politique, du discours libéral-juridique, la démarche de Pocock a tenté de
mettre en valeur la prédominance de la tradition de l’humanisme civique de la pensée
florentine jusqu’à la Révolution américaine, en proposant une vision de l’histoire
politique américaine en rupture avec l’idée d’un triomphe progressif et indiscutable
du libéralisme. Le discours humaniste civique
3
repose sur une anthropologie
présentant l’homme comme un être politique ne pouvant s’accomplir que par la
participation à la vie de la cité. La liberté recouvre moins ici le fait de jouir de ses
droits sous la protection de la loi qu’un exercice de la vertu civique. Cette vertu se
définit par la défense du bien public qui passe par celle de la forme républicaine
permettant l’indépendance de la collectivité.
Les thèses de Pocock ont été prolongées et contestées par Q. Skinner qui a
soutenu que l’accent mis sur la participation civique découle non pas d’une reprise de
thèses aristotéliciennes mais d’une réactualisation de thèses cicéroniennes: la
participation civique apparaît moins comme une fin en soi que comme une valeur
quasi-instrumentale visant la protection de la liberté comme indépendance. Skinner a
tenté de montrer que la sauvegarde de la liberté négative constituait bien une visée
ultime pour les penseurs de la Renaissance qui avaient bien saisi qu’une citoyenneté
active était le seul moyen d’atteindre un tel but. Skinner s’appuie, pour étayer sa
position, sur la pensée de Machiavel au sein de laquelle pourrait s’opérer la jonction
de l’idéal antique de vertu civique et d’une défense de la liberté individuelle,
2
Pocock J. G. A., Le moment machiavélien, trad. L. Borot, Paris, PUF, 1997.
3
Sur la notion d’humanisme civique, voir le dossier coordonné par Y. Sintomer in Raisons Politiques,
36, Nov. 2009.

5
permettant de définir les contours d’une démocratie pluraliste bien distincte de la
conception libérale et de la vision communautarienne de la démocratie
4
.
Pettit s’est inscrit dans la lignée de Skinner et la démarche déployée dans
Républicanisme
5
a visé à montrer en quoi les idéaux républicains ne peuvent être
rabattus sur des idéaux communautariens
6
. Mais sa propre démarche s’est inscrite
dans un rapport critique à celle de Skinner : son but a été moins de contester
l’assimilation de la liberté républicaine à une forme positive de liberté que de
dépasser le dilemme classique de la liberté positive, définie en termes d’autonomie et
d’autoréalisation, et de la liberté négative, définie en termes de non-interférence
7
. Il
s’est agi pour lui de définir la liberté républicaine à partir d’un critère de démarcation
permettant d’éviter tout rabattement de celle-ci, que ce soit sur la liberté positive ou
sur la liberté négative : d’où l’élaboration du concept de non-domination, liée à
l’intuition qu’il existe une différence fondamentale entre l’interférence et la
domination, conçue comme maîtrise sur autrui. La liberté se définit négativement
mais pas à partir de la seule interférence puisqu’il s’agit d’exclure toute maîtrise de
mes actes par autrui. Pettit a appuyé sa distinction entre liberté négative et non-
domination sur le cas paradigmatique de l’esclave qui est dominé dans la mesure où
son maître peut interférer à sa guise dans sa conduite : il peut y avoir domination sans
interférence dès lors que quelqu’un est en position d’influer arbitrairement sur mes
actions ; ainsi, un maître peut être bienveillant au point de laisser ses esclaves agir
sans interférer tout en conservant un pouvoir d’interférence dont rien ne garantit qu’il
n’usera pas. C’est précisément cette contingence, qui caractérise intrinsèquement
l’idéal de non-interférence, que Pettit va viser à exclure à travers la notion de non-
domination. La non-domination n’est pas l’absence d’interférences mais l’exclusion
d’interférences arbitraires : elle correspond à une franchise « résiliente »
8
. Si le maître
4
Voir « The Republican Idea of Liberty », in Machiavelli and Republicanism, éd. Bock G., Skinner Q.
et Viroli M., Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
5
Pettit P., Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, trad. Spitz J. F. et Savidan
P., Paris, Gallimard, 2004.
6
Sur les liens entre républicanisme et communautarisme voir : Walzer M., Pluralisme et démocratie,
traduction collective, Editions Esprit, Paris, 1997, pp. 180-81 ; Taylor Ch., « Qu’est-ce qui ne tourne
pas rond dans la liberté négative ? », in La liberté des Modernes, trad. De Lara P., Paris, PUF, 1997,
Sandel M., Democracy’s Discontent, Harvard University Press, 1996.
7
Sur ce dilemme qui reformule sur un plan analytique celui de la Liberté des Anciens et de la Liberté
des Modernes analysé par B. Constant, voir Berlin I., Two Concepts of Liberty, Oxford, Oxford
University Press, 1958.
8
Sur l’importance de cette notion de résilience spécifiant la notion de non-domination, cf. G. Brennan
et A. Hamlin, « Republican Liberty and Resilience », The Monist, 84/2000, pp. 45-59.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%