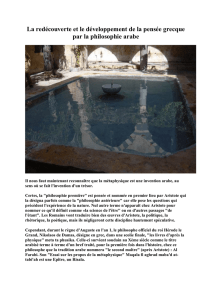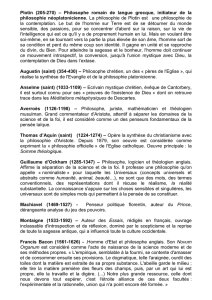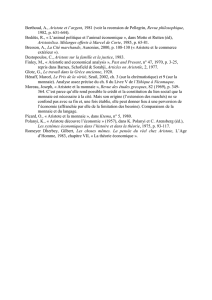aristote de stagire et la crise de l`«etumos

GRAND PORTAIL THOMAS D’AQUIN
GILLES PLANTE
ARISTOTE DE STAGIRE
ET
LA CRISE DE L’«ETUMOS»
© Saint-Étienne-des-Grès 31 Juillet 2009

LA CRISE DE L’«ETUMOS»
En Grèce ancienne, le mot «etumos» signifie : «vrai, certain, réel», puis «origine d’un mot». Aujourd’hui, selon une
acception largement reçue, la recherche d’un étymon consiste à chercher la racine d’un mot dans une autre langue ;
par exemple, le mot français «instruire» a pour étymon le mot latin «instruere». En Grèce ancienne, «[l’]etumos»
s’entend plutôt de qui fait qu’un vocable est autre chose que seulement un bruit fait avec la bouche. Bref, «etumos»,
étroitement associé à «eteos», lui-même dérivé du verbe «einai», en français le verbe «être», évoque une connais-
sance vraie et certaine de l’être, qu’expriment des mots.
Les Modistes, ces grammairiens qui, souvent, étaient aussi logiciens, divisaient d’ailleurs leur sujet d’étude en «ety-
mologia» et en «dyasynthetica». En «etymologia», sont étudiés les «modi significandi», les mesures du signifier,
qu’on distingue des «modi intelligendi» et des «modi essendi». «Modus» se traduit ici par «mesure». Le «modus es-
sendi» mesure le «modus intelligendi» qui, lui-même, mesure le «modus significandi». (Voir l’exposé de Thomas
d’Erfurt reproduit en annexe)
En Ionie, au VIe siècle avant J.C. et au début du Ve, surviennent les premiers sages. D’abord, Thalès, Anaximandre
et Anaximène , tous de Milet. Puis, Héraclite d’Éphèse pour qui : «Ce qui est réel, ce n’est pas l’être mais le devenir :
il n’y a de réel que le changement». À la même époque, arrivent les Éléates. D’abord, Pythagore de Samos. Puis,
Parménide d’Élée pour qui : «Il n’y a de réel que l’être». Enfin, Zénon d’Élée pour qui : le mouvement est impossible.
Au milieu du Ve siècle avant J.C., chez les sages, l’exploration de l’«etumos» donne ainsi lieu à une division :
1) il n’y a de réel que le devenir ;
2) il n’y a de réel que l’être.
À la fin du Ve siècle avant J.C., qui est le siècle de Périclès, arrivent les Atomistes, pour qui le mouvement est réel,
mais le réel est aussi de l’être : les atomes. Pensons à Leucippe, Démocrite, Empédocle, Anaxagore.
À la même époque, surviennent les Sophistes. Nommons, d’abord, Protagoras, un ami de Périclès, pour qui
«l’homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont, qu’elles sont, ; de celles qui ne sont pas, qu’elles ne
sont pas». Et «le vrai est ce qui paraît à chacun». Nommons, ensuite, Gorgias, pour qui il faut admettre que «le non-
4

être est le non-être», et qu’ainsi le non-être est ; sa doctrine va encore hanter Alexius Meinong au début du XXe siè-
cle, et ce, non sans raison.
En effet, songeons un instant à la pensée qu’exprime une proposition telle que : «Le néant n’est pas». Convenons
que le néant, ce n’est rien. En est-il de même du signifié qu’exprime la proposition : «Le néant n’est pas» ? Ou bien
c’est oui, ou bien c’est non. Si c’est oui, si le signifié qu’exprime la proposition : «Le néant n’est pas» n’est rien, il
s’ensuit que la proposition : «Le néant n’est pas» n’est qu’un bruit fait avec la bouche, et que son intelligibilité est
nulle. Et pourtant, il me semble bien que vous avez bien saisi le signifié qu’exprime la proposition : «Le néant n’est
pas». Il y a donc là un vrai problème à résoudre.
Avec la Sophistique grecque s’achève de se nouer la première crise de l’«etumos» ; il y en aura d’autres. Et, en 470
avant J.C., naît Socrate, qui décédera en 399. Avec lui s’amorce une contestation de la Sophistique. De lui, naîtront
deux filiations :
1) la lignée des Grands socratiques : Platon, et son disciple Aristote, avec son prolongement jusqu’à Plotin ;
2) la lignée des Petits socratiques :
• Anthistène : les Cyniques et son prolongement dans le stoïcisme ;
• Aristippe de Cyrène : les Cyrénaïques et son prolongement avec l’épicurisme ;
• Euclide de Mégare : les Mégariques et son prolongement avec le scepticisme.
5

ARISTOTE DE STAGIRE
Pour combattre la Sophistique, Aristote conçoit un «programme» qu’il présente ainsi : «Notre programme était (...) de
découvrir une certaine capacité de raisonner sur tout sujet proposé, en partant de prémisses les plus probables.»
(Réfutations sophistiques, 183a 36-37)1
«Capacité de raisonner» peut être pris en deux sens. D’abord, au sens d’une capacité naturelle : nommons-la «rai-
son». Cette nature, comme tout autre, est susceptible de corruption. Ensuite, au sens d’une aptitude éduqué, ce qui
implique une étude de cette nature qui nous fait découvrir les conditions optimales de ses opérations : nommons-la
«raison droite».
Pourquoi chercher à «découvrir une certaine capacité de raisonner» ? Qu’est-ce qui conduit Aristote à la recher-
cher ? Il écrit : «Le philosophe doit être capable de spéculer sur toutes choses [en tant qu’elle est]. Si, en effet, ce
n’est pas là l’office du philosophe, qui est-ce qui examinera si Socrate est identique à Socrate assis , si une seule
chose a un seul contraire, ce qu’est le contraire, en combien de sens il est pris ? Et de même pour les autres ques-
tions de ce genre.» (Métaphysique, 1004b 1-4)
«Qui est-ce qui [examine] (...) les (...) questions de ce genre», par exemple : «si Socrate est identique à Socrate as-
sis , si une seule chose a un seul contraire, ce qu’est le contraire, en combien de sens il est pris», etc., et ce, d’une
manière qui trouble Aristote ? Aristote répond lui-même en ces termes : «Les Sophistes, [ceux] qui revêtent le mas-
que du philosophe (car la Sophistique a seulement l’apparence de la philosophie» ; et il ajoute que «la Sophistique
(...) n’est qu’une Philosophie apparente et sans réalité.»(Métaphysique, 1004b 17 et 26).
Comment obtient-on une telle «Philosophie apparente et sans réalité» ? Aristote répond : «Quant aux tentatives de
certains philosophes, qui, dans leurs discussions sur la vérité, ont prétendu déterminer à quelles conditions on doit
accepter des propositions comme vraies, elles ne sont dues qu’à leur grossière ignorance des Analytiques : il faut, en
effet, connaître les Analytiques avant d’aborder aucune science, et ne pas attendre qu’on vous l’enseigne pour se
poser de pareilles questions. Qu’ainsi il appartienne au philosophe, c’est-à-dire à celui qui étudie la nature de toute
substance, d’examiner aussi les principes du raisonnement syllogistique, cela est évident.» (Métaphysique, 1005b 2-
7)
6
1 Pour les ouvrages d!Aristote, nous utilisons l!édition Vrin, avec Jean Tricot comme traducteur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%