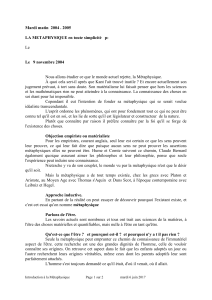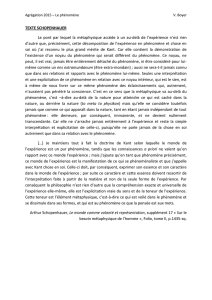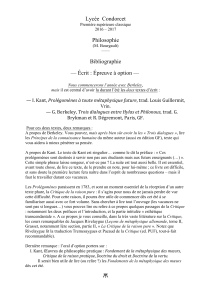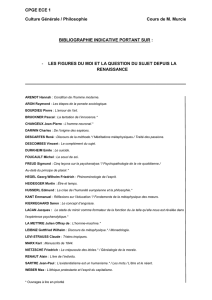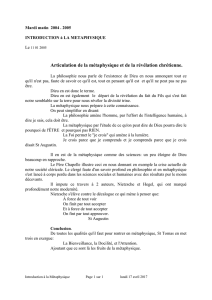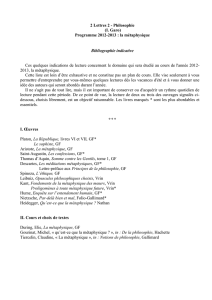Métaphysique et théorie de la représentation. La

Revue Philosophique de Louvain , 2009
1
Métaphysique et théorie de la représentation.
La question des origines du transcendantalisme revisitée.
Dominique Demange
Au siècle dernier, il n’est guère de courant philosophique qui n’ait cherché à se situer, voire à se
définir par rapport à l’héritage de la métaphysique. Objet des plus grandes spéculations, la question de
l’« essence » de la pensée métaphysique s’est nourrie de représentations historiographiques, le plus
souvent bien univoques, la plupart du temps peu ou mal fondées historiquement, et quelques fois
franchement simplistes ou paradoxales, qui constituent aujourd’hui encore le fond de commerce de la
vulgate philosophique. De façon encore modeste mais tout de même remarquable, les recherches sur
l’histoire de la métaphysique commencent enfin à faire sentir leurs effets dans la sphère
philosophique
1
. Le retour aux textes, et singulièrement ceux de la période médiévale, creuse de plus en
plus l’écart entre les représentations modernes et post-modernes sur la métaphysique et son histoire, et
la densité et complexité d’une tradition, qui ne se laisse guère enfermer dans les schémas par lesquels
on a voulu la neutraliser.
Il y a plus d’un demi-siècle, le grand médiéviste Ét. Gilson n’hésitait pas à écrire que « depuis
Descartes jusqu’à tel existentialisme athée de nos jours, le rationalisme philosophique a
confortablement vécu du capital métaphysique accumulé par les théologiens du Moyen Âge. »
2
Les
recherches récentes sur l’histoire de la métaphysique ont largement confirmé ce jugement. Parmi bien
des exemples, on a pu montrer en particulier que l’émergence des structures de la théorie moderne de
la représentation objective, à la charnière des
XIII
e
et
XIV
e
siècles
3
, constitue un évènement majeur pour
l’histoire de la métaphysique, pour ne pas dire un véritable tournant vers sa forme moderne. L’une des
interprétations proposées par les historiens consiste à soutenir que la métaphysique se serait
progressivement développée en une théorie universelle de l’objectité. Pour s’exprimer brièvement, et
en simplifiant beaucoup : après une première période qui, d’Aristote à Thomas d’Aquin, la
caractériserait essentiellement comme cosmo-théologie, la métaphysique aurait pris à l’époque de
Duns Scot un « nouveau commencement », un tournant décisif vers l’ontologie : science des propriétés
universelles de l’étant en tant qu’étant, elle se serait ensuite infléchie en science du quelque chose, du
pensable ou représentable au sens le plus large, bref : de l’objet en général
4
.
1
En témoigne en particulier Nef F., 2004.
2
Gilson Ét., 1952, p. 655.
3
Tachau K. H., 1988 ; Boulnois O., 1999, p. 55-105, p. 405-515.
4
« Un dernier trait permet de caractériser la métaphysique des Modernes, comme ontologie, pour autant qu’elle
ne se détermine plus prioritairement comme scientia transcendens ou scientia transcendentalis, mais plus
rigoureusement comme science surtranscendantale. Le terme, comme on sait, n’aura pas réussi à s’imposer ; il
avait pourtant le mérite de mettre clairement l’accent sur la valeur d’objectité, telle qu’elle préside alors sans
partage à toute question relative à l’objet de la métaphysique. Au titre de théorie surtranscendantale, la
métaphysique moderne n’est point ontologie, mais bien tino-logie, science générale (Leibniz) du cogitabile, de
la chose au sens du ‘quelque chose’. » Courtine J.-F., 1990, p. 537. « En visant la res, la métaphysique
n’atteint au statut de science qu’en abandonnant son objet premier, l’être. La métaphysique ne devient
ontologie qu’en devenant tinologie – science de l’aliquid, de ce qui est comme de ce qui n’est pas. » Boulnois
O., 1999, p. 513. Nous reviendrons plus loin sur la signification du terme ‘surtranscendantal’.

Revue Philosophique de Louvain , 2009
2
Nous reviendrons plus précisément sur cette question dans notre étude : qu’il nous suffise
d’indiquer ici que, selon l’interprétation en question, la métaphysique transcendantale au sens
médiéval se serait progressivement élargie en une théorie universelle de la représentation. Les liens
avec la métaphysique des
XVII
e
et
XVIII
e
siècles pourraient alors être rétablis. Il était licite en effet de
considérer que l’idée d’une théorie transcendantale de la connaissance, telle qu’elle apparaît chez
Kant, n’avait été possible que sur la base de la nouvelle métaphysique, comme science générale de
l’objectité. Et cela pouvait inciter à rechercher plus en amont l’origine du transcendantalisme kantien ;
de sorte que certains ont pu déceler chez Jean Duns Scot déjà, dans sa définition de la métaphysique
comme science des transcendantaux, le point de départ de la seconde métaphysique entendue comme
« science transcendantale » (scientia transcendens) et dont le projet se serait poursuivi, à travers Kant,
jusques chez des auteurs modernes comme Peirce
5
.
Sans chercher à réduire les divergences qui apparaissent entre les travaux d’histoire de la
métaphysique auxquels nous faisons référence, et en priant le lecteur de s’y reporter pour
véritablement les apprécier dans le détail, la question que nous entendons poser dans cet article est de
savoir si le rapport entre métaphysique et théorie de la représentation est bien tel qu’on nous le décrit.
Plus spécifiquement, nous nous demanderons si la perspective générale dans laquelle ces recherches
s’inscrivent, et qui est celle d’une histoire interne de la métaphysique comme science, est bien la
perspective dans laquelle l’évolution observée se laisse traduire de la façon la plus naturelle. Une telle
question peut surprendre, dans la mesure où la question du sujet et de la constitution de la science
métaphysique a été posée depuis Aristote et jusqu’aux temps modernes, de sorte qu’il s’agit là
manifestement d’un fil directeur privilégié pour analyser la conception que les philosophes ont pu se
faire de la connaissance métaphysique aux cours des siècles
6
. On prendra garde cependant que
l’histoire de la métaphysique ne s’identifie pas à l’histoire de la théorie de la métaphysique. On ne
peut ignorer en particulier que les définitions épistémologiques disent la plupart du temps peu de
chose sur la nature et le contenu de la pensée métaphysique elle-même, pour la raison que ce contenu
est largement déterminé par des questions où la métaphysique est mise en rapport à une pensée qui lui
extérieure, et qu’elle tente d’intégrer, ou du moins par rapport à laquelle elle doit se déterminer. C’est
par exemple un fait majeur que l’effort constant de Kant en matière de métaphysique, des écrits pré-
critiques à l’Opus postumum, en passant par les Premiers principes métaphysiques de la science de la
nature, aura été de produire des fondements métaphysiques pour la physique newtonienne. Pour ce qui
est de la pensée médiévale, la question du rapport entre la métaphysique et la théologie révélée montre
de la même façon que la détermination des concepts, problèmes et enjeux de la pensée métaphysique
dépend largement de ce qui se définit épistémologiquement comme lui étant extérieur. La perspective
d’une structure ou constitution épistémologique de la métaphysique apparaît rapidement comme
insuffisante, parce qu’elle suppose que la métaphysique est définissable comme une structure
rationnelle, alors que c’est dans le rapport voire le conflit des rationalités que le contenu propre de la
pensée métaphysique se laisse déterminer.
Ces remarques, certes, n’entâment guère la légitimité du point de vue épistémologique, pour
autant qu’on en reconnaisse les limites. Mais quelles sont-elles précisément ? Et s’agissant en
l’occurrence de l’histoire de la métaphysique, qu’avons-nous à objecter concrètement aux
considérations historiques que nous avons mentionnées ? De façon tout-à-fait préliminaire, deux
objections de fond.
Premièrement, si le concept d’objet ou pensable en général s’impose dès la fin du
XIII
e
siècle,
il n’est pas donné a priori qu’il s’agisse d’un concept ayant une fonction métaphysique (pas davantage
que le concept de ‘signe’, par exemple). Jusqu’au
XVII
e
siècle, bien rares sont les auteurs
7
qui sont
tentés par la définition de la métaphysique comme science ‘surtranscendantale’, c’est-à-dire dont
l’objet transcenderait la distinction de l’être réel et de l’être de raison. Pour F. Suárez en particulier, et
pour la scolastique tardive en général, la métaphysique est une science réelle, et non une science
logique ou une science de la représentation – elle exclut donc de sa sphère l’ens rationis. A fortiori, si
l’on remonte jusqu’aux origines médiévales de ce concept, on trouvera d’autant plus de motifs d’être
5
Honnefelder L., 1979, 1990, 2001, 2002.
6
Pour la période médiévale, voir Zimmermann
A.,
1965 ; Boulnois O., 2001.
7
Selon Doyle J. P., 1998, il n’y a guère que le calviniste Clemens Timpler (1568-1624) qui soutienne cette
thèse.

Revue Philosophique de Louvain , 2009
3
réservé à l’encontre d’une définition ‘tinologique’ de la métaphysique chez Duns Scot et ses
contemporains
8
(comme nous le verrons plus précisément).
Deuxièmement, il n’est pas difficile de s’apercevoir que l’extension du concept de
transcendantalisme de Duns Scot à Kant relève du tour de force
9
. Il est patent en effet que si Kant est
certes parti de la question des fondements de la connaissance objective, pour autant sa théorie
transcendantale de la connaissance sape tout ‘projet’ d’une ontologie première, au sens d’une
métaphysique de l’objectité, à tel point que certains considèrent qu’elle en marque historiquement le
point final.
Lors de la transition du Moyen Âge au Temps Modernes, le développement de la théorie
moderne de la représentation objective a un rapport étroit avec l’évolution de la pensée métaphysique ;
cependant de là à affirmer que la métaphysique, comme science, en serait devenue « métaphysique
transcendantale » ou « métaphysique de l’objectité », c’est passer d’un rapport entre problèmes,
concepts ou questions, à une structure épistémologique, et tout tend à prouver que ce passage ne s’est
pas produit historiquement. D’une part en effet, chez ceux qu’on décrit comme les pionniers de la
nouvelle métaphysique, Henri de Gand (1217-1293) et Jean Duns Scot (1266-1308), on doit renoncer
à leur attribuer la conception « surtranscendantale » ou « tinologique » censée définir la forme de cette
nouvelle métaphysique. D’autre part, à l’autre bout de la chaîne historique, le principe d’un « passage
de relais » entre la métaphysique transcendantale scolastique et la philosophie transcendantale
kantienne pose davantage de problèmes qu’il n’en résout. Si la métaphysique n’a, dans les faits, jamais
été identifiée à une théorie de l’objet en général – sauf peut-être dans le projet leibnizien d’une science
générale –, ce qui semble beaucoup plus évident, en revanche, c’est que le rapport entre métaphysique
et théorie de la représentation a été posé et réfléchi de différentes manières, qu’il a évolué, et qu’il a
constitué un problème – le problème même que la théorie critique de Kant avait pour objet de
résoudre. Prendre la question du rapport entre métaphysique et théorie de l’objet comme un problème,
et non comme une structure : nous avons là peut-être une voie plus praticable pour reprendre la
question de la genèse de la métaphysique moderne. La question – pour le dire autrement – ne serait
plus tant de savoir par quelles voies et sous quelles formes une métaphysique de l’objet de pensée a pu
se constituer, mais au contraire pourquoi elle n’a pas pu se constituer, c’est-à-dire de quelle nature
étaient les problèmes qui la rendaient impossible, problèmes dont certains ne sont manifestement pas
sans avoir joué un rôle dans la genèse de la Critique de la raison pure.
Lorsque Kant est amené à reprendre la question de la possibilité de la métaphysique à
nouveaux frais, c’est, nous le savons bien, pour des raisons intimement liées à sa théorie de la
connaissance. Par quels chemins la théorie de la connaissance nous conduit-elle à la question de la
possibilité de la métaphysique comme science ? La genèse de la pensée critique est suffisamment
documentée, et nous-mêmes sommes trop peu expert en ces questions, pour ne pas nous aventurer très
loin. Nous ouvrirons simplement la fameuse lettre à Markus Herz du 21 Février 1772, document où
Kant se confie sur les motifs fondamentaux qui le guident dans l’élaboration de la Critique de la
raison pure. Or de quoi est-il question dans cette lettre ? De l’articulation onto-théologique de la
métaphysique ? De sa division en métaphysique générale et métaphysique spéciale ? Non pas. Ce dont
nous parle Kant, c’est du rapport de l’intellect humain à l’intellect divin. Cette lettre nous parle des
différences fondamentales entre la pensée humaine et la pensée divine. Et Kant d’indiquer que c’est
dans cette distinction, que se niche la difficulté fondamentale, « la clé du mystère » de la
métaphysique comme science. Relisons donc ce texte célèbre, pour y repérer ce qu’il nous signifie
quant au rôle de théorie de la pensée divine dans la genèse de la Critique de la raison pure :
Tandis que j’examinais point par point la partie théorique dans toute son étendue, avec les rapports
réciproques de toutes les parties, je remarquais qu’il me manquait encore quelque chose d’essentiel que,
8
Ainsi que le souligne Aertsen J.A., 2002, p. 153-156. C’est O. Boulnois lui-même qui remet en question, dans
un article ultérieur à Être et représentation, la possibilité d’une définition tinologique de la métaphysique chez
Duns Scot : « Il n’ouvre pas la voie à une compréhension ‘surtranscendantale’ du concept d’être qui serait
univoquement commun au réel et au rationnel dans l’unité d’une représentation. » O. Boulnois, 2002, p. 74-75.
9
C’est ce que note en particulier Nef F., 2004, p. 262 : « L’hypothèse de Honnefelder a par là quelque chose
d’artificiel et majore, semble-t-il, l’histoire lexicale du transcendantal <…> On pourrait dire que Kant non
seulement détruit la métaphysique comme science transcendante, mais que sa compréhension des
transcendantaux est paradigmatiquement incomparable avec celle des médiévaux. »

Revue Philosophique de Louvain , 2009
4
tout comme d’autres, j’avais négligé dans mes longues recherches métaphysiques, et qui constitue, en fait,
la clé de tout le mystère, celui de la métaphysique jusqu’ici encore cachée à elle-même. Je me demandai,
en effet, sur quel fondement repose le rapport de ce qu’on nomme en nous représentation à l’objet. Si la
représentation ne contient que la façon dont le sujet est affecté par l’objet, il est facile de voir comment
elle lui correspond comme un effet à une cause, et comment cette détermination de notre esprit peut
représenter quelque chose, à savoir un objet. Ainsi les représentations passives ou sensibles ont un rapport
concevable à des objets, et les principes qui dérivent de la nature de notre âme ont une validité concevable
pour toutes les choses, en tant qu’elles doivent être objets des sens. De même, si ce qu’on appelle en nous
représentation était actif vis-à-vis de l’objet, c’est-à-dire si par là même l’objet pouvait être produit,
comme l’on se représente la connaissance divine, en tant qu’archétype des choses, alors la conformité de
ces représentations aux objets serait aussi intelligible. On peut ainsi au moins comprendre la possibilité de
l’intellectus archetypus, sur l’intuition duquel les choses elles-mêmes se fondent, comme celle de
l’intellectus ectypus qui tire les data de sa démarche logique de l’intuition sensible des choses. Mais notre
entendement, n’est pas, par ses représentations, la cause de l’objet (à l’exception des fins bonnes, en
morale) pas plus que l’objet n’est cause des représentations de l’entendement. Les concepts purs de
l’entendement ne doivent donc ni être abstraits des impressions des sens, ni exprimer la réceptivité des
représentations par les sens, mais à la vérité avoir leur source dans la nature de l’âme sans pour autant être
causés par l’objet, ni produire eux-mêmes l’objet. <…> Ces questions entraînent toujours une obscurité
concernant la faculté de notre entendement : d’où lui vient cet accord avec les choses mêmes ? Platon
prenait, comme source originelle des concepts purs de l’entendement, une ancienne intuition spirituelle de
la divinité, Malebranche une intuition permanente et encore actuelle de cet être originel. Différents
moralistes firent justement de même en ce qui concerne les premières lois morales. Crusius admit
certaines règles innées de jugement, et certains concepts que Dieu a déjà implantés dans l’âme humaine
sous la forme qu’ils doivent avoir pour se trouver en harmonie avec les choses. <…> Pourtant le deus ex
machina est, dans la détermination de l’origine et de la validité de nos connaissances, ce qu’on peut
choisir de plus extravagant, et il comporte, outre le cercle vicieux dans la série logique de nos
connaissances, l’inconvénient de favoriser tout caprice, toute pieuse ou creuse chimère.
10
Remarquable introduction, riche d’enseignements, au problème de la déduction transcendantale
des concepts purs de l’entendement. Il y a deux cas où le problème de la déduction ne se pose pas :
pour les objets de la sensibilité (il n’y a pas de déduction des concepts mathématiques, puisqu’ils sont
directement construits dans l’intuition sensible) et pour les objets de l’intellect divin, puisque c’est de
sa pure activité que l’intellectus archetypus tire la possibilité de ses objets. Le problème de la portée
objective des concepts a priori de la métaphysique, et ainsi de la possibilité de la métaphysique
comme science, se ramène ainsi à cette difficulté fondamentale que l’entendement humain n’est ni
passif, ni actif – que les concepts de l’entendement pur « doivent avoir leur source dans la nature de
l’âme sans pour autant être causés par l’objet, ni produire eux-mêmes l’objet ». Toute la théorie
transcendantale vise à résoudre cette difficulté, toute la critique du dogmatisme s’y résume. Le
dogmatisme considère en effet que les concepts premiers de la métaphysique, qui sont en réalité de
simples concepts logiques, ont directement, par cette fonction logique universelle, une portée
ontologique. C’est ignorer que l’entendement humain n’est pas directement constitutif de ses objets ;
c’est en quelque sorte lui préter une puissance comparable à celle d’un intellect divin, celle de
produire directement les objets à partir de leur pure pensée. La suite du texte confirme largement le
rôle de ces questions dans la genèse de la théorie critique. On y voit Kant signaler l’importance
historique du modèle platonicien, y critiquer l’exemplarisme de Malebranche et l’innéisme de Crusius.
C’est bien la détermination du rapport entre la pensée humaine et la pensée divine qui conduit Kant à
formuler cette thèse centrale du criticisme, à savoir l’impossibilité d’un entendement humain intuitif.
Or cette manière de poser la question des fondements de la science et de la connaissance est très
ancienne et classique. Poser la question de l’origine des vérités a priori, des vérités universelles et
indubitables qui doivent fonder la science, à partir de la question de la nature de la pensée humaine,
dans son rapport à la pensée divine, est une approche à ce point ancrée dans la philosophie et la
théologie, qu’elle constitue assurément l’un des fils directeurs les plus solides pour suivre l’histoire de
la métaphysique. Dieu n’est-il pas le fondement ultime de toute vérité ? Et si tel est le cas, comment
cette vérité ultime se transmet-elle à la pensée humaine ? Est-ce par une illumination directe
(Malebranche, Henri de Gand) ? Ou bien est-ce parce que Dieu a créé les vérités universelles qui
gouvernent notre monde, au même titre que toute autre créature de ce monde (Descartes) ? A moins
10
Lettre à M. Herz du 21 Février 1772 (I, p. 691-693)

Revue Philosophique de Louvain , 2009
5
que Dieu n’ait insufflé à sa créature, à sa naissance, des vérités innées (Thomas d’Aquin) ? A moins
encore que l’on ne refuse toute intervention particulière de Dieu dans la production de la vérité
humaine (ce que Kant appelle le « deus ex machina ») mais alors il faudra trouver le fondement de la
connaissance ou bien dans une théorie de l’expérience naturelle, ou bien dans la constitution naturelle
de l’homme (dans « la nature de l’âme », pour reprendre les termes de Kant).
L’idée d’un intellect intuitif est chez Kant à l’horizon de tout le système de la raison pure, à sa
limite précisément, au sens où il le rend possible. La seconde partie de la Critique de la faculté de
juger, avec en particulier la théorie de l’analogie qui s’y rattache, contient de précieux développements
pour comprendre le rapport entre le système de la raison pure et l’intellect divin. Tout système
rationnel ne sera jamais pour nous qu’une représentation, résultat d’une réflexion partant des éléments
de ce système, et non la connaissance de l’idée elle-même du système comme son principe producteur,
opération synthétique que seul un intellectus archetypus pourrait réaliser
11
. Le système de la raison
pure est entièrement suspendu à cette idée d’un intellect intuitif, idée transcendantale qui lui fournit
son schème architectonique. La différence entre les connaissances intuitive et discursive sert de
matrice, aussi bien pour l’architectonique du système de la raison pure lui-même, avec ses divisions
(esthétique, analytique, dialectique), que pour la détermination des questions centrales qui s’y jouent.
En particulier, c’est en se réglant sur le principe de la pensée divine, c’est-à-dire l’idée d’« un
entendement dans lequel tout le divers serait en même temps donné par la conscience de soi »
12
, d’un
sujet qui tire toute sa connaissance de son unité de sujet, que Kant a cherché la solution de la
déduction transcendantale des catégories. Le texte de la déduction de 1787 est à cet égard explicite
13
.
Cette solution, le sujet transcendantal, apparaît comme l’adaptation, aussi proche que possible, du
modèle de la connaissance divine – le modèle d’une production de la connaissance à partir de la
conscience de soi (noesis noeseos) – aux conditions de la connaissance humaine :
L’intellect divin (a) tire toute sa connaissance de la conscience de soi et (b) produit les objets par cette
conscience de soi ;
Le sujet transcendantal (a) tire toute sa connaissance a priori de la conscience de soi et (b) réalise la
synthèse du divers de l’expérience par cette conscience de soi.
Ce schéma détermine les requisit de la déduction transcendantale. Ce faisant, il nous montre le
rôle majeur qu’y joue le paradigme de la science divine, et en cela la pensée kantienne s’inscrit dans
une longue tradition métaphysique et théologique. Dans cet article, c’est le fil conducteur de ce
paradigme de la pensée divine que nous entendons suivre, ou plutôt simplement repérer, pour
esquisser une histoire de la métaphysique à grande échelle. Pour procéder à ce repérage, nous partirons
de Kant pour remonter à l’époque médiévale. On nous pardonnera à ce sujet de revenir sur des textes
de Kant que le lecteur considérera peut-être comme bien connus, mais il nous a semblé nécessaire de
souligner, avec une précision suffisante, la détermination kantienne du rapport entre le métaphysique
et le transcendantal, de sorte à dissiper, sans plus d’ambiguïté possible, l’illusion d’une continuité
épistémologique de la métaphysique. Ceci nous permettra de dégager le noyau de la question
transcendantale chez Kant et d’attester alors de son affinité avec l’ancienne question de la science
divine. On nous pardonnera aussi de ne pas avoir repéré la totalité du trajet, c’est-à-dire de ne pas
11
CFJ, §77 (trad. p. 346-347). Sur la théorie de l’analogie, voir CFJ, §59 (trad. p. 263-265).
12
CRP, B135 (I, p. 855)
13
« Un entendement dans lequel tout le divers serait donné en même temps par la conscience de soi
intuitionnerait ; le nôtre ne peut que penser et doit chercher l’intuition dans les sens. Je suis donc conscient du
moi identique, par rapport au divers de mes représentations qui me sont données dans une intuition, puisque je
les nomme toutes mes représentations, qui n’en forment qu’une. Or, cela revient à dire que j’ai conscience
d’une synthèse nécessaire a priori de ces représentations, qui est l’unité synthétique originaire de l’aperception
<…> Mais ce principe n’en est pourtant pas un pour tout entendement possible en général, mais seulement
pour celui dont la pure aperception dans la représentation : je suis ne fournit encore aucun divers. Cet
entendement, dont la conscience de soi donnerait en même temps le divers de l’intuition, un entendement dont
la représentation ferait en même temps exister les objets de cette représentation, un tel entendement n’aurait
pas besoin d’un acte particulier de la synthèse du divers dans l’unité de la conscience, comme en a besoin
l’entendement humain, qui pense seulement et n’intuitionne pas. Mais pour l’entendement humain, l’acte de la
synthèse est bien inévitablement le premier principe… » CRP, B135-139 (I, p. 855-58)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%