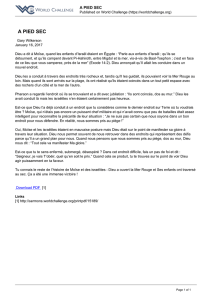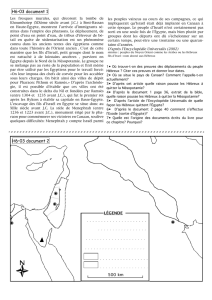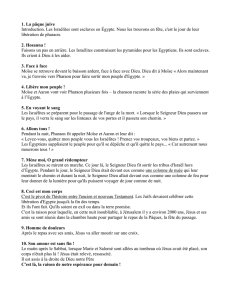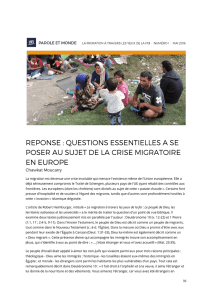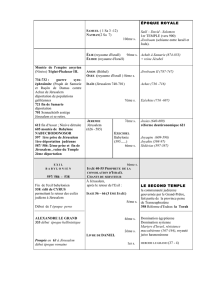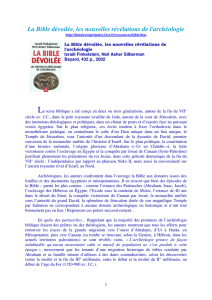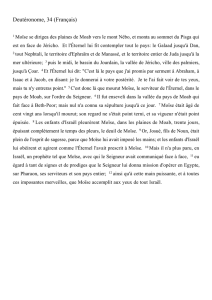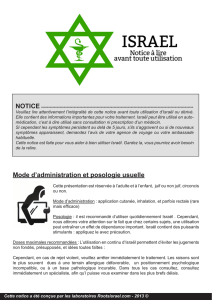Les Asiatiques, Assyriens, Hébreux, Phéniciens

HISTOIRE UNIVERSELLE
Les Asiatiques, Assyriens, Hébreux, Phéniciens
(de 4000 à 559 av. J.-C.)
Par Marius Fontane

CHAPITRE PREMIER
L’Asiatique. - L’Euphrate et le Tigre. - Le Schat-et-Arab. - La Mésopotamie et ses quatre zones. - La
Babylonie. - La Chaldée. - La mer Persique. -L’Assyrie, œuvre des eaux, ouverte à tous. - Climats.
- Flore. - Le palmier. - Confusion ethnographique. - Faune. - Les sauterelles et le ramarmar. -
L’empire Assyrien
CHAPITRE II
DE 4000 A 2500 Av. J.-C. - L’histoire d’Assyrie. - Nemrod et Assur. - La terre de Sennaar. - Les
empires. - Les cunéiformes. - Découvertes. - La civilisation chaldéenne. - Accads et Soumirs. -
L’invasion touranienne. - Les vieux Assyriens. - Our et les Hébreux. - Aram et les Araméens. -
Première dynastie chaldéenne. - Chaldéens, Babyloniens et Ninivites. - L’Assyrien
CHAPITRE III
DE 2500 A 1559 Av. J.-C. - Aryas en Mésopotamie. - Dynastie mède ou aryenne. - Dynastie
assyrienne. - Chodorlahomor. - Dynastie chaldéenne. - Ismidigan. - Hammourabi. - Thoutmès Ier
et Thoutmès III. - La confédération syrienne. - Rotennou et Khétas. - L’empire chaldéen. -
Civilisation. - Monuments. - Navigation. - Armes et outils. - Cylindres. - Arts et sciences. -
Magisme. - La caste des Chaldéens. - Influence égyptienne
CHAPITRE IV
DE 1559 A 1130 Av. J.-C. - La Mésopotamie vassale de l’Égypte. - Dynastie arabe ou syrienne, ou
chaldéenne, ou chananéenne. - La statuaire. - La légende de Ninus et de Sémiramis. - Ninive et
Babylone.- Bataille d’Élassar. - Adarpelassar bat Binbaladan.- Ninive l’emporte sur Babylone. -
Téglath-Phalasar Ier, roi de Ninive, éclipse la gloire des Thoutmès. - Fin des Égyptes
CHAPITRE V
DE 1288 A 1110 Av. J.-C. - Décadence de l’Égypte. - Arisou et Nekht-Séti. - Ramsès III. - La
grande coalition : Libyens, Asiatiques et Européens. - Ba-taille de Péluse. - Effondrement de
l’Égypte. - Caricatures. - Les Ramessides. - Domination du corps sacerdotal. - Divinités.- Culte. -
Débauches et superstitions.- Le prêtre Her-Hor, pharaon. - Piankhi et Smendès (XXIe dynastie)
CHAPITRE VI
DE 2500 A 900 Av. J.-C.- Égypte, Syrie, Assyrie.- Les Touraniens en Bactriane.- Zoroastre en Iran.
- Les Aryas de l’Inde et de l’Iran. - Exode des Iraniens hors de la Bactriane. - Yezd, la ville sainte. -
Les Iraniens en Perside et en Carmanie. - Iraniens et Touraniens en Médie. - Mèdes, Perses et
Susiens. - L’assyrien Belkatirassou en Médie. - Formation du groupe mède, national. - La langue
médique. - Les mages
CHAPITRE VII
DE 1100 A 800 Av. J.-C. - Asiatiques et Européens. - Querelles en Assyrie. -- Téglath-Phalassar Ier
et Mardochidinakhé. - La dynastie de Belkatirassou. - Binlikhous II - Téglath-Samdan II. -
Assournazirpal. - Salmanassar IV et les rois de Juda et d’Israël. - L’art assyrien. - La Ninive
antique. - La première Babylone. - Les villes assyriennes. - Les rois. - Bas-reliefs. - Guerres et
chasses royales. - Harem

CHAPITRE VIII
DE 2000 A 800 Av. J.-C. - La Syrie et les Syriens. - Damas et Alep. - La Syrie géologique. - Le
Liban. - Flore et Faune. - Routes, rivières et lacs. - Mer Morte.- Côtes. - Ethnographie. - Divinités
localisées. - Druzes et Ansariehs. - Le Désert de Syrie. - Caravanes. - Trafics. - Les Araméens. -
Influence chaldéenne. - La déesse Atagardis. - L’empire d’Israël
CHAPITRE IX
La Bible. - L’histoire du peuple d’Israël. - La géographie biblique. - Moïse. - Divisions historiques. -
Le Pentateuque : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. - Josué. - Les Juges. -
Cantique de Déborah. - Ruth. - Samuel. - Les Rois. - Chroniques. - Esdras et Néhémie. - Esther. -
Judith. - Job. -- Les Psaumes. - Les Proverbes. - L’Ecclésiaste. - Le Cantique des cantiques. - La
Sapience. - Tobie. - Jonas. - Suzanne. - Bel. - Les pages de Darius. - Baruch. - Les prophètes ou
nabis
CHAPITRE X
DE 2500 A 1300 Av. J.-C. - Exode de Chaldéens en Mésopotamie. - Exode d’Abraham en Syrie, en
Chaman, en Égypte. - La vocation d’Abraham. - Élohim et Jéhovah. - La race hébraïque. - Abraham
vainqueur de Chodorlahomor. - Isaac et Ismaël. - Jacob et Esaü. - Les Ismaélites. - Jacob chez
Laban. - Rachel et Lia. - Massacre des Sichémites. - Les douze fils de Jacob. - Joseph. - Les
Hébreux en Gessen
CHAPITRE XI
DE 1400 A 1300 Av. J.-C. - Moïse à la cour de Ramsès II ; chez les Madianites ; devant Ménephtah
Ier. - Les dix plaies d’Égypte. - La verge d’Aaron. - Exode des Israélites. - La Pâque. - Passage de
la mer Rouge. - L’esprit et l’œuvre de Moïse. - Les deux Israélites. - L’autel et le tabernacle. - La
traversée du désert. - Miracles. - Le veau d’or. - Moïse au Sinaï. - La Loi. - Aaron chef du
sacerdoce. - Révolte et châtiment du lévite Coré. - Aspersions sanglantes. - Le Décalogue
CHAPITRE XII
DE 2200 A 1300 Av. J.-C. - La terre promise.- Josué et Caleb. - Les Chananéens. - La marche des
Hébreux. - Balaam. - Moabites et Madianites. - Victoire d’Israël. - Butin. - Recensement. - Partage
du territoire conquis, à l’est du Jourdain. - Mort de Moise. - Son couvre. - La Palestine. - La
Samarie. - La Galilée. – La destinée d’Israël. - Jérusalem. - L’enfer
CHAPITRE XIII
DE 1350 A 1200 Av. J.-C. - Passage du Jourdain. - Prise de Jéricho. - Partage de la Palestine. -
Mort de Josué. - La Phénicie. - Histoire des Phéniciens. - Adonis. - Phéniciens et Grecs. - La toison
d’or. – Sidon et Tyr. - Le pieu de Baal. - Les Pélasges. – Premières colonies agricoles. - Les
Phéniciens en Grèce. - Les bêtes et les hommes. - Jérusalem la pacifique
CHAPITRE XIV
DE 1288 A 1051 Av. J.-C. – Anarchie en Israël. - La femme. - Les juges on suffètes. - Othoniel,
Aod, Déborah, Gédéon, Abimélek, Jephté. - Les Philistins. - Exploitation du sacerdoce. - Théocratie.
- Samson - Samuel. - École de prophètes. - La royauté. - Saül. - David. - L’armée d’Israël. - Les
Tyriens. - Divinités phéniciennes. - Tyr et Jérusalem

CHAPITRE XV
DE 1051 A 1019 Av. J.-C. - Vieillesse, abdication et mort de David. - La société hébraïque. -
Monothéisme. - Les prophètes Gad et Nathan. - Salomon, roi. - L’empire d’Israël. - La cour. -
L’armée. – Alliance avec les Phéniciens et les Égyptiens.- Juda et Israël. - Les revenus de
Jérusalem. - La reine de Saba. - La nouvelle Tyr. - Hiram et Salomon
CHAPITRE XVI
DE 1019 A 978 Av. J.-C. - Salomon et Hiram. - L’art phénicien. - Architecture chananéenne. – Le
premier temple de Jérusalem. - Le palais de Salomon. - Polythéisme du roi d’Israël. - Navigation. -
Ophir. - Commerce. - Palmyre (Tadmor). - La vieillesse de Salomon. - Jéroboam révolté. - L’Égypte
: XXIe dynastie. - Le pharaon Sésac, ou Sheshonk Ier. - Mort de Salomon
CHAPITRE XVII
DE 978 A 888 Av. J.-C. - Le schisme d’Israël. - Roboam et Jéroboam. - Israélites et Judéens. -
Le pharaon Sheshonk à Jérusalem. - Égypte : XXIIe dynastie. - Le royaume d’Éthiopie. -
Rois d’Israël et rois de Juda. - Rois et prophètes. - Samarie. - Achab et Jézabel. - Le prophète Élie.
- Ben-Hidri, roi de Damas. - Josaphat. - Le prophète Élisée. - Joram
CHAPITRE XVIII
DE 888 A 759 Av. J.-C. – Joram assiégé dans Samarie. - Élisée et Hazaël. - Ochozias. - Jéhu. -
Jézabel. - Athalie. - Joas et Joïada. – Zacharie lapidé. - Amasias. - Joachas.- Ben-Hidri III. - Prêtres
et prophètes. - Joas pille Jérusalem. - Amasias. - Ozias. - Joatham. - Jéroboam II. - Amos, Joël et
Isaïe. - Le Messie. - Interrègne. - Osée. - La grande prostitution d’Israël. - Manahem II,
vassal du roi d’Assyrie
CHAPITRE XIX
DE 905 A 704 Av. J.-C. - L’Égypte après Sheshonk. - L’Assyrie. - Salmanassar IV. - Samas-Bin. -
Binlikhous III et Sammouramit (Sémiramis). - Salmanassar V. - Assourédilili II. - Assourlikhous
(Sardanapale). - Arbace. - Phul-Balazou, roi de Babylone. - Téglath-Phalassar II. - Nabonassar. -
Phacée et Achaz. - La grande faiblesse de Juda. - Transportation. - Salmanassar VI. – Le pharaon
Schabak. - Sargon. - Mérodach-Baladan. – La nouvelle Ninive. - Le palais de Khorsabad. -
Sennachérib
CHAPITRE XX
DE 810 A 681 Av. J.-C. - Les Samaritains. - Ézéchias. - Soulèvement de la Palestine. - L’Égypte -
XXIIIe, XXIVe et XXVe dynasties. - Bocchoris et Schabak (Sabacon). - Campagnes de Sennachérib.
– Siège de Jérusalem. - Isaïe et Michée. - Ninive. - Palais de Kouyoundjik. - L’art arménien. -
Souzoub à Babylone. - Fondation de Tarse. - Assourahaddon, roi d’Assyrie
CHAPITRE XXI
DE 698 A 622 AV. J.-C. - Manassé. - Mort d’Isaïe Ier. - Les Juifs à Ninive. - Assourahaddon et
Assourbanipal. - L’Asie Mineure : Cariens, Phrygiens et Lydiens. - Barbares et Grecs. - L’Égypte :
XXIVe dynastie. - Psamétik Ier. - L’art éthiopien. - Bas-reliefs de Kouyoundjik. - Troubles en Israël.
- Amon succède à Manassé. - Josias, roi par le peuple. - Jérémie et Sophonias. – La Loi. - Les
prophètes. - Les décalogues et le Deutéronome

CHAPITRE XXII
DE 647 A 605 Av. J.-C. - Assourédilili III roi d’Assyrie. - Le royaume des Mèdes. - Le magisme. -
Déjocès. - Phraorte. - Les Perses. – Achœménès. - Cyaxare et Nabopolassar. - Parthes et Scythes.
- Destruction de Ninive. - Alyatte et Cyaxare. - Agitations en Israël. - Mort de Josias. - Jérusalem
vassale de Néchao. - Éliakim (Joiakim). - Néchao battu par Nabuchodonosor. - Le prophète
Habacuc. - Jérémie appelle les Chaldéens
CHAPITRE XXIII
DE 625 A 588 Av. J.-C. - Nabopolassar et Nitacris. - Travaux à Babylone. - Nabuchodonosor et
Néchao II. - Joiakim. - Joyakim. - Sédécias. - Jérémie accepte la domination chaldéenne. -
Astyage. - Apriès. - Destruction de Jérusalem. - Supplice et mort de Sédécias. - Exode en Égypte. -
Godolias. - Ézéchiel. - Nabuchodonosor en Égypte et en Phénicie. - Fin du royaume de Juda. -
Captivité des Israélites à Babylone.- Térédon
CHAPITRE XXIV
DE 1400 A 588 Av. J.-C. - Mœurs d’Israël. - Les songes. - Superstitions. - Les Hébrao-Égyptiens. -
L’Hébreu. - La femme. - Polygamie. - Les enfants. - L’esclavage. - Nourriture. - Industrie. - Trafic.
- Routes commerciales. - Mesures et poids. - Société. - Monothéisme et monarchie. - La propriété.
- Les usuriers. - Les rois d’Israël. - Le trésor royal. - Impôts et corvées. - La Jérusalem nouvelle
CHAPITRE XXV
DE 1400 A 588 Av. J.-C. - La justice en Israël. - Crimes et délits. - Peines. - Trafic des
témoignages. - L’armée. - Stratégie. - Mercenaires. - L’idée de patrie. - Jérusalem et Samarie. -
Divinités. - Élohim et Jéhovah. - Culte. - Idoles.- Offrandes. - Religion. - Prêtres, prophètes et rois.
- Le Messie. - Le dieu d’Israël. - L’homme. - La mort, fin de tout
CHAPITRE XXVI
DE 1400 À 588 Av. J.-C. - La mort et les funérailles en Israël. - Morale. - Philosophie. - La femme,
grande coupable. - La création. - Le déluge. - La fin du monde. - Géographie et ethnographie
bibliques. - Histoire. - Sciences. - Astronomie. - Chronologie. - Cosmographie. - Médecine. - Arts. -
Sculpture. - Musique. - Danse. - Littérature. - La Bible. - Fin d’Israël
CHAPITRE XXVII
DE 665 A 559 Av. J.-C. - Les Juifs à Babylone. - L’Égypte : XXVIe dynastie. - Ahmès (Amosis)
s’allie aux Perses et appelle les Grecs. - Les Touraniens : Mongols, Scythes et Parthes. - Isolement
de Babylone. - Nabuchodonosor et les Juifs. - Évilmérodach. - La Jérusalem d’Ézéchiel et d’Isaïe II.
- Le Messie : Cyrus, roi des Perses. - Les Afghans. - Les Aryas de l’Inde. - Le Mahabharata et le
Ramayana. - La grande guerre. - Le Bouddha Çakya-Mouni. - Perses, Mèdes et Grecs. - Asie et
Europe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
1
/
183
100%