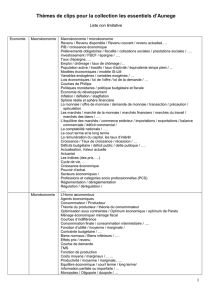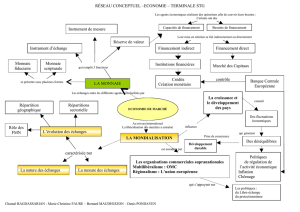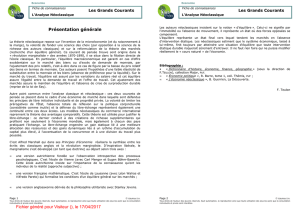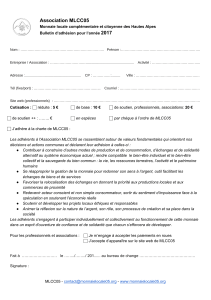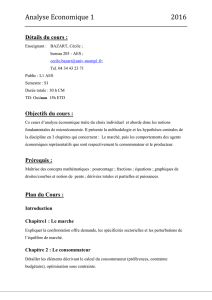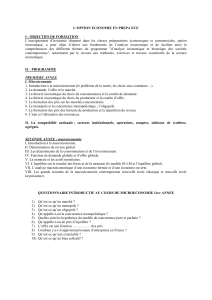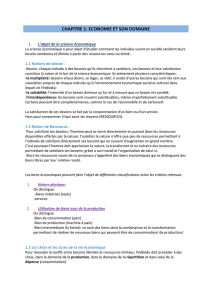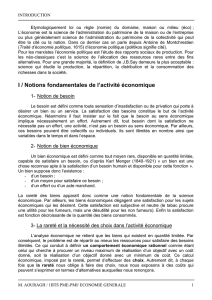pensée économique (CR)

ESH____________________________________________________________________________________________%Dossier%du%chapitre%3%
Classe%d’ECO1%//%2013<2014.%
1
Chapitre)2)________________________________________%Les%grands%courants%de%l’analyse%économique%depuis%le%XVIème%siècle%
C.%RODRIGUES.%//%LYCEE%MILITAIRE,%AIX%EN%PROVENCE%
%
Economie(–(Sociologie(–(Histoire(
Classe(d’ECO1(
!
"#$%&'()!*!
Les(grands(courants(de(l’analyse(économique(
depuis(le(XVIème(siècle(
C.%Rodrigues%
!
«)Une)science)ne)débute)qu’avec)une)délimitation)suffisante)des)problèmes)susceptible)de)
circonscrire)un)terrain)de)recherches)sur)lequel)l’accord)des)esprits)est)possible)».)
J.#Piaget.)Epistémologie)des)sciences)de)l’homme,)1970.%
!
Introduction(//(
+,-./0/1&)!$0'&23)!
!
45!6)(.$0'&7&81)!)'!%#98&/.($'&)!
!
1.1.%La%doctrine%mercantiliste%
1.2.%La%physiocratie%:%circuit%économique%et%libéralisme%
%
:5!+)8!-./0/1&8')8!.7$88&23)8!
2.1.%A.%Smith%:%libéralisme%et%main%invisible%
2.2.%Les%classiques%et%les%théories%de%la%valeur%
%
2.2.1. A. Smith : la valeur travail commandé
2.2.2. D. Ricardo et K. Marx : la valeur travail incorporée
%
2.3.%Les%classiques%et%la%répartition%des%revenus%
2.3.%Les%classiques%et%l’arbitrage%consommation%/%épargne%
*5!+$!'#-/(&)!0-/.7$88&23)!)'!7,-./7)!$3'(&.#&)00)!
3.1.%Une%école%fondatrice%:%le%marginalisme%
3.2.% La% théorie% néoclassique%:% équilibre% partiel,% équilibre% général% et% concurrence%
imparfaite%
3.3.%L’école%autrichienne%
%
%
%

ESH____________________________________________________________________________________________%Dossier%du%chapitre%3%
Classe%d’ECO1%//%2013<2014.%
2
Chapitre)2)________________________________________%Les%grands%courants%de%l’analyse%économique%depuis%le%XVIème%siècle%
C.%RODRIGUES.%//%LYCEE%MILITAIRE,%AIX%EN%PROVENCE%
%
%
;5!<5=65!>)90)8!?!30!%(/@)'!($A&.$7!
%
4.1.%Le%statut%de%la%monnaie%et%la%critique%de%l’autorégulation%par%le%marché%
4.2.%La%macroéconomie%keynésienne%:%demande%effective%et%équilibre%de%sous<emploi%
%
B5!+)8!'#-/(&)8!-./0/1&23)8!./0')1%/($&0)8!?!30!()0/3C)77)1)0'!
A)8!A-D$'8!
%
5.1.%Le%modèle%d’équilibre%général%de%Arrow%et%Debreu%:%les%derniers%néoclassiques%?%
5.2.%La%théorie%des%jeux%:%une%rupture%épistémologique%?%
5.3.%La%Nouvelle%école%classique%:%rationalité%et%efficience%des%marchés%
5.4.%La%Nouvelle%école%keynésienne%:%rationalité%et%défaillance%des%marchés%
%
%
( (

ESH____________________________________________________________________________________________%Dossier%du%chapitre%3%
Classe%d’ECO1%//%2013<2014.%
3
Chapitre)2)________________________________________%Les%grands%courants%de%l’analyse%économique%depuis%le%XVIème%siècle%
C.%RODRIGUES.%//%LYCEE%MILITAIRE,%AIX%EN%PROVENCE%
%
Dossier(documentaire(
!
Document(1(//(
Les(mercantilistes(et(les(physiocrates(
!
E0!%7$.)!AF#$D&'3A)!7F/(&G&0)!A3!8$C/&(!-./0/1&23)!.#)H!I(&8'/')!JKL)!8&M.7)!$C$0'!<5="5N!23&!$O!)0!)PP)'O!(-P7-.#&!83(!.)!
23F&7!$%%)7$&'!4FQ./0/1&23)!)'!23&!./08'&'3$&'O!8)7/0!73&O!30)!D($0.#)!%$('&.37&M()!A)!7$!R.&)0.)!A)!7FS/11)5!I(&8'/')!
A&C&8)!7$!R.&)0.)!A)!7FS/11)!)0!'(/&8!D($0.#)8!?!7$!8.&)0.)!A)!7F$.'&C&'-!&0A&C&A3)77)O!7F-'#&23)!T!7$!8.&)0.)!A)!7F$.'&C&'-!)0!
P$1&77)O!7F-./0/1&23)!T!7$!8.&)0.)!A)!7$!C&)!A$08!7$!.&'-O!7$!%/7&'&23)5!I(&8'/')!)08)&G0)!23)!7$!.#(-1$'&8'&23)O!.F)8'=U=A&()!
7$!8.&)0.)!A)!7F$.23&8&'&/0!A)8!(&.#)88)8O!)8'!30)!D($0.#)!A)!7F-./0/1&23)!?!$3'()1)0'!A&'O!7$!%(/A3.'&/0!A)!(&.#)88)8!
A/&'!8)!P$&()!A$08!7$!P$1&77)!)'!%/3(!7$!P$1&77)5!I3!0/1!A)!.)!%(&0.&%)O!I(&8'/')!./0A$10)!J$88)H!7/G&23)1)0'N!7)!%(V'!U!
&0'-(V'!J/0!0)!8$3($&'!%(V')(!$C).!&0'-(V'!U!30!1)1D()!A)!7$!P$1&77)NO!7)!'($C$&7!8$7$(&-!J/0!0)!8$3($&'!$.#)')(!7)!'($C$&7!
AF30!1)1D()!A)!7$!P$1&77)N!)'!7)!./11)(.)!J%3&823)!7$!%(/A3.'&/0!A/&'!8)!P$&()!A$08!7$!P$1&77)O!%/3(!7$!P$1&77)N5!I&08&!
$C).!I(&8'/')O!7$!8.&)0.)!A)!7$!%(/A3.'&/0!)8'!)0P)(1-)!A$08!30)!8.&)0.)!A)!7$!C&)!P$1&7&$7)O!$%%)7-)!%/3(!.)'')!($&8/0!
7F-./0/1&23)!J./11)!7F&0A&23)!7F-'91/7/G&)!A3!1/'O!-C/23$0'!7)8!W(MG7)8!A)!7$!1$&8/0XN5!
+)! 8$C/&(! -./0/1&23)! /..&A)0'$7! $! 83D&! 7$! %)8$0')! &0P73)0.)! $(&8'/'-7&.&)00)! @3823FU! 7$! P&0! A3! 6/9)0! IG)5! +FYG7&8)!
.$'#/7&23)!$!P/(137-O!)0! )PP)'O!30)!A/.'(&0)!-./0/1&23)!)'!8/.&$7)!AF&08%&($'&/0!$(&8'/'-7&.&)00)5!E(O!$3Z! [L)! )'![LK)!
8&M.7)8O!7$!\)0$&88$0.)!)8'!1$(23-)!%$(!7F$8.)08&/0!&((-8&8'&D7)!A3!.$%&'$7&81)!./11)(.&$7!P/0A-!@38')1)0'!83(!7)!%(V'!U!
&0'-(V'O!7)!'($C$&7!8$7$(&-!)'!7)!./11)(.)5!K7!)8'!.7$&(!A-8/(1$&8!23)!7)!0/3C)$3!1/A)!A)!%(/A3.'&/0!$%%)77)!30!0/3C)$3!
8$C/&(! -./0/1&23)! A&PP-()0'! A)! .)73&! AFI(&8'/')5! ")! 0F)8'! %$8! A$08! 7$! P$1&77)! 0&! %/3(! 7$! P$1&77)! 23)! A/&'! 8)! P$&()! 7$!
.(-$'&/0!A)!(&.#)88)8O!1$&8!A$08!7$!0$'&/0!)'!%/3(!7$!0$'&/05!+FY'$'O!23&!)8'!7F$3'/(&'-!.#$(G-)!A)!A-P)0A()!7)8!&0'-(V'8!A)!
7$!0$'&/0O! A/&'! $7/(8!)0./3($G)(! )'! 8'&137)(! 7$! %(/A3.'&/0! A)! (&.#)88)8! ?! ')7! )8'!7)!P/0A)1)0'!A)! 7$! 0/3C)77)! A/.'(&0)!
1)(.$0'&7&8')!J[LK)!)'![LKK)!8&M.7)8!83('/3'N5!
])!.)! P$&'O!7F/D@)'!A3!8$C/&(!-./0/1&23)!8)!'($08P/(1)!?!8)8!P(/0'&M()8!8F-7$(G&88)0'5!+F-./0/1&)!A)C&)0'!%/7&'&23)!$3!
8)08!7&''-($7O!.F)8'=U=A&()!-')0A3)!U!'/3'!7F#/(&H/0!A)8!&0A&C&A38!J$3'()1)0'!A&'O!7)!%$98!'/3'!)0'&)(N!?!7F$A@).'&P!%/7&'&23)O!
23&!C&)0'!A3!G().!W%/7&8X!J.&'-NO!($%%)77)!AF$&77)3(8!23)O!%/3(!7)!^().!A)!7FI0'&23&'-O!.)'!#/(&H/0!-'$&'!8$!.&'-5!
])! 83(.(/_'O! 7$! %()1&M()! $%%$(&'&/0! A)! 7F)Z%()88&/0! W! -./0/1&)! %/7&'&23)! X! 8)! P$&'! @/3(! A$08! 7)! `($&'-! AF-./0/1&)!
%/7&'&23)!AFI0'/&0)!A)!6/0'.#()8'&)0!J4a4BN5!+$!8.&)0.)!-./0/1&23)!8F)8'!A-8/(1$&8!A/00-)!7$!A&1)08&/0!0-.)88$&()!U!
7F-.7/8&/0!AF30)!%)08-)!W!1$.(/-./0/1&23)!X5!])!P$&'O!.F)8'!U!.)'')!-%/23)!23F$%%$($&88)0'!7)8!%()1&M()8!G($0A)8!7/&8!
1$.(/-./0/1&23)85!I&08&O!<5!b/A&0!J4BacO!\-%/08)8!$3Z!%$($A/Z)8!A)!65!A)!6$7)8'(/&'!'/3.#$0'!7F)0.#-(&88)1)0'!A)!
'/3')8!.#/8)8NO!)0!)Z%7&23$0'!7$!#$388)!A3!0&C)$3!G-0-($7!A)8!%(&Z!%$(!7)!G/0P7)1)0'!A)!7$!1$88)!1/0-'$&()!J$PP73Z!A)!
1-'$3Z!%(-.&)3ZNO!@)'')!7)8!P/0A)1)0'8!A)!7$!'#-/(&)!23$0'&'$'&C)5!
6$&8O! .F)8'! 83('/3'! U! %$('&(! A3! [LKKK)! 8&M.7)! J7)! W8&M.7)! A)8! +31&M()8XN! )'! 7$! ().#)(.#)! A-7&D-(-)! A)! 7/&8! 0$'3()77)8!
G/3C)(0$0'! 7$! 8/.&-'-! A$08! 8/0! )08)1D7)O! 23F30)! $3'#)0'&23)! (-P7)Z&/0! -./0/1&23)! C$! 8)! P$&()! @/3(! ?! d5! e3)80$9!
J%(/1/')3(!A3!.&(.3&'!-./0/1&23)!A$08!8/0!`$D7)$3!-./0/1&23)O!4fBcN!)'!I5!R1&'#!JU!30!1/&0A()!A)G(-O!.)%)0A$0'N!
8/0'!A)8!%(-.3(8)3(8!A)!7F$0$798)!1$.(/-./0/1&23)5!
Les(idées(mercantilistes(
g/0!8)37)1)0'!&7!0F)Z&8')!%$8!AF-./7)!A)!%)08-)!1)(.$0'&7&8')!$3!8)08!8'(&.'O!1$&8!7$!0/'&/0!1V1)!A)!1)(.$0'&7&81)!$!-'-!
&0'(/A3&')O! $%(M8! ./3%O! %$(! A)8! -./0/1&8')8! 23&! G-0-($7)1)0'! 0/3((&88$&)0'! A)8! &0')0'&/08! %/7-1&23)8! U! 7F-G$(A! A)!
.)3Z!23F&78!()G(/3%$&)0'!8/38!.)'')!-'&23)'')5!"F)8'!IA$1!R1&'#!23&O!)0!4ffa!&0'(/A3&'!7)!')(1)!W898'M1)!1)(.$0'&7)X!
%/3(!A-0/0.)(!.)!23F&7!./08&AM()!./11)!7)8!A$0G)()38)8!./0P38&/08!A)!7$!1$@/(&'-!A)!8)8!%(-A-.)88)3(85!
")8!A)(0&)(8!8/0'!)0!(-$7&'-!$88)H!A&PP-()0'8!7)8!308!A)8!$3'()8O!8)7/0!7)!%$98!)'!7F-%/23)!/h!&78!-.(&C)0'5!+$!%-(&/A)!A3!
W898'M1)!1)(.$0'&7)X!A)!R1&'#!./(()8%/0A!$3Z!'(/&8!8&M.7)8!23&!8-%$()0'!7$!8/.&-'-!1-A&-C$7)!A3!.$%&'$7&81)!&0A38'(&)75!
+/&0!A)!./08'&'3)(!30!898'M1)!P&G-O!7$!(-P7)Z&/0!-./0/1&23)!-C/73)!$3!P&7!A)!.)'')!'($08&'&/05!
RF&7!9!$!8$08!A/3')O!A$08!.)8!./0A&'&/08O!23)723)!$D38!U!%$(7)(!AF30)!A/.'(&0)!1)(.$0'&7&8')O!&7!0F)0!()8')!%$8!1/&08!23)!
7)8! $3')3(8! A-8&G0-8! %$(! .)! ')(1)! 1$0&P)8')0'! .)('$&0)8! %(-/..3%$'&/08! )'! $''&'3A)8! ./1130)8O! 23&! 7)8! A&8'&0G3)0'!
$88)H!0)'')1)0'O!'$0'!A)!7$!A/.'(&0)!'#/1&8')!A3!6/9)0!IG)!23)!A)!7F-./0/1&)!.7$88&23)!23&!%()0A($!8/0!)88/(!U!7$!P&0!
A3
ESH____________________________________________________________________________________________%Dossier%du%chapitre%2%
Classe%d’ECO1%//%2013<2014.%
4
Chapitre)2)________________________________________%Les%grands%courants%de%l’analyse%économique%depuis%le%XVIème%siècle%
C.%RODRIGUES.%//%LYCEE%MILITAIRE,%AIX%EN%PROVENCE%
4
7F/(G$0&8$'&/0! A)! 7$! 1$&8/0! )'! 23)! 7$! %/7&'&23)! '($&')! A)! 7$! C&)! A)! 7$! .&'-O! 7)8! A)3Z! ')(1)8! 8/0'! %/3(! 7$! %()1&M()! P/&8!
$../3%7-8! %$(! 7)! d($0j$&8! I0'/&0)! A)! 6/0'.#()8'&)0! )0! 4a4B5! ")'')! 0/3C)77)! A&8.&%7&0)! )8'! )0C&8$G-)! %$(! 7)8!
1)(.$0'&7&8')8!A)!P$j/0!)88)0'&)77)1)0'!%($G1$'&23)5!")8!$3')3(8!.#)(.#)0'!$C$0'!'/3'!U!%(/%/8)(!A)8!1/9)08!)PP&.$.)8!
%/3(!$..(/_'()!7$!%3&88$0.)!%/7&'&23)!A3!(/9$31)!)0!A-C)7/%%$0'!8$!%3&88$0.)!-./0/1&23)O!)'!7)3(8!k3C()8!%()00)0'!
P(-23)11)0'! 7$! P/(1)! A)! ().3)&78! A)! W().)'')8X! 83GG-(-)8! $3! 8/3C)($&0! J$&08&! 7)! `($&'-! AF-./0/1&)! %/7&'&23)! A)!
6/0'.#()8'&)0O!A-A&-!$3!(/&O!7)!@)30)!+/3&8![KKKO!)'!U!7$!()&0)=1M()!6$(&)!A)!6-A&.&8N5!
`)03)8!)0!838%&.&/0!%$(!7FYG7&8)!)'!1-%(&8-)8!%$(!7F$(&8'/.($'&)!')((&)00)O!7)8!$.'&C&'-8!./11)(.&$7)8!)'!1$03P$.'3(&M()8!
8/0'!1&8)8! U! 7F#/00)3(! %$(! 7)8! 1)(.$0'&7&8')85! ")3Z=.&!.#)(.#)0'!U! A-1/0'()(!23F&7! )Z&8')!30)! %(/P/0A)!./0C)(G)0.)!
AF&0'-(V'8!)0'()!7)!8/3C)($&0!)'!7)8!1$(.#$0A8!A3!(/9$31)5!Q0!AF$3'()8!')(1)8O!7$!%3&88$0.)!%/7&'&23)!A3!%()1&)(!%$88)!
%$(!7F)0(&.#&88)1)0'!A)8!8)./0A85!I!7F$%%3&!A)!.)'')!'#M8)O!7)8!1)(.$0'&7&8')8!A-C)7/%%)0'!30)!$0$798)!1/0-'$&()!23&O!
%$(P/&8!U!@38')!'&'()!1$&8!8/3C)0'!A)!P$j/0!$D38&C)O!7)3(!$!C$73!%$(!7$! 83&')!7F$..38$'&/0!A)! WD377&/0&81)X!J$1/3(!A3!
7&0G/'O!A)!7F$0G7$&8!D377&/0N!/3!A)!W!.#(98/#-A/0&81)!X!J$''&'3A)!%7$j$0'!7)!D/0#)3(!A$08!7F/(NO!)Z%()88&/08!A-8&G0$0'!7$!
./0P38&/0!A)!7$!(&.#)88)!)'!A)!7F/(5!
+)!%/&0'!A)!A-%$('!A)!.)'')!$0$798)!)8'!7F&A-)!8)7/0!7$23)77)!7$!%3&88$0.)!A3!8/3C)($&0!()%/8)!83(!30)!7$(G)!A&8%/0&D&7&'-!
A)!1-'$3Z!%(-.&)3Z!J/(!)'!$(G)0'N5!")3Z=.&!%)(1)'')0'!)0!)PP)'!A)!%$9)(!7)8!A-%)08)8!(/9$7)8O!)0!%$('&.37&)(!AF)0'()')0&(!
30)!P/(')!$(1-)5!"/11)!7$!%)(.)%'&/0!A)!7F&1%l'!%)(1)''$0'!AF$7&1)0')(!7)8!.$&88)8!A3!`(-8/(!(/9$7!)8'!AF$3'$0'!%738!
$&8-)!23)!7$!.&(.37$'&/0!1/0-'$&()!J%&M.)8!AF/(!)'!AF$(G)0'N!)8'!$D/0A$0')!A$08!7)!(/9$31)O!&7!&1%/(')!A/0.!AF$883()(!
.)'')!$D/0A$0.)5!
6$&8!7FQ3(/%)!)8'!%$3C()!)0!1&0)8!AF/(!)'!AF$(G)0'O!)'!8$!8/3(.)!%(&0.&%$7)!AF$%%(/C&8&/00)1)0'!)0!1-'$3Z!%(-.&)3ZO!
./08'&'3-)! U! %$('&(! A3! [LK)! 8&M.7)! %$(! 7)8! 1&0)8! AFI1-(&23)O! )8'! 1/0/%/7&8-)! %$(! 7FQ8%$G0)! J%(&0.&%$7)! %3&88$0.)!
)3(/%-)00)!U!7F-%/23)!A)!"#$(7)8!e3&0'N5!K7!&1%/(')!A/0.O!%/3(!7)8!$3'()8!Q'$'8O!A)!7$!.$%')(!%$(!A&C)(8!1/9)085!I!.l'-!
A)!7$! ./0'()D$0A)!)'!A)! 7F$.'&C&'-!A)8!./(8$&()8!23&! &0')(.)%')0'!7)8!G$7&/08!)8%$G0/78O!7)8!1)(.$0'&7&8')8!()1$(23)0'!
23F30!1/9)0!)PP&.$.)!)8'!AF$C/&(!30)!D$7$0.)!./11)(.&$7)!)Z.-A)0'$&()O!.F)8'=U=A&()!A)!P$&()!)0!8/(')!23)!7$!C$7)3(!A)8!
)Z%/('$'&/08!7F)1%/(')!83(!.)77)!A)8!&1%/('$'&/085!Q0!)PP)'O!7)8!'($08$.'&/08!&0')(0$'&/0$7)8!-'$0'!%$9-)8!)0!%&M.)8!AF/(!
/3! AF$(G)0'O! 30! )Z.-A)0'! ./11)(.&$7! &1%7&23)! 23)! 7)8! P73Z! AF)0'(-)! A)! 1-'$3Z! %(-.&)3Z! 7F)1%/(')0'! 83(! 7)8! P73Z! A)!
8/('&)O!)'!A/0.!23)!7)!8'/.m!AF/(!)'!AF$(G)0'!)0!.&(.37$'&/0!A$08!7)!%$98!8F$..(/_'5!i/3(!/D')0&(!.)!(-837'$'O!&7!./0C&)0'!
A/0.!A)!P$C/(&8)(!7F$.'&C&'-!A)8!1$(.#$0A8!A3!(/9$31)5!
+)8!W().)'')8X!%(-./0&8-)8!%$(!7)8!1)(.$0'&7&8')8!8/0'!A)!'9%)!0)'')1)0'!&0')(C)0'&/00&8')5!d$C/($D7)8!U!7F$.'&C&'-!A)8!
1$(.#$0A8O! 7)8! 1)(.$0'&7&8')8! 0F)0! 8/0'! %$8! %/3(! $3'$0'! A)8! %$('&8$08! A3! 7&D-($7&81)! -./0/1&23)O! '#M1)! 23&! 0)! 8)!
A-C)7/%%)($! C-(&'$D7)1)0'! 23F$3! [LKKK)! 8&M.7)5! +FY'$'! A/&'! 8)7/0! )3ZO! %$(! A)! 137'&%7)8! (-G7)1)0'$'&/08! )'! %$(! A)8!
&0.&'$'&/08! A&C)(8)8O! &0')(C)0&(! A$08! 7F$.'&C&'-! -./0/1&23)! A3! %$98! %/3(! 7$! 8'&137)(! )'! 7F/(&)0')(! A$08! 7$! A&().'&/0!
$%%(/%(&-)5!
i(-/..3%-8!%$(!7)!8/7A)!A3!./11)(.)!)Z'-(&)3(O!7)8!1)(.$0'&7&8')8! 8/0'! $1)0-8! U! %(/%/8)(! A)8!1)83()8! ./0.)(0$0'!
7F$.'&C&'-! -./0/1&23)! &0')(0)! A3! (/9$31)5! E(! &7! )8'! A&PP&.&7)! A)! A-P&0&(! A)8! 1)83()8! )PP&.$.)8! 8$08! 30)! .)('$&0)!
&0')77&G)0.)! A)8! ()7$'&/08! .$($.'-(&8$0'! 7)! P/0.'&/00)1)0'! A)! 7F-./0/1&)! 0$'&/0$7)5! "F)8'! %/3(23/&! 7)8! 1)(.$0'&7&8')8!
.#)(.#)0'! U! %(-.&8)(! 7)8! 7&$&8/08! )Z&8'$0'! )0'()! A)8! C$(&$D7)8! ')77)8! 23)! 7$! 1$88)! 1/0-'$&()O! 7$! A)1$0A)! )Z')(0)! )'!
&0')(0)O!7)!0&C)$3!A)8!%(&Z!7F&0'-(V'O!7F)1%7/&555!")!P$&8$0'!&78!@)'')0'!7)8!%()1&M()8!D$8)8!AF30)!A&8.&%7&0)!23&!8)($!A-8&G0-)!
D)$3./3%!%738!'$(A!8/38!7)!0/1!A)!1$.(/-./0/1&)5!
!
Le(libéralisme(de(Boisguillebert(
i/3(!23)!7F&A-)!8F&1%/8n'!23)!A)8!1-.$0&81)8!0$'3()78!G/3C)(0)0'!7F)08)1D7)!A)!7$!C&)!-./0/1&23)O!&7!P$77$&'!(/1%()!
$C).!7)8!C3)8!A3!1)(.$0'&7&81)!%/3(!7)23)7!7F&0')(C)0'&/0!A)!7FY'$'!)8'!./08'$11)0'!0-.)88$&()!U!7F)0(&.#&88)1)0'!A)!7$!
0$'&/0!T!)'!&7!P$77$&'!$PP&(1)(!23)!7$!7&D)('-!A)8!-.#$0G)8!)8'!7$!./0A&'&/0!0-.)88$&()!)'!83PP&8$0')!A)!7F/(A()!-./0/1&23)5!
o0)!&1%/('$0')!./0'(&D3'&/0!U!7F-A&P&.$'&/0!A)!7$!8.&)0.)!-./0/1&23)O!U!7$!P&0!A3![LKK)!8&M.7)O!)8'!./0')03)!A$08!7F/)3C()!
AF30! 1$G&8'($'! P($0j$&8O! i&)(()! +)! i)8$0'O! 8)&G0)3(! A)! b/&8G3&77)D)('O! 7&)3')0$0'! G-0-($7! A3! D$&77&$G)! A)! \/3)05! +$!
(-P/(1)! A)8! &1%l'8! &0&23)8! A)! 7F$0.&)0! (-G&1)!)8'! U! 7F/(A()! A3! @/3(!)0! d($0.)!U! .)! 1/1)0'5! "F)8'! .)! 83@)'! 23)!C)3'!
$D/(A)(!b/&8G3&77)D)('!)0!%3D7&$0'!)0!4apf!8/0!7&C()!+)!A-'$&7!A)!7$!d($0.)5!")'!/3C($G)!0F$9$0'!%$8!)3!D)$3./3%!A)!
83..M8O!7F$3')3(!%3D7&)!)0!4fqf!30!0/3C)$3!7&C()!83(!7)!1V1)!83@)'O!+)!P$.'31!A)!7$!d($0.)5!")'')!P/&8!7F/3C($G)!$''&()!
A$C$0'$G)!7F$'')0'&/05!K7!)8'!&0')(A&'!%$(!30!$((V'!A3!"/08)&7!A3!(/&O!)'!7F$3')3(!)8'!)Z&7-!)0!I3C)(G0)5!R)8!$3'()8!-.(&'8!
P3()0'!%3D7&-8!%$(!73&!)0!4f4:!8/38!7)!'&'()!A)!`)8'$1)0'!%/7&'&23)!A3!1$(-.#$7!A)!L$3D$05!K78!./0'&)00)0'O!0/'$11)0'O!
A)3Z!-.(&'8!&1%/('$0'8!%/3(!7F#&8'/&()!A)!7$!%)08-)!-./0/1&23)!?!30!`($&'-!A)8!G($&08!)'!30)!]&88)('$'&/0!83(!7$!0$'3()!
A)8! (&.#)88)8O! A)! 7F$(G)0'! )'! A)8! '(&D3'85! +$! (-P/(1)! P&8.$7)! %/3(! 7$23)77)! b/&8G3&77)D)('! $! C/373! 73'')(! ./08&8')! %/3(!
7F)88)0'&)7! A$08! 7$! 1/A&P&.$'&/0! A)! 7F$88&)'')! A)! 7$! W`$&77)XO! )0! C3)! A)! 83%%(&1)(! 7)8! )Z)1%'&/08! A)8! (&.#)8O! A$08! 7$!
.(-$'&/0!AF30!&1%l'!83(!7)!()C)03!A)!'/38!7)8!D&)08O!)0P&0!A$08!7$!83%%()88&/0!A)8!W$&A)8XO!&1%l'!&0A&().'!83(!7$!C)0')!A3!
C&0O!)'!A)8! ]/3$0)8!)Z'-(&)3()8!)'!&0'-(&)3()85! ")! 23&! A/&'!&.&!()')0&(!83('/3'! 0/'()! $'')0'&/0! )8'! 23)! 7F$3')3(! $%%3&)!
'/3')8!8)8!A-1/08'($'&/08!83(!7F$(G31)0'!83&C$0'!?!7$!./08/11$'&/0!)8'!7$!8/3(.)!A3!A-C)7/%%)1)0'!A)!7$!(&.#)88)!T!&7!
P$3'!A/0.!83%%(&1)(!7)8!&1%l'8!23&O!-'$0'!%$9-8!83('/3'!%$(!7$!G($0A)!1$88)!A)8!./08/11$')3(8O!7&1&')0'!7$!A)1$0A)!
A)8!%(/A3&'85!

ESH____________________________________________________________________________________________%Dossier%du%chapitre%2%
Classe%d’ECO1%//%2013<2014.%
5
Chapitre)2)________________________________________%Les%grands%courants%de%l’analyse%économique%depuis%le%XVIème%siècle%
C.%RODRIGUES.%//%LYCEE%MILITAIRE,%AIX%EN%PROVENCE%
5
I&08&O!%/3(!'(/3C)(!7)8!.$38)8!A)!7$!(3&0)!A)!7$!d($0.)O!&7!0)!P$3'!23)!A-./3C(&(!.)77)!A)!7$!(3&0)!A)!7$!./08/11$'&/0!?!&7!9!
)0! $! A)3Z! )88)0'&)77)8555! +$! ./08/11$'&/0! $! .)88-! %$(.)! 23F)77)! )8'! A)C)03)! $D8/731)0'! A-P)0A3)! )'! $D8/731)0'!
&1%/88&D7)5!Q77)!)8'!A-P)0A3)O!%$(!7F&0.)('&'3A)!A)!7$!`$&77)555!)0P&0!7$!./08/11$'&/0!)8'!A)C)03)!&1%/88&D7)!%$(!7)8!I&A)8!
)'!%$(!7)8!]/3$0)8!83(!7)8!8/('&)8!)'!%$88$G)8!A3!\/9$31)555!
b/&8G3&77)D)('!0)!1-%(&8)!%$8!7$!A)1$0A)!-'($0GM()!)'!&7!C)3'!7$&88)(!7&D()!7F)Z%/('$'&/0!A)8!D7-85!6$&8!&7!1)'!83('/3'!
7F$..)0'!83(!7)!(l7)!A)!7$!A)1$0A)!&0'-(&)3()!A)!1$(.#$0A&8)85!Q'!AF$3'()!%$('O!U!7$!A&PP-()0.)!A)8!1)(.$0'&7&8')8O!.F)8'!7)!
A-C)7/%%)1)0'!A)!7$!A)1$0A)!A)8!%(/A3&'8!$G(&./7)8O!)'!0/0!A)8!%(/A3&'8!&0A38'(&)78O!23F&7!C)3'!AF$D/(A!$883()(5!
+)8!1)(.$0'&7&8')8!C)37)0'!A-C)7/%%)(!7F)Z%/('$'&/0!A)8!%(/A3&'8!1$03P$.'3(-8!%/3(!P$&()!)0'()(!7)8!1-'$3Z!%(-.&)3Z5!
Q0!1V1)!')1%8O!&78!%(-./0&8)0'!7F&0')(A&.'&/0!A)!7$!8/('&)!A)8!A)0(-)8!$7&1)0'$&()8!)88)0'&)77)8!U!7$!C&)5!+)3(!$''&'3A)!
)8'!)0./()O!./11)!$3!6/9)0!IG)O!A&.'-)!%$(!7)!8/3.&!A)!1$&0')0&(!A$08!7)!%$98!/3!AF9!$''&()(!'/3'!.)!23&!)8'!0-.)88$&()!U!
7F)Z&8')0.)5!
b/&8G3&77)D)('O!$3!./0'($&()O!().#)(.#)!7)8!./0A&'&/08!23&!%)(1)'')0'!A)!%/(')(!U!8/0!0&C)$3!7)!%738!-7)C-!7$!%(/A3.'&/0!
&0'-(&)3()! A3! (/9$31)O! )'! AF$D/(A! 7$! %(/A3.'&/0! $G(&./7)5! Q'! &7! .(/&'! A-./3C(&(! 23)! .)8! ./0A&'&/08! 8)! (-831)0'! A$08!
7F$D/7&'&/0!A)8!)0'($C)8!$3!./11)(.)O!)'!A$08!7$!7&D)('-!A)8!1$(.#-8O!.$(O!8&!7)8!1$(.#-8!8/0'!7&D()8O!30!-23&7&D()!0$'3()7!
A)8! %(&Z! 8F-'$D7&'O! 23&! %)(1)'! U! .#$23)! %(/A3.')3(! A)! C)0A()! 0/(1$7)1)0'! 8$! %(/A3.'&/05! Q'! .F)8'! $&08&! 23)! 7$!
%(/A3.'&/0!$'')&0'!8/0!0&C)$3!1$Z&1315!+F&A-)!23)!b/&8G3&77)D)('!A-C)7/%%)!7/0G3)1)0'!A$08!8$!]&88)('$'&/0!83(!7$!
0$'3()! A)8! (&.#)88)8! )8'! 23)! 7)8! A&C)(8)8! %(/P)88&/08! AF30! %$98! 8)! 8)(C)0'! 13'3)77)1)0'! A)! A-D/3.#-8! %/3(! 7)3(8!
%(/A3.'&/08!?! W!K7! P$3'! ./0C)0&(! AF30! %(&0.&%)O! 23&! )8'! 23)! '/3')8! 7)8! %(/P)88&/08O! 23)77)8! 23F)77)8! 8/&)0'! A$08! 30)!
./0'(-)O!'($C$&77)0'!7)8!30)8!%/3(!7)8!$3'()8O!)'!8)!1$&0'&)00)0'!(-.&%(/23)1)0'O!0/0!8)37)1)0'!%/3(!7$!P/3(0&'3()!A)!
7)3(8!D)8/&08O!1$&8!1V1)!%/3(!7)3(!%(/%()!)Z&8')0.)5!I3.30!0F$.#M')!7$!A)0(-)!A)!8/0!C/&8&0!/3!7)!P(3&'!A)!8/0!'($C$&7!
23FU! 30)! ./0A&'&/0! A)! (&G3)3(O! 23/&23)! '$.&')! )'! 0/0! )Z%(&1-)O! 8$C/&(! 23)! 7)! C)0A)3(! )0! P)($! $3'$0'! A)! .)77)! A)!
7F$.#)')3(O! /3! &11-A&$')1)0'O! ./11)! &7! $((&C)! 23)723)P/&8O! /3! %$(! 7$! .&(.37$'&/0! A)! %738&)3(8! 1$&08! /3! %(/P)88&/08!
&0')(%/8-)8!T!.)!23&!()C&)0'!'/3@/3(8!$3!1V1)X!J]&88)('$'&/0!83(!7$!0$'3()!A)8!(&.#)88)8N5!
")'')!.(-$'&/0!&0.)88$0')!A)!A-D/3.#-8!13'3)78!)8'!7$!D$8)!A)!7$!%(/8%-(&'-!G-0-($7)5!i/3(!23)!.)'')!%(/8%-(&'-!%3&88)!
$%%$($_'()!A$08!7)8!P$&'8O!&7!P$3'!)'!&7!83PP&'!23)!7)8!%(&Z!8/&)0'!-'$D7&8!./0P/(1-1)0'!U!7$!@38'&.)O!.F)8'=U=A&()!A/00)0'!U!
'/38!7)8!C)0A)3(8!30!G$&0!0/(1$75!E(!7)!1/9)0!AF/D')0&(!.)!(-837'$'!)8'!A)!7$&88)(!$G&(!7$!0$'3()5!R&!7F/0!&0')(C&)0'!83(!7)8!
1$(.#-8O!0/'$11)0'!$P&0!AF$D$&88)(!7)!%(&Z!A)8!G($&08O!$3!7&)3!AF$&A)(!7)8!1$7#)3()3ZO!/0!.(-)!7$!1&8M()!G-0-($7)5!K7!)8'!
&.&! 0)'')1)0'! $PP&(1-! 23)! 7$! .(-$'&/0! A)! 7$! (&.#)88)! ()%/8)! 83(! 7)! 1-.$0&81)! A)! 7$! P/(1$'&/0! A)! %(&Z! 0/(1$3ZO! 23&!
$883()! 7$! (-$7&8$'&/0! A)8! P&08! %/3(83&C&)8! %$(! 7)8! &0A&C&A38! &0A-%)0A$11)0'! 7)8! 308! A)8! $3'()85! K7! 0)! 8F$G&'! %738! A)!
7F$PP&(1$'&/0!A)!')77)!/3!')77)!7/&!%$('&.37&M()!U!30!.)('$&0!A/1$&0)!A)!7F$.'&C&'-!-./0/1&23)O!7$!1/00$&)O!/3!7)!./11)(.)!
)Z'-(&)3(5!K7!8F$G&'!AF30)!7/&!0$'3()77)!(-G&88$0'!7$!'/'$7&'-!A)!7$!8%#M()!A)!7$!%(/A3.'&/0!)'!A)!7F-.#$0G)5!RF&7!)8'!C($&!23)!
b/&8G3&77)D)('!%$(C&)0'!7)!%()1&)(!U!./0.)C/&(!7F)Z&8')0.)!AF30)!')77)!7/&O!/0!%)3'!D&)0!7)!./08&A-()(!./11)!7)!C-(&'$D7)!
P/0A$')3(!A)!7F-./0/1&)!%/7&'&23)5!
!
e3)80$9!)'!7)!.&(.3&'!A)!7F-./0/1&)!
d($0j/&8!e3)80$9!)8'O!A$08!7$!8)./0A)!1/&'&-!A3 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%