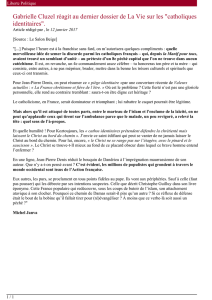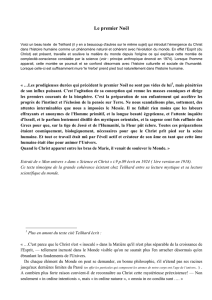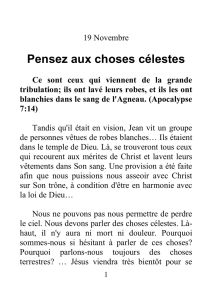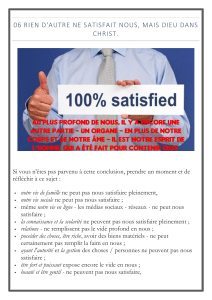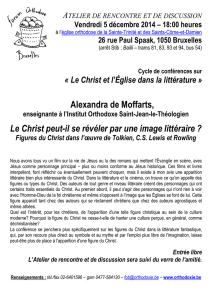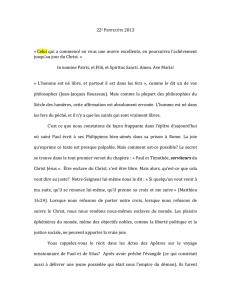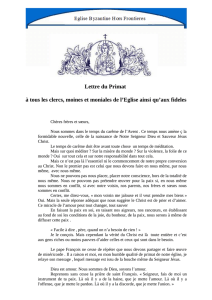thomatique

2e dimanche après l’Epiphanie
UN TRIPLE VIN.
Ils n’ont plus de vin. (Joan. 2)
Avant l’Incarnation de Jésus-Christ, trois sor-
tes de vins faisaient défaut : le vin de la justice, ce-
lui de la sagesse, celui de la charité ou de la grâce.
1° Le vin est âpre au goût ; et c’est en ce sens que
la, justice est appelée un vin. Le Samaritain de l’Évan-
gile (Luc 10) a appliqué au blessé de la route le vin et l’hui-
le, c’est-à-dire, avec la douceur de la miséricorde, la sévé-
rité de la justice. Vous nous avez fait boire un vin d’amertume
(Ps. 59, 5).
Le vin aussi réjouit le cœur, comme dit le Psaume
(103, 15) : Le vin réjouit le cœur de l’homme. Et sous ce rap-
port, la sagesse est dite un vin ; car, la méditation de
la sagesse donne une très grande joie. Il n’y a nulle amertume
dans sa société, nul ennui à vivre avec elle ; il n’y a que contente-
ment et joie. (Sap. 8, 16.) De même, le vin enivre ; l’épouse
du Cantique dit : Mangez, amis, buvez, enivrez-vous mes bien-
aimés. (Cant. 5, 6) et, sous ce rapport, la charité est
appelée un vin. J’ai bu mon vin et mon lait, dit encore l’Épou-
se (ibid.). La charité est dite aussi un vin, en raison
de sa ferveur. Le froment fera croître les jeunes gens, et le vin
nouveau les vierges, dit le Prophète Zacharie. (9, 17.)
2° En vérité, le vin de la justice manquait dans
l’Ancienne Loi, dont la justice était imparfaite.
Mais le Christ l’a perfectionnée. Je vous déclare, dit-il, que
si votre justice ne surpasse pas celle des Scribes et des Pharisiens,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. (Matth. 5, 20.)
Le vin de la sagesse y manquait aussi ; car, tout
y était énigmatique et gural. Toutes choses leur
sont arrivées en gure, dit saint Paul. (I Cor. 10). Mais
thomatique
Les Textes du
LA MOELLE DE SAINT THOMAS D’AQUIN
Méditations pour tous les jours de l’année liturgique tirées des oeuvres de St Thomas
par le R.P. Mézard O.P.
deuxième semaine après l’Epiphanie
le Christ a tout révélé car il enseignait comme ayant autorité.
(Matth. 7, 29.)
Le vin de la charité manquait aussi, parce qu’ils
avaient seulement reçu l’esprit de servitude dans
la crainte. Mais le Christ a changé l’eau de la crainte, en
vin de la charité, quand, il a donné un Esprit d’adoption
en qui nous crions : Abba, Pater (Rom., vin, 15) et quand
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint
qui nous a été donné (ibid. 5, 5).
(Sur saint Jean, c. 2.)
Lundi
LA VIE DE JÉSUS PARMI LES HOMMES.
Dieu a apparu sur la terre et il a vécu
avec les hommes. (Baruch, 3, 38)
Le Christ devait avoir un mode de vie confor-
me au but de son Incarnation. Pourquoi, en e et,
était-il venu en ce monde ?
1° Tout d’abord, a n de manifester la vérité : Je
suis né et je suis venu dans le monde, dit-il lui-même en saint
Jean (18, 37), pour rendre témoignage à la vérité. Aussi ne de-
vait-il pas se cacher en menant une vie solitaire, mais se
produire en public, en prêchant ouvertement. A ceux qui
voulaient le retenir, il répondait : Il faut que j’annonce le rè-
gne de Dieu aux autres bourgades, car c’est pour cela que j’ai été
envoyé. (Luc 4, 43.)
2° En second lieu, il est venu pour délivrer les
hommes de leurs péchés : Le Christ Jésus, écrit saint
Paul à Timothée (I Tim. 1, 15) est venu en ce monde pour
sauver les pécheurs. Aussi, selon la remarque de saint Jean
Chrysostome : « bien que le Christ eût pu, tout en demeu-

Les textes du Thomatique
Consultables par arborescence ou moteur de recherche sur www.dici.org
2
rant dans le même lieu, attirer à lui tous les hommes, an
qu’ils entendissent sa prédication, il en a agi autrement : il
nous a ainsi donné l’exemple, pour que nous allions à la re-
cherche de ceux qui périssent comme le pasteur se met à
la poursuite de la brebis perdue, et que le médecin se rend
auprès des malades ».
3° En troisième lieu, le Christ est venu an que
par lui nous ayons accès auprès de Dieu ainsi que
saint Paul le dit aux Romains (5, 2). Aussi convenait-il
que, vivant familièrement avec les hommes, il inspirât à
tous la conance d’aller à lui. On lit dans saint Matthieu
(9, 10) : Jésus étant à table, un grand nombre de publicains et de
pharisiens vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Ce que
saint Jérôme commente en ces termes : « Voyant que le
publicain Matthieu s’était converti de ses péchés à
une vie meilleure, et avait trouvé l’occasion de fai-
re pénitence, eux-mêmes ne désespéraient pas de
leur salut ».
C’est par son humanité que le Christ a voulu
manifester sa divinité. Par suite, c’est un vivant
parmi les mortels, comme il convient à un homme,
qu’il a manifesté à tous qu’il était Dieu, prêchant,
faisant des miracles et menant parmi les hommes
une vie d’innocence et de justice.
(III q. XL, a. I.)
Mardi
LA VIE ACTIVE DE JÉSUS-CHRIST.
I
À la vie contemplative convient, au plus haut
point, la solitude : Je la conduirai au désert, dit le Proverbe
Osée, (2, 14), et je lui parlerai au cœur. À cause de cela, en
soi, la vie contemplative vaut mieux que la vie ac-
tive, qui ne comporte, que des actes corporels. Mais la
vie active, qui consiste à livrer aux autres, par la
prédication et l’enseignement, les vérités que l’on
a contemplées, est plus parfaite que la vie qui n’est
que contemplative, puisqu’elle présuppose une
abondance de contemplation. Aussi, est-ce sur
une vie active de cette espèce, que le Christ a por-
té son choix.
II
Cependant, le Christ recherchait parfois, pour
fuir la foule, les lieux solitaires. Saint Rémi l’observe :
« Le Seigneur avait à sa disposition trois refuges : une bar-
que, la montagne, le désert ; chaque fois qu’il était pressé
par la foule, c’est de l’un de ces refuges qu’il usait ».
Or, ce que le Christ a fait, il l’a pratiqué pour no-
tre instruction. Si donc parfois le Seigneur s’est retiré
de la foule, c’était an de donner aux prédicateurs l’exem-
ple de ne pas toujours se produire en public.
D’une telle conduite, on nous livre trois motifs
divers :
a) Tantôt le Christ veut que l’on prenne un re-
pos corporel ; d’après saint Marc, le Seigneur dit à ses
disciples : Venez à l’écart, dans un lieu désert, et prenez un peu de
repos. Il y avait, en eet, ajoute saint Marc, tant de person-
nes qui allaient et venaient, que les Apôtres n’avaient pas
même le temps de manger (6, 31).
b) Tantôt le Christ, en vue de la prière, se retire :
En ces jours-là, dit saint Luc (6, 12), Jésus se retira sur la mon-
tagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Comme le
dit saint Ambroise, « par son exemple il nous instruit des
préceptes de la vertu ».
c) Tantôt enn, le Christ nous apprend à fuir
les faveurs des hommes. Aussi, à propos de ce texte
de saint Matthieu : Jésus voyant la foule, monta sur la mon-
tagne, saint Jean Chrysostome écrit-il : « En parlant, non
pas dans les villes, ni sur les places publiques, mais sur la
montagne et dans la solitude, le Christ nous a enseigné, à
ne rien faire par ostentation, et à nous éloigner des tumul-
tes, surtout lorsqu’il faut discourir sur ce qui est nécessai-
re au salut ».
(III q. XL, a. 1, 2, et ad 3)
Mercredi
LE CHRIST NE DEVAIT PAS MENER
UNE VIE AUSTÈRE.
Le Fils de l’Homme est venu mangeant et buvant.
(Matth. 9, 19)
On a dit déjà que le but de l’Incarnation deman-
dait que le Christ ne menât pas une vie solitaire,
mais vécût parmi les hommes. Or, il importe souve-
rainement que celui qui vit avec d’autres se conforme à
leur genre de vie : Je me suis fait tout à tous, dit saint Paul
aux Corinthiens. (I Cor. 9, 22.) Voilà pourquoi il conve-
nait au plus haut point que le Christ se rangeât à
la manière habituelle de se nourrir. Saint Augustin
l’écrit dans son livre contre Faustus : « On dit de Jean qu’il ne
mangeait, ni ne buvait, parce qu’il ne se nourrissait pas comme les
Juifs. Mais si le Seigneur ne s’était pas comporté comme ceux-ci,
on n’aurait pas dit de lui, par comparaison avec Jean, qu’il man-
geait et buvait ».
Dans son mode de vie, le Christ a donné l’exem-
ple de la perfection, en tout ce qui se rapporte im-
médiatement au salut. Quant à l’abstinence du boire
et du manger, elle ne concerne pas directement le salut ;
saint Paul le remarque : Le royaume de Dieu ne consiste pas
dans le boire et le manger. (Rom. 14, 17.)

La moelle de St Thomas - 2 Epiphanie
le Thomatique ? Une base de données d’articles de fond touchant à la foi catholique.
3
Saint Augustin, dans ses Questions sur les Évangiles, ex-
plique le verset de saint Matthieu (11, 18) : La sagesse a été
justiée par ses enfants, de la façon suivante : « Les saints
Apôtres ont compris que le royaume de Dieu
consistait, non dans le boire et le manger, mais
dans une parfaite égalité d’âme », eux que l’abondan-
ce n’exalte pas, non plus que la disette ne les déprime. »
Et dans son troisième livre De la Doctrine Chrétienne, saint
Augustin écrit encore : « En toutes ces sortes de choses, ce
n’est pas l’usage, mais le désir de celui qui en use, qui peut
être coupable ». Or, il est également licite et louable, ou de
garder l’abstinence en se séparant du commun des hom-
mes, ou de se ranger à une vie commune, en demeurant
dans la société des humains. Aussi, le Seigneur a-t-il vou-
lu donner l’exemple de ces deux modes de vie. Saint Jean
Chrysostome l’observe, « tandis que Jean n’avait à son
service que sa vie et sa justice, le Christ avait le té-
moignage de ses miracles. Tout en laissant Jean
briller par son jeûne, lui-même a donc procédé par
une vie contraire : il a pris place à la table des pu-
blicains, et il y a mangé et bu ».
C’est le même Docteur qui dit encore : « Si le Christ
a jeûné, c’est pour que l’on apprenne quel est le
bienfait du jeûne, quel bouclier il constitue contre
le démon, et combien après le baptême, il est né-
cessaire de se livrer, non à l’intempérance, mais au
jeûne. Ce n’est pas par besoin que le Christ a jeû-
né, mais pour notre instruction. Son jeûne ne dépas-
sa pas celui de Moïse et d’Élie, pour qu’on ne refusât pas
de croire qu’il avait pris une chair humaine ».
Cependant, ce ne fut pas sans raison que le Christ,
après avoir jeûné dans le désert, revint au mode habituel
de vivre. N’est-ce pas là, en eet, une obligation pour ceux
dont le rôle est de transmettre aux antres les vérités qu’ils
ont contemplées ? Ce rôle, le Christ ne l’a-t-il pas rempli ?
Aussi bien, après s’être adonné à la contemplation,
est-il descendu sur le terrain de l’action, en vivant
avec les autres hommes : « Le Christ a jeûné, écrit saint
Bède, an que vous n’en violiez pas le précepte ; mais il a
mangé avec les pécheurs, an que, devant sa grâce, vous
reconnaissiez son pouvoir ».
(III q., XL, a. XI.)
Jeudi
LE CHRIST DEVAIT MENER
UNE VIE PAUVRE.
Il est dit en saint Matthieu (8, 20) : Le Fils de
l’Homme n’a pas où reposer sa tête : comme s’il disait,
selon saint Jérôme : « Pourquoi tenez-vous à me suivre, à
cause des richesses et des gains du siècle, alors que si gran-
de est ma pauvreté, que je n’ai pas à moi, ni le plus petit
logement, ni le plus petit abri ».
Et sur ce passage de saint Matthieu (17) : an que nous
ne scandalisions pas, va à la mer, etc., saint Jérôme dit enco-
re : « Cette parole si simple édie l’auditeur, quand
on comprend que le Seigneur était si pauvre, qu’il
n’avait pas de quoi payer le tribut pour lui et ses
Apôtres ».
I
Il convenait que le Christ menât une vie pauvre sur la
terre :
a) C’était favorable au ministère de la prédica-
tion, pour lequel il dit être venu. Allons ailleurs dans les bour-
gades voisines an que j’y prêche aussi ; car, c’est pour cela que je
suis venu. (Marc 1, 38.) Or, il faut que les prédicateurs
de la parole de Dieu, pour se donner tout à fait à
la prédication, soient complètement aranchis de
tout souci des choses séculières : ce que ne peuvent
pas faire les possesseurs de richesses. Aussi le Christ lui-
même, quand il envoie ses Apôtres prêcher, leur dit : Ne
prenez ni or ni argent. (Matth. 10, 9.) Et les Apôtres diront
eux-mêmes : Il ne convient pas que nous laissions la parole de
Dieu pour servir aux tables. (Act. 6, 2.)
b) De même que le Christ a pris la mort corpo-
relle, pour nous faire bénécier de la vie spirituel-
le, de même il a supporté la pauvreté corporelle,
pour nous faire bénécier des richesses spirituel-
les, selon cette parole : Vous savez la grâce de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était,
an de vous faire riches par sa pauvreté. (2 Cor. 8, 9.)
c) S’il avait eu des richesses, on aurait attri-
bué sa prédication à la cupidité. C’est ce que dit saint
Jérôme : « Si les disciples avaient eu des richesses, ils auraient pa-
ru prêcher pour le gain, et non pour le salut des hommes ». La mê-
me raison vaut pour le Christ.
d) La vertu de sa Divinité devait d’autant plus
éclater, qu’il paraîtrait plus vil par la pauvreté.
C’est ce qui a été dit dans un discours au Concile d’Éphè-
se : « Le Christ s’est plu dans les choses pauvres et viles,
dans la médiocrité et dans l’obscurité, an qu’il parût évi-
dent que c’est sa Divinité qui transformait le monde. A
cause de cela, il a voulu une mère pauvre, une petite pa-
trie : il s’est fait dénué d’argent ; sa crèche nous prêche tout
cela ».
(3, q. 60, a. 3.)
II
Il n’était pas expédient que le Verbe incarné
menât, dans ce monde, une vie opulente, et super-
be par les honneurs et les dignités.
a) Parce qu’il était venu pour arracher aux cho-
ses terrestres, les esprits des hommes, adonnés au

Les textes du Thomatique
Consultables par arborescence ou moteur de recherche sur www.dici.org
4
terrestre, et les élever aux choses divines. Il fallait
donc que, par son exemple, il entraînât les hommes au mé-
pris des richesses, et de tout ce que recherchent les mon-
dains, pour les amener à mener ici-bas une vie pauvre et
sans luxe.
b) Et parce que s’il avait abondé en richesses et
s’il avait été établi en quelque dignité suprême,
tout ce qu’il aurait fait par pouvoir divin, aurait
plutôt été attribué au pouvoir séculier qu’à la ver-
tu de sa Divinité. Aussi, ce fut la preuve la plus ecace
de sa Divinité, que sans le moindre emploi de puissance
séculière, il ait ainsi amélioré le monde.
(Cont. Gent., V, 54.)
Vendredi
LE CHRIST EN CETTE VIE A OBSERVÉ
LA LOI.
Le Christ lui-même a déclaré : Ne pensez pas que je sois
venu abolir la Loi ou les Prophètes. (Matth. 5, 17.) Saint Jean
Chrysostome commente : « Le Christ a rempli la loi :
a) en n’en transgressant aucun précepte ; b) ensui-
te, en justiant par la foi ; ce que la Loi ne pouvait
faire ».
Le Christ a mené une vie conforme en tout, aux
préceptes de la Loi. La preuve en est qu’il a même vou-
lu être circoncis ; la circoncision n’est-elle pas une décla-
ration publique que l’on remplira la Loi ? Saint Paul l’écrit
aux Galates : Je déclare à tout homme qui se fait circoncire, qu’il
est tenu d’accomplir la Loi entière. (Gal. 5, 3.)
Si le Christ a voulu vivre selon la loi, c’est :
1° Pour approuver la loi ancienne ;
2° pour lui donner en lui-même, en l’observant,
son achèvement et son terme, et montrer aussi qu’elle
était ordonnée à lui ;
3° pour enlever aux Juifs toute occasion de le ca-
lomnier ;
4° pour délivrer les hommes de la servitude de
la loi, suivant la parole de saint Paul : Dieu a envoyé son Fils
né sous la loi, an d’aranchir ceux qui étaient sous la loi. (Gal.
4, 4.)
Lorsqu’il a guéri un malade le jour du sabbat, le
Christ a justié son acte de trois manières :
1° Le précepte de la sanctication du sabbat
interdisait non pas les œuvres divines, mais les
ouvrages humains. Si Dieu, en eet, a cessé, le septiè-
me jour, de créer de nouvelles créatures, ne continue-t-il
pas toujours d’agir, en conservant et en gouvernant toutes
choses ? Or, les miracles du Christ étaient bien des œuvres
divines ; aussi lui-même le déclare-t-il, d’après saint Jean :
Mon Père agit jusqu’à présent, et moi aussi j’agis (v, 17).
2° Ce précepte ne défendait pas les œuvres qui
sont de nécessité de salut, même corporel ; le Christ
le dit dans saint Luc : Est-ce que chacun de vous, le jour du sab-
bat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener
boire ? Et il ajoute : Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe
dans un puits, ne le retire pas le jour du sabbat ? Or, il est mani-
feste que les miracles du Christ avaient pour but le salut
du corps et de l’âme.
3° Enn, ce précepte ne défendait pas les œu-
vres qui se rapportent au culte divin : N’avez-vous pas
lu dans la loi, dit le Christ en saint Matthieu, que les jours de
sabbat, les prêtres violent le repos sabbatique, dans le Temple, sans
commettre de faute ? (12, 5.) Vous pratiquez la circoncision le
jour du sabbat, dit encore le Christ en saint Jean (vu, 23.)
(III, q. XL, a. 4.)
Samedi
HUMILITÉ ET OBÉISSANCE DE
JÉSUS-CHRIST.
Il s’est humilié lui-même en se faisant obéissant
jusqu’à la mort. (Phil. 2, 8.)
Comme preuve de son humilité, le Christ a vou-
lu subir la mort de la croix. A vrai dire, il n’y a pas
pour Dieu d’humilité, puisque la vertu d’humilité consis-
te en ce que l’on se renferme dans ses limites, qu’on ne
s’étend pas à ce qui est au-dessus de soi, mais qu’on se sou-
met au supérieur. Il est clair que l’humilité ne sau-
rait convenir à Dieu, qui n’a pas de supérieur, et
qui est transcendant à tout ce qui n’est pas lui. Si
quelqu’un, par humilité, se soumet à un égal ou à un infé-
rieur, c’est parce que, sous quelque point de vue, il tient
qu’un égal ou un inférieur, lui est supérieur.
Si l’humilité ne convient pas au Christ, à raison
de sa nature divine, elle lui convient cependant
selon sa nature humaine ; et son humilité devient
plus louable à cause de sa Divinité ; car, la dignité de
la personne ajoute à la louange de son humilité, par exem-
ple, lorsque, pour quelque nécessité, il est expédient qu’un
grand personnage subisse des misères. Or, aucune dignité
humaine n’est comparable à celle de Dieu. Et donc, l’hu-
milité de l’Homme-Dieu est d’autant plus louable,
quand il subit l’abjection, qu’il a jugé utile de su-
bir pour le salut de l’homme. Les hommes, par or-
gueil, étaient férus de gloire humaine. C’est pour déta-
cher le cœur des hommes de cet amour de la gloire
du monde, et pour leur faire aimer la gloire divi-
ne, que le Christ a voulu sourir la mort, non pas
quelconque, mais la plus abjecte : car, il y en a bien
qui ne craignent pas la mort, mais qui reculent devant
une mort ignominieuse. Mais le Christ a voulu donner cet

La moelle de St Thomas - 2 Epiphanie
le Thomatique ? Une base de données d’articles de fond touchant à la foi catholique.
5
exemple, pour animer les hommes à mépriser, même la
mort honteuse.
Sans doute, on pouvait enseigner l’humilité par
des paroles divines ; mais les faits sont plus e-
caces que les paroles, pour entraîner à l’action ; et les
exemples meuvent d’autant plus ecacement, qu’on a plus
de certitude de l’excellence de celui qui les donne. Et bien
qu’on puisse trouver de nombreux exemples d’hu-
milité dans la vie des hommes, cependant il était
plus expédient que l’homme fût excité par l’exem-
ple de l’Homme-Dieu, que l’on sait n’avoir pu se
tromper, et dont l’humilité est d’autant plus ad-
mirable que sa majesté est plus sublime.
II
Le Fils de Dieu incarné a souert la mort, par
obéissance au précepte de son Père, d’après l’en-
seignement de saint Paul. Il y a un précepte de Dieu
aux hommes de pratiquer la vertu, et l’on obéit d’autant
mieux à Dieu, qu’on pratique plus parfaitement la vertu ;
et, parmi les vertus, la principale est la charité, à laquelle
se rapporte toutes les autres. Et le Christ, en accom-
plissant très exactement l’acte de charité, s’est
montré parfaitement obéissant à Dieu. Nul acte
de charité n’est plus parfait, que de supporter la mort par
amour de quelqu’un, selon ce que le Christ dit lui-même :
Il n’y a pas de meilleure preuve d’amour que de donner sa vie pour
ses amis. (Jo. 15, 13.) Par conséquent, le Christ en sourant
la mort pour le salut des hommes, et à la gloire de Dieu le
Père, s’est montré parfaitement obéissant, en accomplis-
sant l’acte parfait de charité.
(Cont. Gent. 4, 55)
1
/
5
100%