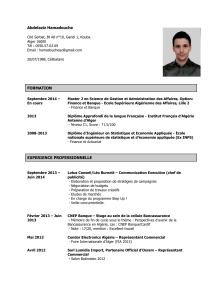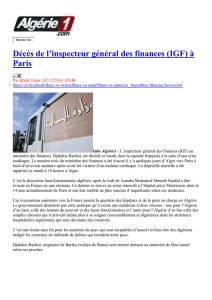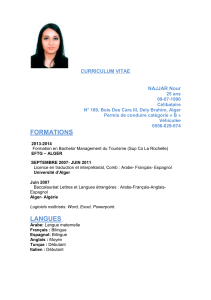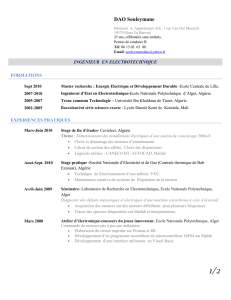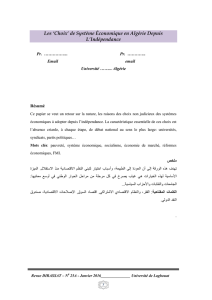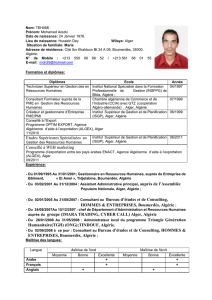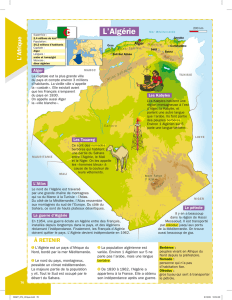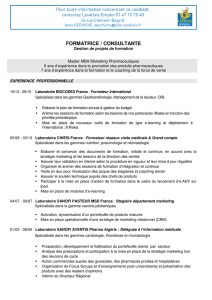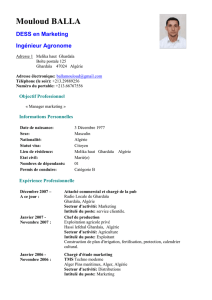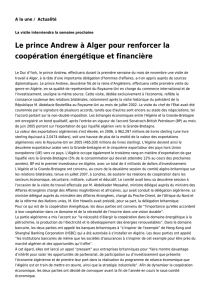Appel à Communication

XXVIEME COLLOQUE FEDERATEUR DU CEDIMES
07 & 08 décembre 2015
(Alger- ALGERIE)
Organisé par
Le Laboratoire de Recherche sur l’intégration Régionale et Union Européenne « LIRUE »
Le Laboratoire de Statistique Appliquée « LASAP »
Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (Algérie)
En partenariat avec
Le Réseau Académique International Francophone de l’Institut CEDIMES
MONDIALISATION ET DYNAMIQUES
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

APPEL À COMMUNICATIONS
1. Contexte et énoncé du problème
La mondialisation revêt des aspects si divers et complexes qu’il convient de
traiter les phénomènes qui y sont liés, avec une attention inhabituelle, une philosophie
nouvelle et des mécanismes d’intervention singuliers. Au regard des opportunités et menaces
qu’elle comporte, elle requiert forcément de la rigueur et de l’intelligence dans les stratégies
de développement susceptibles d’être formulées, de par le monde, aujourd’hui. Cette
observation s’applique tant aux pays industrialisés et émergents suffisamment rompus
aux défis mouvants de la transformation structurelle, qu’aux pays pauvres reconnus
généralement moins aptes à initier, de manière viable, l’acte de développer national.
Telle la langue d’Esope, la mondialisation peut être à la fois bénéfique et préjudiciable
pour le développement. Voyons-en brièvement les raisons :
- La mondialisation peut être bénéfique pour le développement parce qu’elle est
supposée en être une source d’opportunités. De manière compendieuse, elle est
reconnue par le « mainstream » apte à faire du « bien » à l’économie mondiale, entendu
d’abord comme une meilleure allocation des ressources et son heureux cortège de
l’accroissement du PIB, la création d’emplois et une répartition moins inéquitable des
revenus. Il en est attendu, en principe, pour plus d’efficacité et d’efficience
économiques, une plus grande uniformisation des actes de produire, de répartir et de
consommer à l’échelle planétaire. Dans une formulation moins abstraite, le contexte
mondialisé d’aujourd’hui rend compte, depuis la fin de l’ordre de l’après-guerre
immédiat, symbolisée par l’effondrement du système des parités fixes de Bretton
Woods, au début des années 1970 et par la chute du Mur de Berlin et l’effondrement de
l’URSS, à la fin des années 1980, d’une plus grande action des lois du marché et
conséquemment, du degré de contagion planétaire des principes de fonctionnement de
l’économie libérale, tels que décrits traditionnellement par la théorie dominante et
ramassés, à la fin des années 1980, dans/par le Consensus de Washington. Les facteurs
explicatifs de cette grande mutation est sa plus forte teneur marchande, le
développement des moyens de transport, l’utilisation intensive des technologies de
l’information et de la communication qui modifient ensemble les notions de temps et
d’espace, l’économie de la connaissance, l’innovation et enfin, l’accroissement des flux
dans les domaines commercial, financier, humain et informationnel. En témoigne, si
besoin est, la progression, durant ces deux dernières décennies, de la plupart des
indicateurs mondiaux de bonne santé économique et sociale : PIB, exportations,
investissements directs étrangers, nombre de touristes, espérance de vie à la naissance,

taux d’alphabétisation des adultes, etc. Bien plus, on impute aujourd’hui avec bonheur,
à cette « poussée mondialiste », la chute, dans bien des espaces, des régimes
dictatoriaux et l’avènement de ce que le philosophe allemand des lumières Christian
Von Wolf (1679-1754) désignait déjà vers 1720 par la notion de « pluralisme »
politique. Il faut cependant noter que, dans cette « course » à l’enrichissement global,
devenue en un laps de temps, plus un système de croyance qu’un système économique,
bon nombre de nations « perdent pied » et s’enlisent dans la pauvreté. C’est là, sinon
une preuve, du moins un avertissement que les statistiques économiques et sociales
globales, souvent réjouissantes, évoquées régulièrement par les chantres de la
mondialisation pour en vanter les mérites, dissimulent les disparités entre pays. Celles-
ci soulignent avec force que l’enrichissement du monde n’est pas forcément
contradictoire avec l’appauvrissement de certaines nations considérées isolément.
- La mondialisation peut être préjudiciable pour le développement, parce qu’elle
peut constituer un foyer de contraintes pouvant compliquer voire altérer l’effort de
développement national. En effet, à l’image du mode de production qui y est dominant,
elle est d’essence crisogène. Dans ces circonstances, le futur des nations est alors
quelque peu obscurci, pour ne pas dire carrément opaque. Il y a, à cela, une série de
raisons pouvant être extraites des caractéristiques à la fois propres et majeures de la
mondialisation: d’abord sa complexité liée à la multiplication des produits, des marchés
et des technologies; ensuite, sa turbulence qui met à rude épreuve et de manière
irrégulière, les valeurs économiques, les agendas des acteurs et les modèles de
croissance; enfin, ses incertitudes ou plus radicalement, la fin des certitudes au nom de
laquelle la communauté internationale entre dans un ordre qui a la particularité d’être
défini par les éléments du désordre où les modèles de croissance ne sont plus facilement
lisibles, les trajectoires de la croissance ne sont plus facilement visibles et les taux de
croissance ne sont plus facilement prévisibles.
A ces facteurs déjà lourds qui sapent la maitrise des déterminants mondiaux des
dynamiques nationales de développement, s’en greffent d’autres qui justifient la
nécessité de pérenniser le développement, tout en limitant les aptitudes des nations en
la matière. Il est possible d’en retenir au moins six:
le paradoxe de la mondialisation qui exprime le fait que d’une part, tous les
peuples semblent fiers d’appartenir à cette civilisation globale, à ce village planétaire et
de l’autre, ces peuples nourrissent tous la crainte d’être « coulés » en tant que
«communautés», dans un seul moule qui fait fi de leurs spécificités, économiques,
sociales, culturelles et religieuses. Sous son visage actuel, jugé par ses détracteurs,
tantôt comme autoritaire, tantôt comme totalitaire, la mondialisation incite à la
résurgence des nationalismes, des régionalismes et des localismes, autant d’entraves qui
obstruent sa voie et alimentent sérieusement sa remise en cause. Le «repli identitaire»
en tant que mécanisme de défense des peuples est d’autant plus inéluctable que la
mondialisation ne propose, pour l’instant, rien de concret qui puisse inciter les

populations, à l’échelle mondiale, à porter un regard critique sur leurs cultures et à en
expérimenter d’autres, fertilement. La mondialisation est handicapée par l’absence
d’une autorité mondiale ou d’un gouvernement mondial. Aussi, les questions
nécessairement mondiales qu’elle pose, ne rencontrent-elles aujourd’hui que des
réponses fondamentalement nationales et souvent inefficaces. Il en est ainsi de la
plupart des politiques économiques nationales ;
les risques immanents de la forte teneur marchande de la vie économique, où le
productivisme et la compétitivité d’une part et la déréglementation, la dérégulation et la
désintermédiation d’autre part, favorisent, respectivement la destruction des emplois,
notamment dans les secteurs non protégés, producteurs de biens internationalement
échangeables et une forte instabilité du développement mondial provoquée par les
mouvements des capitaux spéculatifs;
la faible équité distributive du procès mondial de répartition de la richesse: en effet,
la richesse mondiale est répartie de manière très inégale. Il en résulte une
concentration du revenu mondial entre les mains d’un faible pourcentage de la
population mondiale. Quant aux personnes qui vivent avec un revenu journalier
inférieur à un dollar, qui n’ont pas d’eau potable, ou qui sont touchées par la faim, leur
nombre dépasse respectivement le milliard;
le peu d’intérêt porté par le procès de production mondialisé à la santé écologique
qui devait imposer aux générations présentes de vivre simplement pour que les
générations futures puissent simplement vivre;
le souci quasi-religieux de la mondialisation de minorer le rôle de l’Etat dans le
développement mondialisé; ce processus étant désormais vu comme l’œuvre d’un
ensemble d’acteurs agissant en dehors de l’Etat et pouvant consentir ou refuser des
crédits, contrôler l’accès à l’information et décider quoi produire et où produire Y
Figurent, en priorité, les firmes transnationales (FTN) qui, au regard de leur puissance
économique et financière, sont capables d’organiser la production mondiale en réseaux
et d’y intégrer ou d’en exclure, à leur guise, tel ou tel Etat, selon leur volonté qu’elles
nomment savamment degré d’attractivité internationale, c’est-à-dire, compatibilité des
atouts politico-économiques de cet Etat avec leurs objectifs stratégiques. En réalité,
tout porte à croire, qu’au nom de l’efficience des marchés, la mondialisation est dirigée
ouvertement contre les Etats. Et des Etats affaiblis ne peuvent être une « digue » ni
contre la délinquance financière, ni contre la criminalité largement observées déjà dans
la plupart des pays en développement, ni contre la pauvreté de larges couches de la
population désormais non protégées par la dépense publique et exposées aux forces
sévères du marché ;
enfin, la mondialisation stipule l’émancipation de l’Economique à l’égard du
politique. Les Etats désormais fragilisés risquent de devenir superflus, parce que
soumis, sans capacité de riposte individuelle efficace, à la volonté des acteurs puissants
qui organisent, selon leurs objectifs propres, le système économique mondial. Face à
leur risque d’évanouissement, les Etats mettent aujourd’hui en œuvre des outils de
multiplication de la puissance publique, à travers leurs regroupements en Unions et
Associations qui leur permettent de répondre de manière solidaire aux défis de la
mondialisation. Cette solidarité réinterprète forcément aujourd’hui les notions d’Etat et
de souveraineté qui ont déjà largement quitté l’échelon national.

C’est ce contexte reconnu économiquement peu efficace, en raison de la récurrence
de ses crises, socialement peu équitable, eu égard à l’importance numérique des
populations vivant avec des revenus indécents et touchées par les maladies et la faim
et écologiquement malsain (niveau insoutenable d’émissions de gaz à effet de serre,
sécheresse, pénurie d’eau, insécurité alimentaire, inondations, disparition des écosystèmes
vitaux, etc.) qu’il s’agira de transformer, de manière à la fois urgente et authentique , en
vue d’éviter tout simplement l’arrêt du développement humain. Il convient, en fait, de
répondre aux besoins des générations présentes (alimentation, eau potable, emploi,
éducation, santé, etc.) et, en leur sein, des plus démunis sans compromettre la capacité
des générations futures de prendre en charge les leurs.
Comment ? Sans doute en mettant en œuvre des stratégies de croissance.
Mais de quelle croissance s’agit-il, dans ce cas ? On peut être tenté de la rendre
scientifiquement lisible, en y accolant l’épithète « durable », comme pour signifier la
nécessaire création des fondements économiques et extra-économiques d’une
métamorphose sociétale mondiale pérenne. Mais le concept de croissance durable ne va
sans poser de sérieux problèmes d’ordres scientifique et méthodologique.
- D’abord, parce qu’il n’est pas explicitement adopté, sous ce visage singulier, par
l’économie traditionnelle de la croissance qui se déroule, elle, à l’intérieur des bornes
étroites de l’Economique.
- Ensuite, parce qu’il pèche par « réductionnisme ». Pour l’essentiel, il désigne,
depuis la révolution industrielle et de manière plus nette, durant les trente glorieuses,
l’augmentation continue de la quantité de biens et services produite dans un espace
économique donné et mesurée par le Produit intérieur brut (PIB) ou, plus
pertinemment, par le Produit intérieur brut par habitant (PIB/hab). Ce sens restrictif
de la croissance, mais ô combien opportun, en son temps, est décrié aujourd’hui. Il lui
est reproché, en substance, ses effets sociaux et écologiques insupportables. Vit-on
alors se former des inquiétudes et se formuler des appels académiques et politiques,
comme signaux d’alerte des dangers de la «religion du PIB ». Il fut préconisé aux acteurs
de la croissance d’enlever leurs « œillères économiques » et de regarder les autres
sphères de la vie sociétale pour lesquelles l’accroissement de la richesse produite est, à
plus d’un titre, préjudiciable. Naquirent alors des tentatives d’extension, voire de
réforme du sens de la croissance, en tant qu’ensemble de processus cumulatifs
d’interactions visant, sous de conditions sociales et écologiques tolérables,
l’accroissement continu du PIB/ hab. Ne pouvant appréhender cette nouvelle
problématique de la croissance à l’aide des concepts à la fois nouveaux et transversaux,
la science économique ou, de manière plus ciblée, son chapitre l’économie de la
croissance actionne et souvent sans intelligibilité, des épithètes qu’il accole à ses vieux
concepts formant ainsi, sous la pression des faits, ceux de croissance verte, de
croissance équitable, de croissance viable, d’investissement socialement responsable
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%