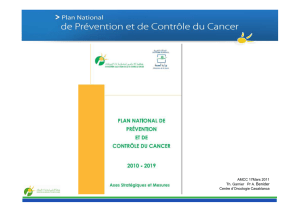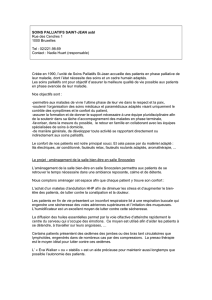Concept soins palliatifs - Foyer St


Foyer St-Joseph – Place de l’Eglise 5 – 1625 Sâles
Accompagner – S’entr’aider – Soigner
Concept soins palliatifs en EMS – Foyer St-Joseph, Sâles – 31.08.2010.
Auteur-e-s :
Mme Marlène Messerli, cheffe de projet en soins palliatifs, Caritas Suisse
M. Yves C. Gremion, directeur du Foyer St-Joseph, Sâles
Supervision :
Dresse Claudia Mazzocato, PD MER, soins palliatifs CHUV, Lausanne
En référence aux critères de qualité des soins palliatifs en EMS et à la formation
« Par-achever sa vie » de Caritas Suisse et de Curaviva.

Foyer St-Joseph – Place de l’Eglise 5 – 1625 Sâles
Table des matières
1. Préambule
1.1. La philosophie institutionnelle
1.2. La culture institutionnelle en soins palliatifs
1.3. Les pratiques institutionnelles
2. Définitions officielles et principes en soins palliatifs
2.1. La santé et la prévention selon OMS 2002
2.2. Les soins palliatifs selon OMS 2002
3. Soins palliatifs en EMS
3.1. A qui s’adressent les soins palliatifs ?
3.2. A quel moment de la maladie proposer les soins palliatifs ?
3.3. La pratique des soins palliatifs implique ?
3.4. L’histoire de vie du résidant, de la résidante
4. Ethique en soins palliatifs
4.1. Notre approche de la qualité en soins palliatifs
4.2. Nos principes d’action
4.3. La prise en compte de la volonté du résidant, de la résidante - les directives anticipées
4.4. La demande de suicide assisté
5. Souffrance, douleurs et autres symptômes
5.1. L’apaisement de la souffrance
5.2. L’évaluation et le traitement de la douleur
5.3. La dépression, sa détection précoce et sa prise en charge
6. Détresse spirituelle et sa prévention
6.1. La crise et sa prévention
6.2. La prise en charge d’une détresse spirituelle
7. Temps du mourir – les soins terminaux et l’accompagnement en fin de vie
7.1. Les soins terminaux
7.2. L’accompagnement en fin de vie
8. Equipe interdisciplinaire et ressources humaines
8.1. Les caractéristiques de prise en soins interdisciplinaire
8.2. Les référent-e-s, rôles et responsabilités
8.3. Les modes de communication
8.4. La formation et la supervision
8.5. Le soutien aux équipes
8.6. La collaboration avec des organismes externes
8.7. L’accompagnement bénévole
9. Partenariat et soutien à l’entourage
9.1. L’accompagnement de la famille et de l’entourage
9.2. L’information et soutien aux proches de résidant-e-s
10. Décès et obsèques
10.1. La mort et son impact
10.2. La constatation du décès naturel et administration
10.3. La constatation d’un suicide, d’un suicide assisté et administration
10.4. L’installation du défunt -la chambre mortuaire-les rituels
10.5. Les informations et le type de soutien
10.6. Les obsèques
11. Bibliographie

Foyer St-Joseph – Place de l’Eglise 5 – 1625 Sâles
1. Préambule
Dans notre institution, les soins palliatifs sont considérés comme des soins associés aux traitements de
la maladie et ont pour objectifs de préserver la qualité de vie du résidant et de la résidante, de soulager
les douleurs physiques et tous les autres symptômes gênants. Ils prennent également en compte la
souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne malade et de son entourage (figure 1 :
approche mutidimensionnelle). De même, les soins palliatifs cherchent à donner à la personne malade,
dans le respect de ses droits, une place centrale dans les décisions qui la concerne. Ils accordent une
attention toute particulière à la famille et aux proches.
En ce sens, la démarche des soins palliatifs vise à sauvegarder la dignité de la personne et à éviter les
traitements et examens médicaux déraisonnables.
Nous reconnaissons également que les soins palliatifs ne concernent pas seulement les derniers jours
de la vie et visent à une prise en charge précoce de la personne malade.
Elle s’intègre dans la stratégie nationale en matière de soins palliatifs, OFSP octobre 2009 et du canton
de Fribourg.
1.1. La philosophie institutionnelle
1
La philosophie institutionnelle s’inscrit dans une tradition humaniste et dans le Palliative Care, en se
référant notamment à la tradition humaniste du Mouvement des hospices (soins palliatifs en
Angleterre) et toute la littérature s’y rapportant (réf. Mme Kübler-Ross), aux concepts d’humanitude et
de bienveillance, de bientraitance.
L’institution intègre les préoccupations de fin de vie de qualité dans sa philosophie en se référant
notamment aux théories sociologiques et anthropologiques contemporaines (Norbert Elias « La
solitude des mourants », Louis-Vincent Thomas « La mort en question »).
1.2. La culture institutionnelle en soins palliatifs
2
Les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques, le soutien
psychologique, social et spirituel, destinés aux malades souffrant d’une affection évolutive non
guérissable. Son but est de soulager la souffrance, les symptômes, d’assurer le confort et la qualité de
vie du malade et de ses proches.
Les soins palliatifs n’excluent pas l’approche curative mais s’inscrivent en complémentarité avec
celle-ci (voir figure 2 : complémentarité soins curatifs/ de réadaptation et soins palliatifs). Ils offrent
tous les moyens nécessaires et appropriés, adaptés à chaque situation (mesures de réhabilitations, radio
– et/ou chimiothérapie palliatives, antibiothérapie, traitements symptomatiques, etc.) et au moment
particulier de la prise en charge (réversibilités potentielles), qui améliorent la qualité de vie de la
personne malade. Les représentants d’autres disciplines médicales (anesthésistes, pharmacologues,
radiothérapeutes, oncologues, etc.) et paramédicales collaborent régulièrement à la prise en charge.
La culture institutionnelle se réfère aux directives médico-éthiques de l’ASSM en soins palliatifs et le
concept des soins palliatifs, rapport OMS 804 et l’accompagnement en fin de vie.
1.3. Les pratiques institutionnelles
Les pratiques institutionnelles sont en adéquation avec la charte éthique de l’AFIPA, la stratégie
nationale en matière de soins palliatifs 2010 et la promotion de la santé, Charte Ottawa, 1986 -
Djakarta 1997.
Les standards de qualité selon la société suisse de médecine et de soins palliatifs 2005 et les critères
qualité des soins palliatifs de Caritas Suisse et Curaviva sont nos documents de référence facilitant
1
Manuel qualité du Foyer St-Joseph, chapitre philosophie des soins
2
Concept de soins, d’accompagnement et d’animation, Foyer St-Joseph, 2005

Foyer St-Joseph – Place de l’Eglise 5 – 1625 Sâles
l’évaluation régulière de la qualité des prestations offertes par l’institution dans le domaine des soins
palliatifs.
2. Définitions officielles et principes en soins palliatifs
2.1. La santé et la prévention selon OMS 2002
La santé selon OMS est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
La prévention selon l'OMS, c'est « l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre ou la
gravité des maladies ou accidents ».
2.2 Les soins palliatifs selon OMS 2002
Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux
conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la
souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et
des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.
Les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants,
soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni
repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux résidant-e-s,
proposent un système de soutien pour aider les résidants-e-s à vivre aussi activement que possible
jusqu’à la mort, offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du
résidant, de la résidante et leur propre deuil, utilisent une approche d’équipe pour répondre aux
besoins des résidant-e-s et de leurs familles en y incluant si nécessaire une assistance au deuil, peuvent
améliorer la qualité de vie et influencer peut-être aussi de manière positive l’évolution de la maladie,
sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en association avec d’autres traitements pouvant
prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la radiothérapie, et incluent les investigations qui sont
requises afin de mieux comprendre les complications cliniques gênantes et de manière à pouvoir les
prendre en charge.
Figure 1. Modèle pluridimensionnel
Souffrance
Bien-être spirituel
Sens ou non sens de la maladie
Signification de la douleur et de la
souffrance
Foi religieuse
Perspectives existentielles
Environnement social
Communication avec le personnel
soignant
Relations avec les proches
Situation financière, problèmes
assécurologiques
Bien-être psychologique
Appréhension, soucis
Deuil, dépression
Ressources, plaisir, loisirs
Anxiété, colère
Capacités cognitives
Bien-être physique
Symptômes associés
Capacité fonctionnelle, handicap
Douleurs, dyspnée
Fatigue, cachexie, sommeil
Appétit, nausée, etc.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%