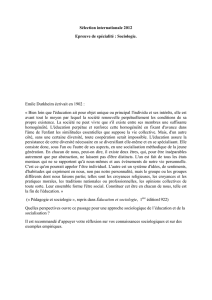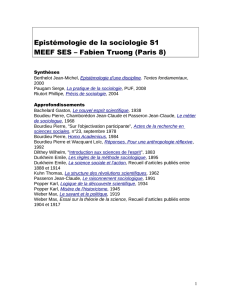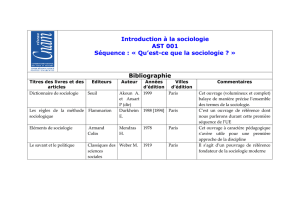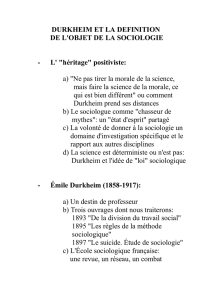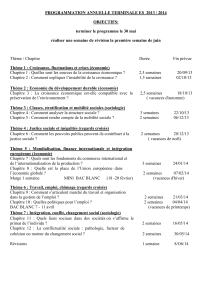De la sociologie à la sociolinguistique: éléments historiques et

T W Toronto Working Papers in Linguistics 25: 85–94
P L Copyright © 2005 Davy Bigot
De la sociologie à la sociolinguistique:
éléments historiques et théoriques
Davy Bigot
Université du Québec à Montréal
Après être revenu sur les deux principaux mouvements qui ont fondé la
sociologie contemporaine, l’auteur revient sur leurs influences directes sur
la sociolinguistique. Dans un premier temps, nous verrons comment les
programmes de Marx et de Durkheim formeront la base d’une des théories
majeures de la sociolinguistique, la théorie de la “stratification sociale”
développée dans les travaux de Labov (1976). En second lieu, nous
reviendrons sur le courant wébérien dont les fondements inspireront la
théorie des “réseaux ” présentée dans l’étude de Milroy (1980). De ces
deux synthèses, nous en tirerons la conclusion que le paradigme
sociolinguistique ne peut se résumer à une simple opposition micro/macro
social. Nous terminerons alors notre exposé avec la théorie sociale de
“l’habitus linguistique” exposée dans Bourdieu (1982). Après un bref retour
sur ses fondements, nous verrons comment celle-ci permet d’obtenir une
solution, peut-être plus équilibrée, au problème de la sociolinguistique.
1. Introduction
Dans son ouvrage intitulé La construction de la sociologie, Berthelot (2001) pose un
problème fondamental concernant l’élaboration de cette science. Il distingue deux
paradigmes qui s’opposent radicalement et qui construisent tous deux des objets différents.
Les définitions du social sont diverses: il peut être vu comme un ensemble de
règles et de contraintes qui s’imposent à l’individu dans une société donnée et dont
il importe de saisir l’origine et les effets. Mais il peut être également conçu comme
la signification pour autrui qu’impliquent nos divers comportements. (Berthelot
2001:5)
La sociologie délimite tout d’abord son champ d’investigation et ses objets d’étude en
prenant pour modèle principal celui des sciences de la nature, puis en s’opposant plus tard
aux explications en termes de contrat. L’étude se porte d’abord sur la sociologie du fait
social. Parallèlement et en opposition à ce programme émerge un autre courant sociologique
tout aussi important, qui fera place à ce qui sera défini comme la sociologie de l’action
sociale. Cette tradition naîtra au XIXe siècle et placera l’action sociale au centre de l’étude
sociologique.
À ses débuts, la sociologie apparaît donc comme tiraillée par deux grands courants
opposés. Deux approches se distinguent. La première envisage l’étude des phénomènes
structurels et privilégie l’aspect quantitatif de la science: c’est l’approche macro-sociale. La
seconde, elle, se base radicalement sur l’individu socialisé en favorisant l’aspect qualitatif
des résultats: c’est l’approche micro-sociale. Deux questions fondamentales se posent alors.

DAVY BIGOT
86
Doit-on suivre le premier chemin tracé et traiter les phénomènes sociaux comme des objets
scientifiques à part entière et extérieurs à l’individu ? Au contraire, doit-on impérativement
intégrer dans l’étude, cet individu et la construction du sens qu’il opère à chaque
manifestation sociale ?
Après avoir décrit brièvement ces deux traditions fondatrices de la sociologie, nous
soulignerons les influences de la sociologie sur la sociolinguistique. Nous verrons comment
le paradigme de la sociolinguistique ne peut se résumer seulement à l’opposition
micro/macro social à travers la présentation de deux théories principales: la “stratification
sociale” et la théorie des “réseaux”. Enfin, nous terminerons notre exposé par la théorie
sociale de “l’habitus” exposée dans Bourdieu (1982). Après un bref retour sur ses
fondements, nous verrons comment celle-ci permet d’obtenir une solution, peut-être plus
équilibrée, au problème de la sociolinguistique.
2. Quelques notions historiques et théoriques en sociologie
2.1 Pour une sociologie du “fait social”
Pour Auguste Comte, la sociologie n’est autre que: “l’étude positive de l’ensemble des
lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux” (Comte 1832:259 cité dans Ferréol et
Noreck 2000:10). Tous les domaines scientifiques devant être étudiés selon les mêmes règles
et les mêmes méthodes, il fondera ses principes sur le modèle de la biologie qui lui fournira
des données objectives et une méthodologie pour la connaissance de ce qui deviendront
quelques années plus tard des faits sociaux. Tout comme pour la biologie, l’essentiel revient
à partir du tout pour en comprendre les parties; une explication des faits sociaux déduite des
seuls comportements individuels ne peut convenir et doit être totalement exclue. La
connaissance des faits sociaux relève de l’observation. Les lois de la société sont
parfaitement comparables aux lois de la nature. Ces lois sont les mêmes que celles qui
s’imposent aux individus. Ferréol et Noreck (2000:13) résument son programme ainsi:
-La société se substitue à la nature pour fonder une épistémologie nouvelle (société =
humanité).
• Comme la nature, elle est régie par des lois immuables et indépendantes des actions
humaines.
• La connaissance de ces lois reste soumise aux mêmes exigences méthodiques que
celles qui étaient à l’œuvre parmi les sciences de la nature au XIXème siècle.
Comte deviendra l’instigateur du mouvement positiviste qui donnera naissance à un
grand nombre de théories marquantes dans la construction de la sociologie.
Parallèlement à sa vie politique, Marx va élaborer certaines théories sociales au poids
conséquent. Son projet rejoint particulièrement celui d’Auguste Comte. Pour lui comme pour
le précédent, l’essentiel est de partir des structures pour aboutir à l’individu en lui-même:
“Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés,
nécessaires, indépendants de leur volonté” (Marx 1859 cité chez Ferréol et Noreck 2000:21).
Ces structures, qui sont imposées aux acteurs sociaux, évoluent selon certaines lois
identiques à celles de la nature. Selon ce dernier, toute société se définit par ses structures qui
permettent aux hommes de vivre matériellement. Ces mêmes structures forment un système,
un mode de production qui se divise en forces productives (ensemble des ressources
matérielles et humaines) et en rapports de production (relations de propriété et de contrôle

DE LA SOCIOLOGIE À LA SOCIOLINGUISTIQUE
87
des forces de production). L’œuvre de Marx consistera à démontrer que les capitalistes, et
plus généralement les classes sociales, ne peuvent gérer leur conduite respective. L’individu
semble dépendre des structures dans lesquelles il évolue. On retrouve ici le fondement même
posé par Comte quelques années auparavant. Pour résumer l’apport du marxisme, nous
reprendrons à nouveau trois axes présentés dans Ferréol et Noreck (2000:26):
• La notion de modèle (l’analyse en terme de mode de production).
• La mise en situation des idées. Le marxisme montre que les projets, les idées, les
valeurs ne peuvent être étudiés indépendamment des enjeux entre les groupes
sociaux.
• La valeur heuristique de l’hypothèse des acteurs collectifs dans l’analyse du
changement.
Son œuvre, liée à la sociologie de Comte, inspirera d’une certaine manière l’œuvre du
principal représentant de la sociologie du fait social, Émile Durkheim.
En 1895, Émile Durkheim publie Les règles de la méthode sociologique suivie en 1897
du Suicide. Étude de sociologie. Il sera considéré comme le fondateur de la sociologie. Il
pose très vite les fondements de celle-ci et en expose ses théories de la manière suivante: “La
première règle, et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses”
(Durkheim 1987:18) Il fondera sa théorie sur une définition particulière de ces mêmes faits:
Un fait social ne se reconnaît qu’au pouvoir de coercition externe qu’il exerce ou
est susceptible d’exercer sur les individus et existe indépendamment des formes
individuelles. (Durkheim 1987:11)
Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur
l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans
l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de
ses manifestations individuelles. (Durkheim 1987:18)
Pour Durkheim, l’objet du sociologue doit obéir aux mêmes règles que les autres
sciences dites naturelles. Il s’inspire, lui aussi, directement du Cours de philosophie
positiviste d’Auguste Comte. Durkheim considère que tout n’est que principe de causalité,
principe s’appliquant tant aux corps bruts qu’au corps organisés.
Sa plus grande victoire viendra en 1897 avec Le suicide. Étude de sociologie. À partir
d’un examen ordonné et détaillé d’une multitude de données, il parviendra à dégager une
typologie théorique des causes du suicide qui rappelle vivement la problématique de
l’intégration de l’individu dans la société et l’influence du désordre social sur la vie
individuelle. Les faits sociaux ne sont alors plus des idées, ni des représentations ou des
sentiments. Ils doivent être considérés comme proprement externes aux individus auxquels
ils sont imposés. L’œuvre de Durkheim se résume finalement en trois points essentiels
(Ferréol et Noreck 2000:20-21):
• Le fondement objectif de la sociologie.
• La recherche des relations entre variables à l’intérieur d’une même société afin de
construire des hypothèses pour relier les résultats à un modèle explicatif.
• Confronter les lois générales et/ou particulières selon un maximum de données.
Située à l’intérieur de la problématique de sa thèse, l’analyse des formes de solidarité
sociales mais aussi des causes structurelles et collectives des modes de comportement et de

DAVY BIGOT
88
pensée chez l’individu, composeront les grandes lignes du programme durkheimien qui
dominera toute la sociologie française durant les premières décennies du XXième siècle.
2.2. Pour une sociologie de l’“action sociale”
Dans ses deux principaux ouvrages, De la démocratie en Amérique (1840 cité chez
Ferréol et Noreck, 2000:27) et L’ancien régime et la révolution (1856 cité chez Ferréol et
Noreck, 2000:27), Tocqueville s’attache à souligner la spécificité de deux systèmes
démocratiques différents. Tocqueville oppose dans sa problématique le concept de l’égalité
contre la liberté. Pour ce dernier, seule la démocratie révèle l’essence de la société moderne.
Cette même démocratie engendre une nouvelle société et un nouveau type d’homme, de par
un système d’égalisation des conditions (tous les êtres naissent égaux et gardent le droit de
vivre de manière autonome). Ce lien entre les hommes pose, selon lui, un problème de
relations entre ces deux valeurs. Alors que la liberté permet la différenciation, l’égalité tend à
uniformiser les individus.
Au départ de son raisonnement, Tocqueville fait place à l’individu de raison mais
également de foi religieuse. La religion est, selon lui, source de certaines fonctions sociales
élémentaires. Elle permet une intégration communautaire mais aussi l’intériorisation de
certaines limites et contraintes imposées au désir individuel. Les autres institutions sociales
et politiques se déduisent alors de l’agrégation des pratiques individuelles (influencées des
nouvelles valeurs d’égalité et de liberté) et de leurs contradictions (si l’individu parvient en
effet à s’émanciper, il s’isole un peu plus de la société). Trois points clés peuvent être isolés
dans la théorie de Tocqueville (Ferréol et Noreck 2000:32):
• La force des idées dans l’analyse du changement social (l’idée égalitaire,
notamment pour les sociétés modernes).
• L’interdépendance des institutions, des “mœurs” et des représentations mentales
d’une société donnée.
• Le caractère ouvert du devenir historique: la possibilité pour les sociétés
démocratiques de basculer soit vers la tyrannie soit vers un équilibre parfait entre
égalité et liberté.
Instigateur d’un nouveau mouvement sociologique, Alexis de Tocqueville se distingue
des trois auteurs précédents par la primauté des idées sur le comportement social. Ce concept
va s’étendre et gagner de l’importance avec la venue d’un nouvel auteur, Max Weber.
Max Weber s’oppose radicalement à Émile Durkheim. Ce dernier propose l’étude des
faits sociaux, Weber, lui, s’oriente vers l’activité sociale. Il en exprimera ses principales
idées et leurs applications dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905
cité chez Ferréol et Noreck, 2000:38). L’objet principal pour Weber concerne les
comportements sociaux doués de sens, mais aussi tournés vers autrui. L’action de l’individu
s’avère sociale dans la mesure où elle se rapporte au comportement d’autrui par rapport
auquel s’oriente son déroulement. L’activité humaine n’est donc plus réduite à un rapport de
causes à effets. Du fait de la signification subjective qu’attachent les acteurs sociaux à leur
action, celle-ci tient compte directement d’autrui, et en est affectée dans son cours.
Cette théorie de l’action sociale s’apparente rapidement à un processus d’influence:
l’action d’un individu est dirigée vers un autre individu dans le but de modifier son
comportement. Son programme offrira, entre autres, la détermination du sens subjectivement

DE LA SOCIOLOGIE À LA SOCIOLINGUISTIQUE
89
visé par les acteurs sociaux, mais aussi la constitution des idéaux-types (l’influence de
Tocqueville est ici, évidente) qu’il désigne comme moteur et orientation de l’activité étudiée.
La seule méthode appropriée sera celle de la compréhension par interprétation (c’est la
méthode de la sociologie compréhensive): saisir les significations sociales construites et
partagées par les acteurs ne peut se faire sans compréhension de l’action elle-même. En
définitive, Weber propose une démarche clairement centralisée sur l’individu (acteur social)
dans ses rapports à autrui. Trois points essentiels ressortent de son programme (cité chez
Ferréol et Noreck 2000:44):
• Construire des modèles idéaux (influence de Tocqueville et des idéaux-types) et
confronter la réalité empirique à cette pluralité des idéaux.
• Cette confrontation amène l’observateur à se situer selon des points de vue
différents.
• Ces différences doivent être acceptées sans chercher une explication totalisante et
ultime de la réalité sociale dont le sens reste en dernière analyse irréductible à la
seule explication scientifique.
Weber sera rejoint, plus tard, par Georg Simmel qui défendra l’approche wébérienne des
phénomènes sociaux, et étayera ses arguments sur la base de l’action réciproque et de la
socialisation pour en aboutir à la formation d’une psychologie sociale.
3. Deux théories sociologiques pour trois théories sociolinguistiques
3.1. La “stratification” sociale
C’est dans les années 60 que la sociolinguistique va commencer à prendre un chemin
réellement constructif. Malgré de nombreux travaux réalisés, le concept d’une linguistique
attachée à la réalité sociale semble encore douteux, une grande majorité de linguistes s’étant
résolument tournée vers une simple contemplation de leurs idiolectes. La sociolinguistique
suppose, dès le début, qu’une mise en rapport quantifiée des phénomènes linguistiques et
sociaux est productive. Labov (1976) distingue cependant les variations stables des
changements en cours dans une communauté. Dans le premier cas, les facteurs sociaux ne
jouent aucunement sur les phénomènes linguistiques. Ce sont des contraintes linguistiques et
non la diversité sociale qui conditionnent la variation. Au contraire, les changements en
cours au sein d’une communauté tendent, eux, à démontrer une variation linguistique
dépendante des différences sociales (sexe, âge, classe sociale, etc.) entre les locuteurs.
William Labov se consacre donc à l’étude des situations concrètes et contemporaines, et
donne un élan sans pareil à cette science encore floue qu’est la sociolinguistique. Inspiré
directement des travaux de Meillet (1965), son objet sera l’étude de la langue au sein de son
contexte social, dans son usage purement quotidien. En 1966, Labov publie son étude sur la
prononciation du /r/ dans les grands magasins new-yorkais. Afin de mener à bien son
enquête, il choisit trois grands magasins censés représenter les trois types de classes sociales
généralement admises dans les études sociologiques, à savoir les classes inférieures, les
classes moyennes et les classes supérieures. Ces trois magasins sont Saks Fifth Avenue,
Macy’s et S. Klein. Labov part de l’hypothèse principale suivante:
We begin with the general hypothesis suggested at the end of the last chapter: if
any two sub-groups of New York City speakers are ranked in a scale of social
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%