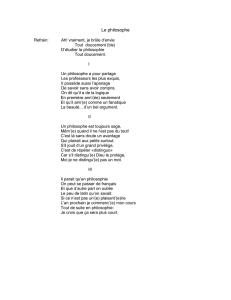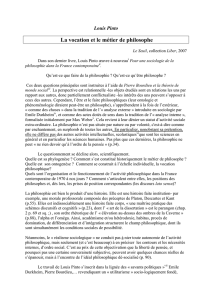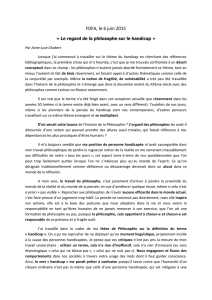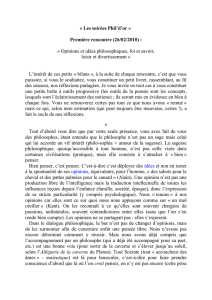La philosophie comme drogue

Jean Tellez
La philosophie
comme drogue

Introduction
La philosophie aurait un rapport à la drogue ? L’idée est-elle à
prendre au sérieux ? Elle a tout l’air d’être, au mieux d’une pro-
vocation, au pire d’une incongruité.
Esquissons déjà notre propos. Nous tenterons d’éclairer l’attrait
de la philosophie en général et la fascination que l’on peut éprou-
ver pour des philosophies particulières. L’attrait est autre chose
que l’utilité, l’importance, le prestige. Qui peut dire d’ailleurs
dans quelle mesure ces derniers caractères s’appliquent à la phi-
losophie ? Son attrait, par contre, est indéniable.
En ce qui concerne cet attrait, nous choisissons l’option forte.
Nous voulons expliquer une puissance d’attraction, une force
entraînante propre à la philosophie. Dans ses types de réflexion,
ses concepts, ses effets sur le langage, dans les expérimentations
qu’elle permet ou promet, on peut trouver matière à stimulations,
et même à grandes excitations intellectuelles. L’idée pourrait être
triviale, mais elle ne l’est plus si l’on prend l’idée de stimula-
tion au sérieux, si l’on se demande ce qui pourrait bien, en der-
nier ressort, la produire ici. Cette stimulation est exceptionnelle
et rare. C’est en y songeant que l’idée de drogue nous vient à
l’esprit.
Cette idée à son tour nous fait songer à deux choses : à un
breuvage enchanté et à un produit hautement psychotrope. Deux
effets : une ivresse et une impulsion pour les pensées. Mais

comment une activité pensante, une certaine manière de réflé-
chir, d’écrire et de discourir pourraient être de la substance, de la
formule ? Quelle serait la molécule active ?
L’hypothèse d’une drogue présentera au moins l’intérêt,
espérons-le, de jeter quelque lumière sur cette affaire décon-
certante qu’est la philosophie. Que penser de la gravité avec
laquelle on s’occupe de l’être, du non-être, de la nécessité, de
la liberté, des discours, du sens ? On suit cérémonieusement
des parcours, on construit des concepts. Mais qu’est-ce que la
philosophie ? Pourquoi marche-t-elle si bien, de cette façon si
assurée ? Que réussit-elle ? Que font les philosophes ? Quelle
est leur activité ? En outre, comment naît la philosophie ?
Comment est-elle venue au jour historiquement ? Quels rôles
respectifs ont joué Socrate et Platon ? Quelle est l’origine du
besoin de philosopher ?
Il est vrai que les questions d’origine première, de genèse, sont
délicates. Quelle est l’origine du sentiment amoureux ? D’où
vient la croyance en Dieu ? D’où procède le besoin de connais-
sance ? On connaît les apories où l’on tombe en posant ces ques-
tions. Mais dans le cas de la philosophie, la question de la genèse
est à part. Le problème que pose son existence est spécifique.
À nouveau parce qu’on ne sait pas ce que le philosophe fait au
juste. Aime-t-il ? Croit-il ? Connaît-il ? De même : Espère-t-il ?
Veut-il quelque chose ? Qu’est-ce qui le satisfait ? Qu’attend-il
des autres ? Qu’attend-il de la vie ? Aussi étonnant que cela
puisse paraître, il n’y a sans doute aucune réponse à ces ques-
tions. On peut en proposer, mais aucune n’aura un semblant de
généralité. L’origine de la philosophie, comme l’origine de son
besoin, se perdent dans un vague énigmatique.
Proposons une manière d’élucidation. Une manière, presque
un semblant. Car nous allons, peut-être, nous perdre tout à fait
dans le vague. La philosophie commence quand on expérimente,
quand on arpente une zone d’ivresse. Le philosophe prend part à
un banquet originel. Ses discours sérieux, graves, sont d’ébriété.
Au lieu où ils prennent leur source, les pensées deviennent à
boire, les idées à s’injecter. De la sorte, elles quittent le champ
de la conscience grave et sérieuse. Ce que fait le philosophe est

donc embarrassant à comprendre, parce qu’indissociable d’un
état éthylique ou narcotique excessivement singulier.
Cela, nous pensons qu’il est possible de le montrer. Il s’agira
d’abord de remarquer qu’il n’y a pas de philosophie sans l’expé-
rimentation d’un bon état. « Bon » sera également entendu dans
toute la puissance possible du mot : intense, étrange, envoûtant,
merveilleux… Nous verrons que toute philosophie exprime, des-
sine un bon état. Nous serons mis sur la voie d’un breuvage par-
ticulier (et problématique, concédons-le), dans la mesure où cet
état paraîtra toujours dessiné dans une philosophie particulière ;
de la sorte, il sera impossible à reproduire, à trouver en dehors
de cette dernière. Si une image pouvait aider en ce lieu, on pour-
rait songer à l’expérimentateur de drogues. Quand il raconte
son expérience, il est poussé à forger ses évocations de telle
façon qu’elles tracent les contours d’un état enivrant – d’un bon
« trip ». Ce dernier est ineffable en lui-même, il n’est exprimable
que par la figure que dessinent, dans leur ensemble, les évoca-
tions. Cela même indique que cette bonne disposition est narco-
tique, qu’elle n’appartient pas à une conscience ordinaire, qu’elle
n’est perceptible que dans une conscience altérée. Une pensée
sobre ne peut tout simplement pas la reproduire ou la retrouver,
puisqu’il lui faudrait pour cela les fils expérimentaux, les tracés
mentaux du drogué.
En ce qui concerne l’aspect de psychotrope, il faudrait rele-
ver des caractères qui sont assez évidents dans une philosophie,
mais sont rarement pris en compte et analysés. Il s’agit en pre-
mier lieu d’une vigueur dans les discours, reconnaissable en
particulier à la densité d’idées dans une page philosophique,
mais aussi à une puissance entraînante des arguments. Il s’agit
en second lieu d’attirer l’attention sur l’aptitude au délire chez
les philosophes. Prévenons autant que possible les malenten-
dus sur ce point. Nous prendrons « délire » en un sens positif,
nullement dans une optique de dérision, encore moins avec des
idées de thérapie dans la tête (« guérir » les philosophes de leur
délire). Le délire des philosophes est tout à fait spécial ; c’est
une variation sur la meilleure pensée qui puisse être donnée à
goûter.

Un rapprochement entre les états narcotiques ordinaires et
les dispositions philosophiques n’est d’ailleurs pas aussi incon-
gru qu’il paraît. Déjà, sous l’effet des premiers, on peut s’ima-
giner que l’on fait de la philosophie ou qu’on résout des problè-
mes métaphysiques ; Baudelaire, dans Du vin et du haschisch, le
suggère pour le « kief », état suprême du voyage en haschisch :
« Tous les problèmes philosophiques sont résolus. Toutes les
questions ardues contre lesquelles s’escriment les théologiens et
qui font le désespoir de l’humanité raisonnante, sont limpides
et claires. Toute contradiction est devenue unité. L’homme est
passé dieu. »
En creusant la question, on finirait par trouver, non pas tant
une incompatibilité, qu’une relation de modèle à simulacre entre
philosophie et drogues. Les drogues, « singerie de la haute marée
de l’âme1 », dit Nietzsche. Ne simulent-elles pas les hauts états
philosophiques ? C’est une idée qui paraît se dégager du Phèdre
de Platon, où un certain discours sur l’amour du rhéteur Lysias
est qualifié de pharmakon, « drogue » (mais aussi « philtre »,
« remède », « poison »). Cette drogue plonge Phèdre, l’ami de
Socrate, et dans une certaine mesure assez mystérieuse ce der-
nier lui-même, dans un état de surexcitation. Ils n’en seront tous
deux guéris que par un état d’excitation infiniment supérieur, qui
est la philosophie.
Cette caractérisation d’un discours comme drogue / poison par
le Phèdre se dessine sur le fond de la vieille distinction entre la
rhétorique et la philosophe. Dans le Gorgias, la rhétorique appa-
raît, au même titre que l’art du sophiste (autre maître en sortilè-
ges et discours-poisons), comme le simulacre flatteur d’arts qui
sont pour Platon le propre du philosophe : la justice et la légis-
lation politique. Le rhéteur simule l’art de la justice, le sophiste
l’art du législateur. Entendons que, par leur discours, ils éveillent
dans l’âme les simulacres des hauts états de la justice et du bien
politique. Significativement, la rhétorique est assimilée à la cui-
sine, pratique routinière des sauces et décoctions en tous genres.
1. Le gai savoir, II, § 86, trad. par Pierre Klossowski, Gallimard, « Folio/
essais », 2002, p. 114.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%