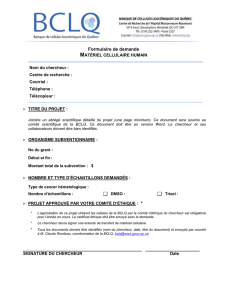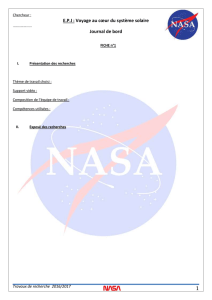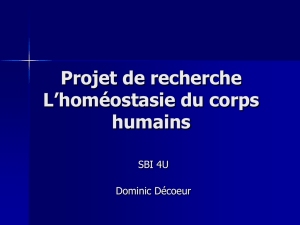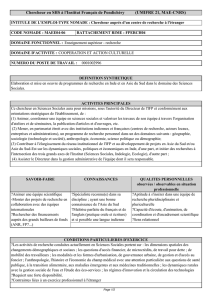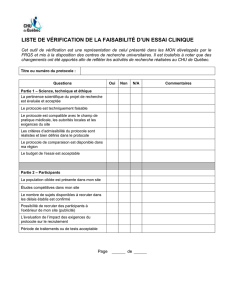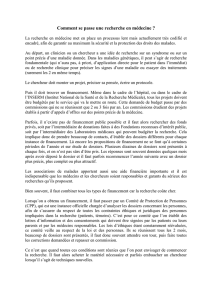Wieviorka chap 3.rtf - Consulat Général de France à Barcelone

Chapitre 3
L’ENGAGEMENT SOCIOLOGIQUE
A quoi servent les sciences sociales ? La question, récurrente, entraîne
généralement des réponses relatives à la vie de la Cité. Si les sciences sociales
apportent un savoir sur la société, ne sont-elles pas susceptibles tout aussi bien
d’exercer une influence sur elle ? Les connaissances qu’elles apportent ne
peuvent-elles pas servir à toute sorte d’acteurs et de médiateurs, aux pouvoirs
politiques, et à leurs opposants, par exemple, ou bien encore transiter par les
médias, et de là, peser dans le sens de la transformation, ou d’ailleurs, au
contraire, et tout aussi bien, dans celui du conservatisme ? Ceux qui produisent
ces connaissances sont eux-mêmes interpellés, du dehors de leur discipline, ou
par leurs pairs, ou amenés à s’interroger : ne doivent-ils pas s’engager, s’inscrire
dans des dynamiques où la production du savoir est indissociable pour eux d’une
mobilisation à caractère politique ?
De façon explicite ou non, nombre de penseurs sociaux
1
, parmi les plus
importants auteurs classiques, ont conjugué au fil de leur existence production
d’analyses, action politique. Alexis de Tocqueville a été Conseiller général de la
Manche et député durant une bonne partie de sa vie adulte, et même, un court
moment, en 1849, ministre des Affaires étrangères ; Karl Marx fut un inlassable
acteur politique, un dirigeant révolutionnaire et pas seulement l’auteur du
Capital et, au delà, d’une œuvre pléthorique; Max Weber a fait partie de la
délégation allemande signataire du Traité de Versailles en 1918, puis de la
commission chargée de préparer la Constitution de Weimar, et il fut un des
fondateurs du Parti démocratique allemand.
De nombreux autres penseurs sociaux, sans se mobiliser aussi nettement ou
durablement ni apparaître comme des quasi-acteurs politiques, n’en ont pas
moins exercé par leurs écrits une influence plus ou moins considérable sur la vie
collective. Émile Durkheim, par exemple, ne s’est vraiment engagé qu’au
moment de l‘Affaire Dreyfus, et en contribuant à la fondation de la Ligue pour
la Défense des Droits de l’Homme ; et il a pris bien garde à séparer nettement sa
vie universitaire de cet engagement.
1
Dans ce chapitre, et pour éviter les risques d’anachronisme, nous parlerons de « penseurs sociaux » à propos
d’auteurs classiques, et de « chercheurs » à propos d’auteurs contemporains. Les frontières entre les deux
groupes sont certainement délicates à bien tracer : disons qu’aujourd’hui, un « chercheur » s’étonnerait d’être
catalogué « penseur social », et qu’hier, le terme de « chercheur » aurait paru incongru.

Longtemps, la question de l’engagement du penseur social s’est organisée en
fonction de deux couples principaux de tension ou d’opposition. Le premier
couple, élémentaire, permet de distinguer ceux qui refusent toute idée
d’engagement et considèrent qu’il n’est d’activité scientifique, en matière
sociale, que dissociée d’un quelconque investissement militant ou politique,
d’un côté, et d’un autre côté ceux pour qui au contraire il n’est pas possible de
séparer radicalement l’analyse et l’action, la production du savoir, ou du moins
d’idées, et leur diffusion. Et le second couple renvoie à la nature des choix
théoriques généraux qui orientent la recherche en mettant l’accent sur la tension
fondamentale des sciences sociales, entre le point de vue de la société, du
système, de la totalité, et celui de l’individu, de l’acteur, du sujet. L’engagement
du penseur social n’est évidemment pas le même selon qu’il privilégie plutôt
l’une, ou plutôt l’autre perspective, selon qu’il s’intéresse en priorité à la société,
ou à l’individu ; à l’acteur, ou au système ; à la totalité, ou au sujet.
En mettant en relation les choix théoriques du penseur social, ou du chercheur,
et la nature de son éventuel engagement, on crée en fait un couple d’opposition
déséquilibré, car dans leur majorité, les sciences sociales, et tout
particulièrement la sociologie et les sciences politiques ont longtemps privilégié
le point de vue de la société. Soucieux de penser l’intégration du corps social, la
forte correspondance de la société, de État et de la nation, soucieux, tout aussi
bien, d’accorder au politique et, souvent, à État, une place centrale, bien des
penseurs sociaux ont voulu sinon conseiller le Prince, du moins définir les
conditions d’amélioration du système institutionnel, proposer les voies de la
réforme, incarner leur nation, ou bien encore mettre en cause le pouvoir, voire
préparer la rupture révolutionnaire, ou contribuer à la libération des peuples et
nations opprimés. Mais l’accélération de la globalisation, on l’a vu, met en cause
le cadre classique de l’analyse que constituent État et, en forte correspondance
avec lui, la nation et la société – nous apprenons désormais à penser « global ».
Dans ces conditions, le point de vue de la totalité ou du système se déplace
nécessairement, s’écartant de la société pour envisager la planète ou du moins de
vastes régions, ainsi que des réseaux transnationaux, ce qui est un
encouragement non seulement à s’éloigner des modèles « westphaliens »
d’analyse, mais aussi à envisager de donner plus de poids à des perspectives
centrées sur l’individu ou le Sujet.
S’il est utile d’intégrer dans une même analyse le thème de l’éventuel
engagement du chercheur, et celui de ses orientations théoriques, il convient de
ne pas négliger ce qui est une caractéristique essentielle des sciences sociales :
elles s’efforcent d’articuler la pensée et les faits, la réflexion abstraite et le
travail concret, le terrain. Or l’articulation des idées et de la pratique suppose le
recours à une méthode. En sciences sociales, les choix théoriques se prolongent
eux-mêmes, très directement, par des démarches concrètes, qui impliquent toute

sorte d’aspects méthodologiques : par exemple, définition claire de l’objet,
constitution d’un échantillon, insertion dans un milieu donné, approche
d’informateurs et autres intermédiaires avec un « terrain », etc. Le choix d’une
méthode (quantitative ou qualitative, par entretiens individuels, ou collectifs,
avec des questions ouvertes, ou fermées, observation participante, etc.) dépend
d’abord des orientations générales du chercheur. S’il considère, par exemple,
que les contraintes sociales façonnent les comportements des individus, il
privilégiera une démarche qui permette d’appréhender les contraintes sociales, et
de mesurer les conduites des individus, de façon à mettre les unes et les autres
en relation –c’est ainsi Émile Durkheim étudie le suicide dans une étude
classique où il aboutit à distinguer diverses sources sociales du phénomène, qui
varie pour chaque individu en fonction inverse du degré d’intégration du groupe
auquel il appartient
2
. Si le chercheur considère, au contraire, qu’il faut partir de
l’individu pour remonter vers la totalité, et ainsi l’expliquer, ce que Raymond
Boudon appelle l’individualisme méthodologique
3
, alors il privilégiera des
démarches qui s’intéressent en premier lieu aux besoins, aux attentes, aux
demandes des individus, à leurs calculs économiques, à leur rationalité, à leur
attachement à certaines valeurs, à leurs croyances ou à leurs ressources. C’est
ainsi que Max Weber montre, dans son étude non moins classique de l’éthique
protestante, que le capitalisme s’est mis en place là où des valeurs religieuses,
l’ethos protestante, puritaine, orientaient le comportement économique
d’entrepreneurs
4
.
Mais l’adoption d’une méthode plutôt qu’une autre est également fonction de
l’objet étudié. Au sein d’une même orientation théorique, on ne s’y prendra pas
de la même façon, par exemple, pour étudier l’expérience vécue de la prison, ou
celle du travail à la chaîne, l’une et l’autre imposant de fortes contraintes aux
individus concernés, et les choix de consommation, beaucoup plus libres. La
méthode n’est donc pas un simple ensemble de techniques, comme s’il suffisait
de maîtriser les outils statistiques ou d’avoir suivi une formation à l’analyse de
contenu pour être en mesure de produire des connaissances en sciences sociales.
Isoler la « méthodologie » pour en faire une discipline ou une sous-discipline
indépendante est une erreur, puisqu’il n’y a pas de choix en la matière sans
réflexion sur les orientations générales de la recherche, d’un côté, et sur les
caractéristiques de l’objet qui sera étudié pratiquement, d’un autre côté.
Ainsi, il est légitime d’associer dans une même analyse la question de l’utilité
des sciences sociales, celle de l’engagement du chercheur, celle de ses
2
Émile Durkheim, Le suicide, Paris, 1897.
3
Cf. par exemple ce qui est dit de l’individualisme méthodologique dans Raymond Boudon et François
Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1982.
4
Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, (nouvelle traduction par Jean-Pierre Grossein),
Paris, Gallimard, 2003 [1904-1905].

orientations théoriques et, prolongement presque naturel, celle de ses
décisions méthodologiques. Mais il faut faire un pas de plus.
Les sciences sociales, leur nom l’indique, sont des disciplines à visée
scientifique, ce qui les oblige à définir leurs critères de scientificité, et, plus
précisément, à indiquer ce qu’elles considèrent être de l’ordre de la
démonstration. Qu’est ce que trouver, en sciences sociales, et qu’est-ce que
prouver ? Très tôt, les auteurs classiques ont pu en débattre, en particulier en
comparant leurs disciplines avec les sciences de la nature, et en sachant bien
qu’une différence fondamentale tient au fait, comme l’écrit Immanuel
Wallerstein, que « les sujets de débat dans les science naturelles sont
normalement résolus sans recourir à l’opinion de l’objet étudié », ce qui n’est
pas le cas avec les sciences sociales
5
. Car l’ « objet étudié » est toujours
susceptible de s’exprimer, directement ou non, et non seulement de faire
connaître sa propre opinion sur ce qui est dit et écrit de lui, mais aussi d’en
appeler à celle d’ensembles beaucoup plus larges, groupe social, parti politique
par exemple. Comme savant aussi bien que comme acteur engagé, le chercheur
doit tenir compte de la façon dont des « objets » se saisiront éventuellement des
connaissances qu’il a produites, et du jugement qu’eux-mêmes ou d’autres
livreront à propos de son travail. La conception qu’il a de son rapport à son objet
est un élément déterminant aussi bien de sa démonstration, que de son éventuel
engagement.
Il faut donc pour traiter de l’engagement des chercheurs en sciences sociales
envisager une chaîne complexe puisque incluant divers éléments : la production
d’un savoir scientifique, la démonstration, et, en amont, leurs choix théoriques,
axiologiques et méthodologiques. Mais cette façon d’aborder la question de
l’engagement n’est pas évidente. Tout au long de l’âge classique des sciences
sociales, jusqu’à la décomposition du fonctionnalisme
6
, à partir des années 60, et
des diverses variantes du marxisme, un peu plus tard, les débats ont plus séparés
qu’intégrés ces divers éléments qui pourtant font système.
1. « Professionnels » et intellectuels
Souvent, un choix simple semble diviser le monde des sciences sociales : il y
aurait les « professionnels », d’un côté, et de l’autre les intellectuels ; les
penseurs engagés, et les autres. Les « professionnels » (selon la terminologie
américaine) appartiennent à un univers bien délimité, au sein duquel ils forment
leurs étudiants et échangent avec leurs collègues, publiant dans des maisons
d’édition et des revues spécialisées, participant à des colloques et congrès où ils
5
Immanuel Wallerstein, Ouvrir les sciences sociales. Rapport de la commission Gulbenkian pour la
restructuration des sciences sociales présidée par Immanuel Wallerstein, Paris, Descartes § Cie, 1996.
6
Sur cette décomposition, cf. l’ouvrage de référence, Alwyn Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology,
Basic Books, 1970.

débattent entre eux, sans se préoccuper d’intervenir davantage dans l’espace
public, du moins en tant que chercheurs – rien ne leur interdit de se mobiliser,
par exemple, comme citoyens, membres d’une association, d’une ONG, d’un
parti politique. La figure du « professionnel », plus forte aux États-unis et, plus
largement, dans le monde anglo-saxon qu’en France, se méfie de l’idéologie, et
ceux qui s’en réclament ne veulent surtout pas être identifiés à la figure de
l’intellectuel, en particulier « sartrien » – nous faisons ici référence aux
conférences de Sartre au Japon, dans lesquelles il explique qu’un intellectuel est
quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas
7
.
Mais symétriquement, cette posture faite d’extériorité et de neutralité,
s’efforçant généralement de se tenir au plus loin de toute normativité, se
réclamant du refus de toute idéologie et se prévalent d’une scientificité éprouvée
est depuis longtemps récusée, et d’abord au motif qu’elle recouvrirait en fait une
toute autre marchandise. Antonio Gramsci, l’important dirigeant communiste
italien, dont les écrits ont exercé une influence considérable, emprisonné dans
les geôles de Mussolini, a dans ses Carnets de prison critiqué cette idée d’une
neutralité des penseurs qui se veulent à l’écart des rapports sociaux, alors qu’ils
sont selon lui en fait au service « organique » des dominants. Le chercheur en
sciences sociales devient, avec de tels arguments, sommé de se situer, il relève
nécessairement d’un camp ou d’un autre au sein d’une société divisée par la
lutte des classes.
Mais peut-on accepter une telle disqualification, qui rejette les
« professionnels » dans l’enfer de la subordination, inconsciente de surcroît, au
pouvoir ? Les « professionnels » sont au plus loin de tout engagement, cela ne
veut pas dire pour autant que le savoir qu’ils produisent et diffusent relève de la
seule idéologie, et qu’il n’a aucune pertinence scientifique. A la limite, une
conception pure et dure qui se réclamerait de Gramsci ne peut voir dans les
chercheurs « professionnels » que des « chiens de garde » qu’il ne resterait plus
qu’à combattre au nom des exclus ou des dominés, et en tous cas à rejeter hors
du champ de la respectabilité intellectuelle – sans examen du contenu de leur
travail, ce qui n’est pas acceptable. C’est pourquoi le sociologue américain
Michael Burawoy, promoteur d’une « Public Sociology », (« sociologie
publique ») qui implique un fort engagement du chercheur dans la vie de la Cité,
tout en s’inspirant fortement et explicitement de la pensée de Gramsci, non
seulement se refuse à heurter de front la sociologie « professionnelle », mais
même lui rend hommage
8
: elle fournirait selon lui les méthodes et les cadres
7
Jean-Paul Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Paris, Gallimard, 1972.
8
Michael Burawoy, « What is to be done ? Theses on the degradation of social existence in a globalizing world”,
Paper presented at the International Sociological Association in a Debate on “Sociology in Common Sense,
Political Practice and Public Discourse”, Durban, July, 29
th
, 2006.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%