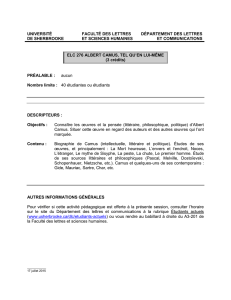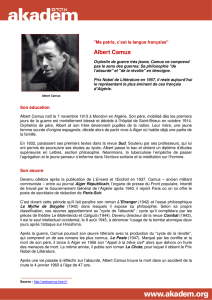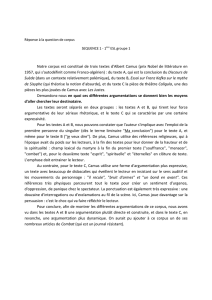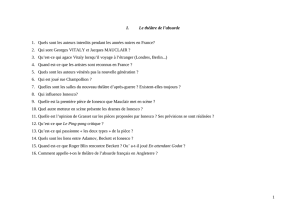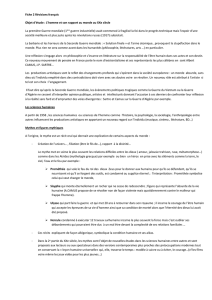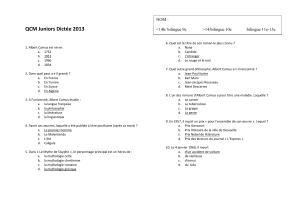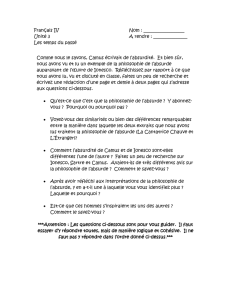Entre Misère et Grandeur, L`Homme sans Dieu selon - Serval

!
!
Unicentre
CH-1015 Lausanne
http://serval.unil.ch
!
Year : (2010)
(Entre Misère et Grandeur, L’Homme sans Dieu selon Pascal et
Camus)
(Mathieu RODUIT)
(Mathieu RODUIT) (2010) (Entre Misère et Grandeur, L’Homme sans Dieu selon Pascal et
Camus)
Originally published at : Mémoire de maîtrise, Université de Lausanne
Posted at the University of Lausanne Open Archive.
http://serval.unil.ch
Droits d’auteur
L'Université de Lausanne attire expressément l'attention des utilisateurs sur le fait que tous les
documents publiés dans l'Archive SERVAL sont protégés par le droit d'auteur, conformément à la
loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). A ce titre, il est indispensable d'obtenir
le consentement préalable de l'auteur et/ou de l’éditeur avant toute utilisation d'une oeuvre ou
d'une partie d'une oeuvre ne relevant pas d'une utilisation à des fins personnelles au sens de la
LDA (art. 19, al. 1 lettre a). A défaut, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par cette
loi. Nous déclinons toute responsabilité en la matière.
Copyright
The University of Lausanne expressly draws the attention of users to the fact that all documents
published in the SERVAL Archive are protected by copyright in accordance with federal law on
copyright and similar rights (LDA). Accordingly it is indispensable to obtain prior consent from the

!
!
Unicentre
CH-1015 Lausanne
http://serval.unil.ch
author and/or publisher before any use of a work or part of a work for purposes other than
personal use within the meaning of LDA (art. 19, para. 1 letter a). Failure to do so will expose
offenders to the sanctions laid down by this law. We accept no liability in this respect.

Mémoire de Maitrise universitaire ès lettres
réalisé en Section de philosophie
Faculté des lettres
Université de Lausanne
ENTRE MISÈRE ET GRANDEUR,
L’HOMME SANS DIEU SELON PASCAL ET CAMUS
par Mathieu RODUIT
sous la direction du Professeur Raphaël CÉLIS
session d’aout 2010

Caspar David FRIEDRICH, Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1817-1818,
huile sur toile, 95 cm x 75 cm, Kunsthalle de Hambourg

TABLE DES MATIÈRES
Remerciements .......................................................................................................... 1
Introduction ............................................................................................................... 3
Problématique ........................................................................................................... 7
Les Sentiments existentiels de l’homme sans Dieu ............................................ 11
L’Effroi pascalien .............................................................................................................................. 15
Remarque préliminaire : le projet apologétique ............................................................................................. 15
L’Effroi face à l’univers infini ....................................................................................................................... 17
L’Effroi face au moi fini ............................................................................................................................... 22
L’Étrangèreté ou le Sentiment de l’absurdité camusien ................................................................ 27
Remarque préliminaire : l’absurde et le suicide ............................................................................................. 27
L’Étrangèreté à soi ........................................................................................................................................ 29
L’Étrangèreté à sa propre mortalité ............................................................................................................... 38
L’Étrangèreté à la vérité ................................................................................................................................ 49
L’Étrangèreté à la raison ............................................................................................................................... 50
Mise en perspective de l’étrangèreté et de l’effroi .......................................................................... 55
L’Étrangèreté de Dieu ................................................................................................................................... 59
L’Homme et le Monde ............................................................................................ 65
D’après Pascal ................................................................................................................................... 67
L’Égarement ................................................................................................................................................. 67
Le Divertissement ......................................................................................................................................... 69
D’après Camus .................................................................................................................................. 73
L’Absurde ..................................................................................................................................................... 73
La Lucidité ................................................................................................................................................... 74
L’Espoir ................................................................................................................................................................... 77
Le Suicide philosophique ....................................................................................................................................... 79
Le Suicide ................................................................................................................................................................ 80
Le Pari ....................................................................................................................... 83
D’après Pascal ................................................................................................................................... 83
D’après Camus .................................................................................................................................. 87
Le Pari de l’absurde ...................................................................................................................................... 87
Le Pari libertin ............................................................................................................................................. 88
Conclusion ................................................................................................................ 91
Abréviations ............................................................................................................. 95
Bibliographie ............................................................................................................ 97
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
1
/
104
100%