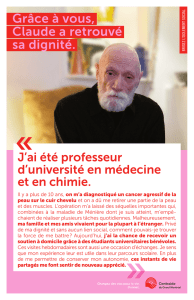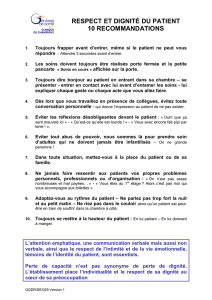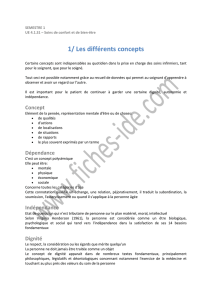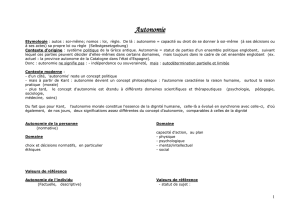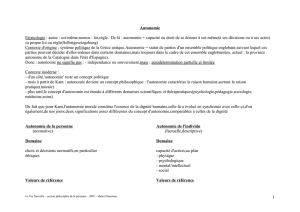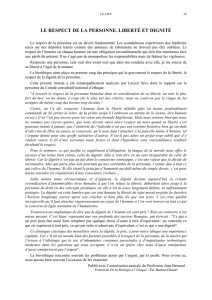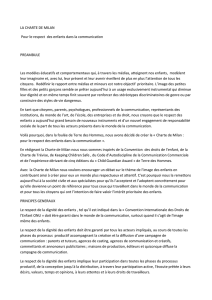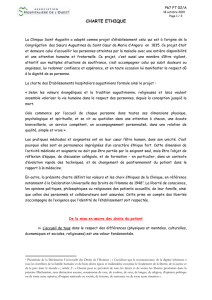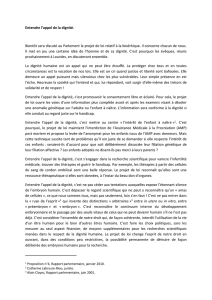Universalité des droits de l`homme et diversité

DEUXIEME THEME
Universalité des droits de l'homme
et diversité des cultures
*
Aspects philosophiques
des droits fondamentaux


Personne, culture et droits :
harmonie, polyphonie et dissonance
PAR
HENRI PALLARD
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (CANADA) *
L'idéologie des droits de la personne est tributaire du mouvement philoso-
phique qui voit le jour à l'Âge de la raison ; elle se fonde sur l'idée que tous
les êtres humains possèdent une nature universelle qui est conforme à la rai-
son. Mais cette pensée a très tôt fait l'objet d'une critique sévère. Nous
retrouvons à l'origine de cette critique les mêmes idées qu'à l'origine de la
diversité comme trait définissant de la culture humaine : le refus d'une rai-
son pouvant accéder à une vérité universelle et, dans son sillage, le refus
d'une nature humaine homogène. À la perception eurocentrique du monde
moderne vient se substituer une conception plus moderne caractérisée par
la contingence ou la relativité des valeurs.
Quelle signification devons-nous alors attacher aux diverses déclarations
juridiques et politiques affirmant l'universalité des droits fondamentaux ? Y
a-t-il
des droits irrécusables devant lesquels tous les gouvernements doivent
s'incliner et, si oui, pourquoi ces droits sont-ils obligatoires ? Ou les droits
de la personne ne sont-ils qu'une expression contingente de certaines valeurs
culturelles sans prise sur les gouvernements ? Harmonie, polyphonie et dis-
sonance à la fois caractérisent les réponses proposées par Personne, culture
et droits à ces questions \
I. - HARMONIE, POLYPHONIE ET DISSONANCE
L'harmonie se situe au niveau de la genèse des droits fondamentaux et de
ses liens avec le concept de personne. D'abord, nous nous accordons pour
dire que la conception du monde et de l'être humain qui caractérise la
Modernité rend possible l'apparition historique des droits fondamentaux.
Ensuite, nous sommes tous d'avis que la Modernité ne peut pas fonder de
façon apodictique la nécessité universelle des droits fondamentaux.
* Département de Droit et Justice, Université Laurentienne, Sudbury (Ontario), Canada.
1. Les premiers travaux de l'équipe, Personne, culture et droits, paraîtront dans Droits fonda-
mentaux et spécificités culturelles, H.
PALLARD
et S.
TZITZIS
(dir.), L'Harmattan, Paris, 1996.

122 HENRI PALLARD
Est-il alors possible d'assurer l'universalité des droits fondamentaux tout
en respectant la diversité culturelle ? Nous retrouvons-là une véritable dis-
sonance. Certains chercheurs croient qu'il y a un fondement aux droits, fon-
dement qu'il faut aller découvrir dans une ontologie ou une métaphysique.
Quant aux spécificités culturelles, elles sont contingentes et doivent céder le
pas devant la nécessité des droits fondamentaux.
Les autres chercheurs rejettent la possibilité d'une vérité universelle à
laquelle l'être humain peut accéder. En conséquence, les droits fondamen-
taux ne possèdent aucune validité universelle.
S'étant
mis d'accord sur ce
point, ces chercheurs se divisent sur la démarche à emprunter par la suite.
Un premier groupe reste ferme et refuse toute nécessité aux droits fonda-
mentaux. Le deuxième croit qu'il y a une nécessité, une universalité qui se
creuse dans l'expérience humaine et qui surmonte la diversité culturelle.
Quelle signification devons-nous attacher aux droits fondamentaux ? Là,
nous retrouvons une véritable polyphonie, chaque chercheur épousant un
point de vue différent. Cette polyphonie porte sur une idée commune, la per-
sonne
;
mais de quelle
«
personne
»
s'agit-il ?
A.
—
Nécessité et universalité des droits fondamentaux
Selon Hassan Abdelhamid2, le fondement apodictique des droits de
l'homme se retrouve dans leur unité métaphysique, l'idée de justice qui
existe dans l'homme en tant qu'elle est vertu 3. Cette recherche récuse l'ap-
proche moderne et sa réduction de l'humain à son aspect empirique pour
retrouver la signification des droits fondamentaux dans une nature humaine
où sa dimension métaphysique est reconnue. Il faut retrouver l'unité ontolo-
gique de la personne si on veut assurer les fondements des droits de la per-
sonne 4, les garantir contre des interprétations diverses propres à chaque
culture. En recourant à l'individualité pour définir la personne, la Modernité
deviendrait incapable de découvrir un élément commun à la personne qui
dépasse les données culturelles spécifiques car elle aurait universalisé ce qu'il
y a de particulier chez l'individu
—
sa liberté. Il faut plutôt universaliser
l'être humain en tant que tel. L'universalité des droits de la personne peut
être garantie seulement par la nature universelle de l'être humain. C'est seu-
lement en retrouvant F« Homme universel
»
comme archétype idéal que l'on
peut y parvenir.
La raison universelle en tant que principe transcendantal de la nature
humaine nous permet de saisir la dimension universelle de la nature
2.
«
Les droits de l'homme et l'Homme universel
»,
dans Droits fondamentaux et spécificités
culturelles, pp. 63-80.
3.
Ibid.,
pp. 79-80.
4.
Ibid.,
p. 66.

PERSONNE, CULTURE
ET
DROITS
123
humaine 5. Elle nous permet
de
saisir l'être humain individuel
-
relatif
et
incomplet
-
comme partie intégrante de 1'« Homme universel
»
et
de surmon-
ter ainsi les contingences
de
l'existence pour fonder les droits fondamentaux
sur
ce
qu'il
y a de
nécessaire.
En
adoptant
le
point
de
vue
de
l'idéalisme,
selon H. Abdelhamid, on peut retrouver l'inconditionné, l'idée
de
1'« Homme
universel
»
qui existe indépendamment de nous car 1'« Homme universel
»
est
le principe
de
toute manifestation ; l'homme individuel
en est la
résultante,
l'aboutissement
6. On
pourra alors accéder
à
une
connaissance apodi etique
des droits fondamentaux
qui
seront
à
l'abri
des
contingences culturelles
; ils
s'imposeront
à
toutes
les
sociétés.
Pour François Vallançon
7, il
n'est
pas
possible
de
justifier l'universalité
des droits fondamentaux tels
que
nous
les
connaissons aujourd'hui parce
qu'ils
ne
sont qu'un simulacre.
Il
part
de
la
constatation qu'il
y a
plusieurs
manifestations différentes des droits fondamentaux. Cela
est
dû
au
fait qu'il
n'y
a pas
d'unité
de
principe
à
leur origine ;
cet
auteur attribue cette
absence d'unité
aux
effets engendrés
par
l'idéologie
qui
sous-tend les droits
fondamentaux
et qui
puise
ses
sources dans
la
pensée moderne. Selon
F.
Vallançon, l'homme moderne devient
la
mesure
de
toute chose
et
l'idée
d'universalité
est
réduite
à un
élément commun. Afin
de
surmonter
la
diffi-
culté posée
par
la
réduction
de
l'universalité
au
général
et de
redonner
une
véritable dimension universelle
aux
droits fondamentaux,
ils
doivent
prendre comme objet
une
relation bonne
et
juste.
Ce
mouvement
ne
peut
s'opérer qu'à partir de
la
nature ontologique
de
l'être humain. On doit alors
déduire
les
droits fondamentaux
à
partir
de
l'essence
de
l'homme.
De
cette
unité humaine
et
naturelle,
on
peut construire l'unité juridique
et
culturelle.
En effet,
ce
que nous propose
F.
Vallançon, c'est
de
repenser les droits
de
l'homme
à la
lumière
des
philosophies aristétolicienne
et
thomiste.
Les
droits fondamentaux dans
la
pensée moderne prennent les individus comme
fondement
et le
bien
et la
justice proviennent
des
individus. Selon
F.
Vallançon,
il
faut renverser
la
perspective
:
les
droits fondamentaux doi-
vent porter
sur
la
relation entre
les
individus.
Si
les
analyses conduites
par H.
Abdelhamid
et F.
Vallançon diffèrent,
la
structure
de
leurs pensées
se
ressemble. Conscients
du
fait
que
la
raison
de
la Modernité conduit
en
dernière
et
ultime analyse
à un
relativisme absolu,
ils cherchent
le
socle
sur
lequel toute connaissance doit s'ériger.
À
partir
d'une critique
de
l'individualité moderne,
les
deux conçoivent
la
justice
comme
le
principe d'unité autour duquel s'articulent
les
droits fondamen-
5.
Ibid., p. 66.
6.
Ibid., p. 70.
7.
Voir
«
Universalité
des
droits fondamentaux
et
diversité culturelle
»
; ce
texte paraît dans
ce volume. Voir également,
«
Les
Droits fondamentaux entre uniformité
et
diversité
des
cultures
»,
texte inédit préparé pour Personne, culture
et
droits.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
1
/
134
100%