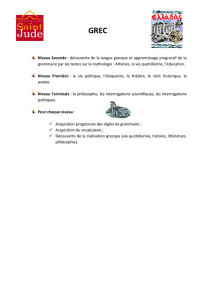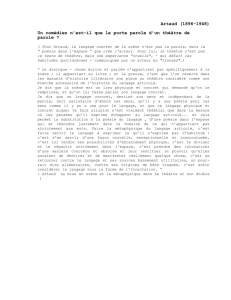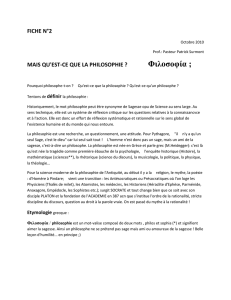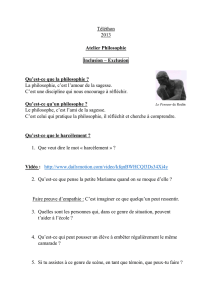poesie, philosophie, sagesse

POESIE, PHILOSOPHIE,
SAGESSE
Jean-Michel BUÉE
LU.F.M. de Grenoble
ourquoi et comment la Logique de la Philosophie
en vient-elle à
parler de sagesse ? Pourquoi en vient-elle, dans son chapitre
final à lier sens
et sagesse,
en affirmant que penser
le sens,
c'est
aussi penser
I'homme u QUi,
dans son existence concrète, est le sens
>,
c'est-à-dire
le sage ?
Pour le comprendre, peut-être faut-il partir de la façon dont la
philosophie
s'est
comprise,
c'est-à-dire du rapport complexe
qui la lie à la
poésie. Rappelons
d'abord, afin d'éviter tout malentendu,
que le terme
poésie
ne désigne
pas ici " I'art des rimes, des mesures,
du verbe bien
choisi et bien placé
" (LP, 421). La poésie,
que Weil nomme
aussi
poésie
fondamentale
(LP, 422), est à entendre dans une acception
à la fois " plus
large u et u plus profonde u, où u elle n'est pas affaire de gens
doués
et de
talent " (lbid.) : elle est u création spontanée
" (LP, 421) de sens dans le
langage ; ou plus exactement elle est le langage lui-même en tant que
spontanéité créatrice ; ou encore, elle est " I'homme même ,, (LP, 422),
c'est-à-dire
I'homme en tant qu'animal parlant, pour qui le langage
n'cst
ni un objet ni un instrument, mais le milieu à I'intérieur duquel il se
rapporte à tout ce qui est. Parler
de poésie,
c'est simplement rappeler
que
I'homme se rapporte
à la réalité
en tant qu'être parlant,
ou si I'on préfère,
c'est rappeler
que pour I'horrrme, il n'est de réalité que saisie dans un

r46 JEAN-MICHEL
BUEE
langage
qui lui donne un sens. En un mot, la poésie
n'est autre que le fait
du sens,
et c'est elle qui, en rendant
ce fait visible à la philosophie,
lui
permet aussi de se comprendre : en apercevant dans le langage
le lieu où
le sens se crée, la philosophie
en vient à apercevoir
qu'elle est, elle, celui
où le sens se pense ; autrement
dit, la science
du sens, le discours qui
comprend que tout discours a affaire au sens et que dans la cohérence de
chacun de ses discours, I'homme ne vise qu'à retrouver la présence
du
sens, l'unité immédiate, la coïncidence antérieure à toute séparation
et à
toute différence dont la spontanéité de son langage est le lieu. Mais en
même temps, la philosophie saisirait-elle I'importance de la poésie et
pourrait-elle y découvrir sa propre catégorie, si la poésie n'était pas son
autre, c'est-à-dire le miroir dans lequel elle aperçoit I'image inversée
d'elle-même ? Ce rapport spéculaire traduit la distance qu'a instauré le
parcours
catégorial
entre discours et langage, ou, si l'on préfère,
il renvoie
au fait que le discours s'est libéré de l'illusion qui I'habite, de cette
illusion sans
cesse
renaissante
qui consiste
à croire qu'il lui suffirait de se
refermer sur sa propre cohérence
pour y retrouver la présence
concrète
à
laquelle donne immédiatement accès le langage
poétique.
Dans la catégorie
du sens,
c'est cette
distance
qui se pense,
sous la forme de l'écart entre
sens formel et sens concrets,
écart qui en interdisant leur coïncidence
interdit aussi
à la philosophie
d'être autre chose
qu'un discours formel-
lement cohérent, le discours dans lequel se dit I'unité formelle des
multiples sens concrets que I'homme a créés dans la spontanéité de son
langage
poétique.
En thématisant
ce lien d'extrême proximité et de distance infinie qu'est
son lien à la poésie, la philosophie comprend qu'elle n'est pas pour
I'homme le lieu de la présence
et du contentement
: il peut certes s'y
comprendre,
mais il ., n'y trouve rien à prendre " (LP,435), aucun
contenu concret qui viendrait combler son désir de satisfaction et de
présence. Or, qu'en résulte-t-il ? Que ce désir serait vain ? Et qu'il
faudrait y renoncer pour se contenter, d'un côté, d'un discours cohérent
mais vide, et de I'autre, d'une satisfaction
pleine et entière, mais incom-
municable ? Ou plutôt que cette dualité, bien qu'irréductible, peut
cependant être dépassée ? Et que I'homme peut trouver le contentement,
non dans le discours, mais par le discours, au moyen du discours, en
parvenant
à une satisfaction
qui se situe au-delà de la philosophie, mais à
laquelle la philosophie
et elle seule
peut donner accès ?
Il est évident que ce contentement
capable d'unir cohérence et
sentiment, sans pourtant constituer la synthèse de la philosophie et de la
poésie, n'est rien d'autre que ce que la tradition philosophique
a toujours
désigné
sous le nom de sagesse.
Mais il est tout aussi évident
que I'idée
de sagesse
ne suffit pas, en tant que telle, à résoudre le problème de la

POÉSIE,
PHILOSOPHIE,
SAGESSE
satisfaction
concrète
que I'homme peut attendre de la philosophie. Elle lui
permet uniquement de le poser, en disposant
d'un concept, d'une caté-
gorie, qui nomme cette satisfaction et qui permet d'en parler, mais sans
que I'on sache exactement ce que I'on désigne
par là, ni même si I'on
désigne bien quelque
chose.
Autrement
dit, en parlant
de sagesse,
en intro-
duisant I'idée de sagesse, la philosophie a simplement abouti à un
paradoxe
: elle parle de quelque
chose, d'un contentement
qu'elle nomme
sagesse et elle renvoie ainsi à ce qui est à ses
yeux le plus concret,
mais
pourtant
elle semble ne rien dire, n'énoncer
qu'une
abstraction dont le seul
contenu
est une absence
de contenu,
un vide qui, loin de révéler ce qu'est
réellement
la sagesse,
semble au contraire
n'en signifier que I'inexistence
et l'irréalité.
Est-ce à dire que I'idée de sagesse
serait une illusion et la sagesse un
néant ? Et qu'en cherchant à concilier cohérence et présence
la philosophie
ait réellement abouti à rien, à un concept
qui n'est qu'un non-concept,
au
vide de l'impensable ? [æ logicien peut certes se rassurer
en se tournant
vers I'histoire de la philosophie,
et en y découvrant
que la difficulté à
laquelle il se heurte n'est ni arbitraire, ni accidentelle,
puisque
tous les
philosophes
I'ont rencontrée : toujours lorsqu'on tente de la saisir
dans le
discours,
la réalité de la sagesse se dérobe ; toujours
le discours la rend
visible, mais
comme
un lieu impensable
autant
qu'inaccessible,
un aboutis-
sement auquel il n'aboutit
jamais, " dans
le prolongement
du chemin
qui y
mène sans
y arriver, au-delà
d'un gouffre insondable
et qu'aucun
pont ne
franchit " (LP,434). Mais, loin de résoudre
la difficulté, cette
remarque
ne semble
qu'en confirmer le caractère insoluble. Parlerait-on
en effet de
chemin qui ne mène nulle part, de gouffre et d'abîme, serait-on obligé
d'avoir recours
à ce langage
" poétique
", si le discours
ne paraissait,
ici
se heurter à ses propres limites ? Mais en même temps, ces limites,
comment en rendre compte si, comme la catégorie
du sens
l'a montré, la
sagesse
ne peut se confondre
avec
la poésie, puisqu'elle
suppose
ce à quoi
celle-ci a renoncé, c'est-à-dire le concept, I'universalité
du discours, la
raison
et la cohérence ?
Il faudrait
peut-être
se résigner et déclarer
que la sagesse
n'est qu'un
leurre, si I'origine même de ces difficultés
ne pouvait nous mettre sur la
voie de leur solution. Car, ces difficultés, d'où viennent-elles
? Non des
limites du discours, comme le voudrait le penseur
du fini qui, pour en
rendre compte invoque I'abîme séparant I'Etre de l'étant, le discours du
langage ou la philosophie
de la poésie.
Mais, plus prosaïquement,
de la
façon dont le problème
est posé.
La sagesse
paraît
insaisissable
parce
que
son concept ne correspond
à aucun contenu
concret. Mais devrait-il en
avoir un ? Et n'est-ce
pas simplement un contresens
que de chercher à lui
en assigner un ? N'est-ce pas oublier que si la sagesse est au-delà du
r47

148 JEAN-MICHEL
BUÉE
discours, cela exclut précisément
qu'on puisse la définir par un discours,
au moyen d'une catégorie
particulière du type de celles
qui permettent
à la
philosophie
de saisir
les divers sens concrets dont son discours est I'expli-
citation ? La sagesse se montre introuvable,
mais c'est
parce qu'on veut la
trouver là où elle n'est pas et où elle ne peut
jamais être. Autrement
dit,
non parce qu'on la cherche au moyen du discours, cornme le croit la
pensée
du fini, mais parce qu'on la cherche
dans le discours, au sein du
discours, ou sur le plan du discours : c'est la philosophie qui parle de la
sagesse
; c'est elle qui pose le problème de son existence. C'est elle
encore
qui peut en énoncer
la solution. Mais elle n'est pas cette
solution.
Et c'est ce qu'elle a perdu de vue en s'attribuant
une autonomie
illusoire,
en oubliant que le sens est une abstraction,
une forme, que la pensée
saisit
en la détachant
du concret, mais qui n'existe que dans ce conc.ret,
c'est-à-
dire dans la vie d'hommes en chair et en os, qui ne sont pas des
abstractions,
mais vivent et agissent réellement dans une histoire réelle. Ce
simple rappel suffit pour qu'apparaisse
la solution du problème : la
sagesse existe bien, mais elle n'est ni un discours,
ni un langage,
parce
qu'elle est de I'ordre de la vie : elle est le sens, et le sens
révélé
par le
discours,
non le sens créé par la poésie,
mais le sens concrètement
vécu,
dans
la singularité
d'une vie individuelle.
Autrement
dit, elle est attitude
et
attitude qui se montre au discours comme catégorie et comme catégorie
formelle parce qu'elle ne se définit pas par un contenu particulier, mais
par une unité : elle est I'unité vécue
du discours
et de la vie, la coinci-
dence du discours et de la siruation, réalisée ici et maintenant, dans le
concret d'une existence
humaine, et réalisable
par n'importe qui, n'im-
porte où, à n'importe quel moment de I'histoire : il suffit en effet pour
cela que I'homme veuille vivre son discours et réaliser le sens de son
existence,
ce qu'il peut faire quel qu'en soit le contenu, car I'important
n'est ni ce contenu, ni la réussite
ou l'échec de I'entreprise. Mais
simplement que pour cet homme, la vie ait un sens, une orientation
clairement révélée par son discours et à laquelle il puisse se tenir sans
confusion, en sachant ce qui compte à ses
yeux. La difficulté semble
ainsi
avoir disparu : la sagesse
est bien une catégorie
formelle, mais elle n'es[
plus une catégorie
vide. Elle existe sous la forme de multiples sagesses
concrètes
qui, ici, ne se définissent
plus par la particularité
d'un cbntenu,
mais par le fait que le discours s'y réalise, en permettant
à I'individu de
mener une existence
sensée.
Est-ce là pourtant, la solution définitive ? On peut remarquer que le
texte qualifie de " reprises
)' ces sagesses
concrètes
(LP, 437), en ajoutant
un peu plus loin, à propos de I'action que celle-ci est bien " la sagesse la
plus haute ,n,
mais seulement
" dans le premier sens
du mot " (LP, 438).
N'est-ce pas avouer que la difficulté initiale n'a pas disparu, et qu'elle
s'est simplement
déplacée
? Car, si la sagesse
est bien catégorie
et

POÉSIE, PHILOSOPHIE,
SAGESSE t49
attitude,
sagesse
vécue et sagesse
pensée,
I'est-elle en même temps
et pour
le même homme ? Et apparaît-elle
en tant que sagesse à celui qui la vit ?
De toute
évidence,
ce n'est pas le cas, car I'essentiel
pour cet homme, ce
n'est nullement le fait que son existence ait une orientation ; mais son
contenu, le contenu de cette orientation, le sens
particulier et concret qui
la définit.
Autrement dit, il est sage,
mais pour un autre, aux yeux d'un autre
qui, lui, pense
la sagesse
mais qui ne fait aussi
que la penser. Car la
pensée
du sens
de I'existence ne suffit pas à donner un sens
à I'existence
de celui qui la pense.
Ce dernier voit la sagesse des autres, mais il la voit
à partir d'un horizon qui semble impliquer qu'il y ait renoncé pour
lui-même, et la séparation
du formel et du concret
resurgit sous I'aspect
d'un dilemme. De deux choses I'une en effet : ou bien I'homme cesse de
suivre le chemin du discours, en renonçant librement à sa liberté, en
s'enfermant dans la particularité d'un point de vue, et il peut retrouver la
présence
et la présence
concrète, mais au prix du sacrifice
de I'universel
;
ou bien il se refuse à ce sacrifice, et il accède à I'universel, c'est-à-dire
à
la pensée
de I'universel, mais celui-ci n'est qu'un universel
formel, une
forme vide, incapable
de conférer la moindre orientation à son existence
concrète.
S'agit-il cependant
d'un dilemme réel ? Ou sommes-nous simplement
retombés dans I'une de ces pseudo-contradictions
que crée la pensée
dès
qu'elle projette
sur le plan abstrait
du discours
ce qui dans la vie concrète
se concilie parfaitement
? L'universel du sens appraît vide. Mais à qui ?
On répondrait : au particulier,
c'est-à-dire à I'homme qui vit en fonction
de la particularité
d'un contenu concret, si cet homme pouvait le saisir.
Mais c'est là précisément
ce dont il est incapable,
puisque pour lui, c'est
son propre particulier qui est I'universel et le seul universel. Aussi le sens
dans son universalité
ne se montre-t-il en tant que tel qu'à I'homme qui le
pense. Mais cet homme le penserait-il
réellement
si dans son existence
concrète il ne s'était pas détaché de tout contenu
particulier ? Non qu'il se
soit détaché du monde, ou qu'il s'en soit retiré. Mais, tout en continuant à
vivre dans le monde, il a cessé d'être exclusivement
préoccupé par sa
propre existence. Il a cessé
de s'y rapporter en fonction de la seule
recherche d'un but ou d'un contenu
capable de lui assigner un sens
déter-.
miné ; ou si I'on préfère, il s'est détaché de I'horizon des catégories
concrètes, dans lesquelles cette existence
acquiert un sens
particulier, qui
définit une sagesse
particulière, distincte des autres sagesses
concrètement
possibles.
Autrement dit, I'homme qui s'est ouvert au sens, I'homme qui
pense le sens en tant que sens est aussi I'homme qui n'est plus obnubilé
par la question
du sens concret de son existence en tant qu'être fini, non
parce que ce serait là une question
dénuée d'intérêt, ou d'importance, mais
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%