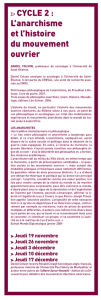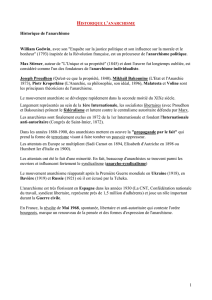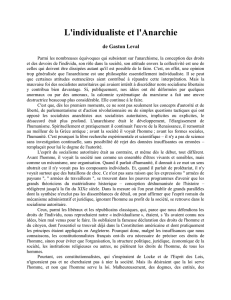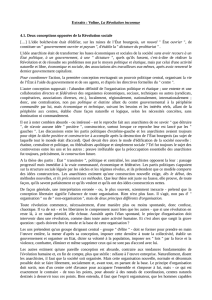Changer le monde sans prendre le pouvoir

I S B N :2 - 8 4 5 9 7 - 0 7 5 - 7
ISSN : 1 6 3 3 - 5 9 7 X
Numéro six
février 2003
18,30 e
CONTReTeMPS
Jérôme Baschet
Daniel Bensaïd
Fausto Bertinotti
Atilio Borón
P i e r r e Contesenne
Philippe Corc u f f
Léon Crémieux
Marianne Debouzy
Philippe Gottra u x
John Holloway
Michaël Löwy
Gaetano Manfre d o n i a
S y l v ain Pa t t i e u
Willy Pe l l e t i e r
Hélène Pe r n o t
Mimmo D. P u c c i a r e l l i
B e r n a r d Vo u t a t
Patrice Spadoni
Changer le monde
sans pre n d r e le pouvoir ?
N o u v eaux libertaire s , n o u v eaux communistes
7 C H A NG E R L E MONDES A N S PRENDRELEP O U V O I R ?
N O U V E A U X L I B E R T A I R E S , N O U V E A U X C O M M U N I S T E S
8Philippe Corc u f f , Michaël Löwy Pour une Première Internationale
au X X I es i è c l e
11MOUVEMENTSSOCIAUX,LUTTESANTI-GLOBALISATIONETSOUFFLELIBERTAIRE
12Léon Crémieux Mouvement social, anti-mondialisation
et nouvelle Internationale
19P i e r r e Contesenne Nouveaux mouvements sociaux,
luttes anti-globalisation et perspectives
d’une nouvelle Internationale
23Hélène Pernot Des thématiques marxistes,
un esprit libertaire –
L’exemple de Sud-PTT
37L E C T U R E S D U N É O - Z A P A T I S M E
38John Holloway Douze thèses sur l’anti-pouvoir
45Daniel Bensaïd La Révolution sans prendre le pouvoir ?
À propos d’un récent livre de John Holloway
60Atilio Borón La montagne et la ville
72Jérôme Baschet Du guévarisme au refus du pouvoir d’État :
les zapatistes et le champ politique
87ANARCHISMESE T M A R X I S M E S
88Gaetano Manfredonia En partant du débat Marx, Proudhon, Bakounine
101Philippe Corcuff De Rosa Luxemburg à la social-démocratie liber-
t a i r e
109Michaël Löwy Walter Benjamin, marxiste – libertaire
118Patrice Spadoni Daniel Guérin ou le projet d’une synthèse entre
l’anarchisme et le marxisme
127Mimmo D. P u c c i a r elli Entre les 100 % à gauche
et les anarchistes purs et durs, mon cœur balance
139RETOURSSURL ’ H IS T O I R E
140Marianne Debouzy Les
Industrial Workers of the World
,
marxistes et libertaires
153S y l v ain Pattieu L’internationalisme en rouge et noir :
trotskistes et libertaires dans la guerre d’Algérie
163RÉPLIQUESE T C O N T R E V E R S E S
164Willy Pelletier Les anarchistes et la reproduction
de l’anarchisme
174Philippe Gottra u x , B e r n a r d Voutat Anarchisme et marxisme :
vrai contentieux et faux clivage
185L U D ’ A I L LE U R S
186Q u i n z e Thèses pour une Gauche européenne
a l t e r n a t i v e Fausto Bertinotti ™xHSMIOFy970755z

CONTReTeMPS
numéro six, février 2003
Changer le monde
sans pre n d r e le pouvoir ?
N o u veaux libertaire s , n o u v eaux communistes

CONTReTeMPS
numéro six, février 2003
Changer le monde
sans pre n d r e le pouvoir ?
N o u v eaux libertaire s , n o u v eaux communistes
CONTRETEMPS
numéro un, mai 2001
Le retour de la critique sociale
Marx et les nouvelles sociologies
numéro deux, septembre 2001
Seattle, Porto Alegre, Gênes
Mondialisation capitaliste et dominations impériales
numéro trois, février 2002
Logiques de guerre
Dossier: Émancipation sociale et démocratie
numéro quatre, mai 2002
Critique de l’écologie politique
Dossier: Pierre Bourdieu, le sociologue et l’engagement
numéro cinq, septembre 2002
Propriétés et pouvoirs
Dossier: Le 11 septembre, un an après
numéro six, février 2003
Changer le monde sans prendre le pouvoir ?
Nouveaux libertaires, nouveaux communistes
© Les éditions Textuel, 2003
48, rue Vivienne
75002 Paris
ISBN: 2-84597-075-7
ISSN: 1633-597X
Dépôt légal : février 2003
O u v r a ge publié avec le concours
du Centre national du livre.

CONTReTeMPS
numéro six, février 2003
7 C H A NG E R L E MONDES A N S PRENDREL E P O U V O I R ?
N O U V E A U X L I B E R T A I R E S , N O U V E A U X C O M M U N I S T E S
8Philippe Corc u f f , Michaël Löwy Pour une Première Internationale
au X X I es i è c l e
11MOUVEMENTSSOCIAUX,LUTTESANTI-GLOBALISATIONETSOUFFLELIBERTAIRE
12Léon Crémieux Mouvement social, anti-mondialisation
et nouvelle Internationale
19P i e r r e Contesenne Nouveaux mouvements sociaux, luttes anti-
globalisation et perspectives d’une nouvelle Internationale
23Hélène Pernot Des thématiques marxistes,
un esprit libertaire – L’exemple de Sud-PTT
37L E C T U R E S D U N É O - Z A P A T I S M E
38John Holloway Douze thèses sur l’anti-pouvoir
45Daniel Bensaïd La Révolution sans prendre le pouvoir ?
À propos d’un récent livre de John Holloway
60Atilio Borón La montagne et la ville
72Jérôme Baschet Du guévarisme au refus du pouvoir d’État :
les zapatistes et le champ politique
87ANARCHISMESE T M A R X I S M E S
88Gaetano Manfredonia En partant du débat Marx, Proudhon,
B a k o u n i n e
101Philippe Corcuff De Rosa Luxemburg à la social-démocratie
l i b e r t a i r e
109Michaël Löwy Walter Benjamin, marxiste – libertaire
118Patrice Spadoni Daniel Guérin ou le projet d’une synthèse
entre l’anarchisme et le marxisme
127Mimmo D. P u c c i a r elli Entre les 100 % à gauche
et les anarchistes purs et durs, mon cœur balance
139RETOURSSURL ’ H I S T O I R E
140Marianne Debouzy Les
Industrial Workers of the World
,
marxistes et libertaires
153S y l v ain Pattieu L’internationalisme en rouge et noir :
trotskistes et libertaires dans la guerre d’Algérie
163RÉPLIQUESE T C O N T R E V E R S E S
164Willy Pelletier Les anarchistes et la reproduction de l’anarchisme
174Philippe Gottra u x , B e r n a r d Voutat Anarchisme et marxisme :
vrai contentieux et faux clivage
185L U D ’ A I L LE U R S
186Q u i n z e Thèses pour une Gauche européenne alternative Fausto Bertinotti
190D i v ersité de l’anarchisme contemporain à travers Internet Andrej Grubacic
192Karl Marx’s Theory of Revolution IV. Critique of others Socialisms Hal Draper
193Karl Marx and the Anarchists Paul Thomas
193Victor Serg e . The Course is Set on Hope Susan Weissman
195Mikhaïl Bako u n i n e . A Study in the Psychology and Politics
of Utopianism Aileen Kelly
CONTReTeMPSn u m é r o s i x 5
CONTRETEMPS
Directeur de publication:
Daniel Bensaïd
Comité de rédaction:
Gilbert Achcar; Christophe Aguiton; Antoine Artous; Daniel Bensaïd ; Sophie Béroud;
Sébastien Chauvin ; Karine Clément; Philippe Corcuff; Léon Crémieux; Jacques Fortin;
Janette Habel; Michel Husson; Samuel Johsua; Razmig Keucheyan ; Thierry Labica;
Ivan Lemaître; Claire Le Strat; Michaël Löwy ; Lilian Mathieu; Sylvain Pattieu; Willy Pelletier;
Marie Pontet; Catherine Samary; Patrick Simon; Francis Sitel; Josette Trat ; Enzo Traverso;
Emmanuel Valat.

CONTReTeMPSn u m é r o s i x 7
Changer le monde
sans pre n d r e le pouvo i r ?
N o u v eaux libertaire s ,
n o u v eaux communistes
Dossier rassemblé par
Philippe Corcuff et Michaël Löwy
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
1
/
100
100%