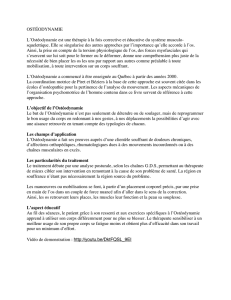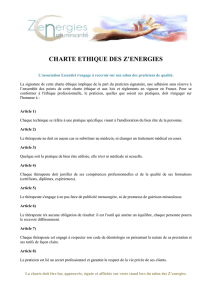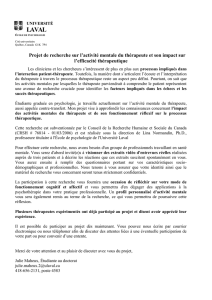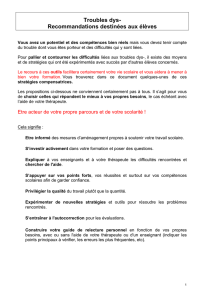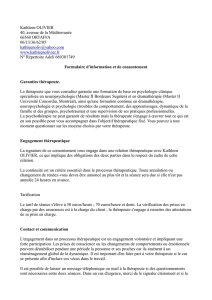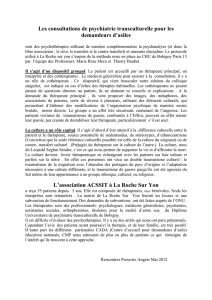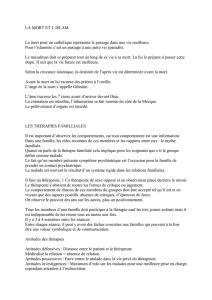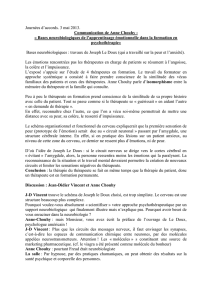L`être en relation thérapeutique en Analyse Transactionnelle

1
L’
ETRE EN RELATION THERAPEUTIQUE EN
A
NALYSE
T
RANSACTIONNELLE
:
L
A VERITE DE L
’
AMOUR OU L
’
AMOUR DE LA VERITE
William F.CORNELL et Frances BONDS-WHITE.
Traduction : Patrick Bailleau
Les années 90 ont vu s’opérer un glissement dans les théorisations cliniques au sein des approches
psychodynamiques orientées sur le Moi dont l’Analyse Transactionnelle. L’interprétation et l’insight
ne sont plus considérés comme les moyens premiers du changement thérapeutique. Des
thérapeutes de nombreuses et différentes orientations théoriques mettent dorénavant l’accent sur
les composantes relationnelles, transférentielles et contre-transférentielles du processus
thérapeutique. La littérature clinique est submergée par les modèles et le langage relationnel :
processus mutuel, empathie, accordage, attachement, holding, relations d’objet, connaissance
relationnelle implicite, intersubjectivité, réciprocité, synchronicité émotionnelle, connexion, moment
de rencontre et résonance. Ce « zeitgeist »
1
relationnel a été renforcé par la popularité des modèles
centrés sur la féminité tel que le modèle relationnel développé au Stone Center du Wellesley College
et les approches centrées sur le traumatisme qui tous les deux mettent l’accent sur le rôle relationnel
actif, maternant et correctif du thérapeute. Alors que ces approches maternantes/relationnelles ont
beaucoup fait pour corriger les styles unidirectionnels, paternalistes et autoritaires qui prévalaient
dans la psychanalyse classique et dans les orientations cognitives et comportementalistes, nous
voyons apparaître maintenant en Analyse Transactionnelle contemporaine des applications aveugles
de divers modèles relationnels qui pourtant, selon nous, mériteraient une critique sérieuse.
Dans «Analyse avec fin et analyse sans fin», un article clinique très approfondi écrit peu de temps
avant sa mort, Freud (1937/1964) se bagarrait toujours avec la nature du processus thérapeutique.
Pour lui, l’amour de la vérité – la volonté de reconnaître les réalités psychiques, de se regarder aussi
honnêtement que possible – était au coeur du processus thérapeutique. Nous considérons
également l’engagement en thérapie comme un engagement à une honnêteté absolue tant de la
part du client que du thérapeute. Il semble cependant que dans de nombreuses thérapies
contemporaines, le champ relationnel entre le thérapeute et le client soit passé de l’amour de la
vérité à la vérité de l’amour. Où l’expérience d’être l’objet de soins et d’être reflété dans un miroir
prenne le pas sur l’expérience d’affronter et de comprendre les réalités émotionnelles et celles
relatives aux traits de caractère. Nous avons personnellement tendance à penser que dans le long et
souvent difficile processus de la thérapie, c’est finalement l’amour de la vérité (une confrontation
avec celle-ci) qui est curatif.
Il y a toujours eu en Analyse Transactionnelle une tendance à mettre l’accent en psychothérapie sur
le changement personnel et la gestion des émotions plutôt que sur le combat pour une
compréhension plus profonde des ambivalences amour/haine qui sont le moteur de toutes relations
1
Air du temps

2
humaines. L’hypothèse centrale de cet article est que si l’Analyse Transactionnelle n’affronte pas et
n’aborde pas les aspects les plus noirs, les plus conflictuels du fonctionnement humain, nous serons
limités dans ce que nous offrons à nos clients, mais également sur le type de clients que nous
pourrons effectivement traiter.
Cet article examine donc les approches qui, en Analyse Transactionnelle, mettent l'accent sur
l’empathie, l'accordage et l'attachement comme outils premiers dans le répertoire thérapeutique. Il
part de l'hypothèse qu'une telle orientation peut susciter une forme subtile de reparentage, ce qui
représente une déviation considérable vis-à-vis de l'accent que mettait Berne sur la responsabilité
des personnes, le conflit intrapsychique, la manipulation interpersonnelle et la construction du
scénario de vie. Nous estimons que l'utilisation excessive des concepts relationnels dans l’Analyse
Transactionnelle contemporaine peut aboutir à une sur-simplification du processus thérapeutique, à
une emphase excessive mise sur l’activité du thérapeute et à une perte de l'idée que les conflits
intrapsychiques et interpersonnels sont les éléments fondamentaux de la psychothérapie.
L'
ETAT DU MOI
P
ARENT ET LE ROLE DU THERAPEUTE
Dès son origine, l'Analyse Transactionnelle a beaucoup insisté - que ce soit sous une forme ou une
autre - sur l'utilisation du Parent du thérapeute. La manière dont Berne le soulignait, que ce soit sous
l’angle structurel ou fonctionnel, représentait une correction importante de la position
psychanalytique classique de l'observateur neutre ainsi que des opérations mécaniques des modèles
comportementaux que Berne contestait de son vivant. Il y a depuis longtemps dans la théorie et les
techniques transactionnalistes une tendance contestable à projeter les "mauvais éléments" vers le
dehors, les attribuant à des défaillances parentales, du milieu et plus largement de la société. Cette
position projective a été incluse dans la théorie et le langage de l’Analyse Transactionnelle dès le
début et illustrée avec les notions berniennes de "père ogre" et de "mère sorcière" (1972), le terme
de "parent-flic" utilisé par Steiner (1974) et la totalité du modèle de reparentage (Schiff et autres,
1975, Schiff 1977). Bien trop souvent, le thérapeute en Analyse Transactionnelle se voit attribué le
rôle de fournisseur de « bonnes choses » plutôt que celui d’agent clarificateur de la manière dont le
client maintient des mécanismes de défense inefficaces, destructeurs de lui-même et d’autrui. Cette
dérive de la théorie de l’Analyse Transactionnelle génère logiquement une pression sur le thérapeute
pour qu'il adopte une position bon-parent/bon-objet vis-à-vis
2
du client. Lorsque nous aidons un
client à "expérimenter suffisamment", pour prendre à titre d’exemple une formule de parentage
souvent utilisée en Analyse Transactionnelle, fréquemment, tout ce que nous avons réalisé n’est
qu’une fusion temporaire, narcissique et mutuellement gratifiante. Lorsque nous enveloppons le
client dans un miroir empathique bien accordé, nous induisons l'idée que peu de chose est
réellement réparé et que rien n'est réellement changé dans sa structure psychique. En apaisant la
détresse - celle du client comme celle du thérapeute – nous ne faisons rien d'autre qu’éliminer ou
différer les combats nécessaires au changement de la structure de caractère et à la maîtrise
psychologique. D’une manière plus problématique, nous risquons d'encourager un fantasme
enfantin et maternel, nostalgique et idéalisé, clivé des difficultés de la vie courante, sans parler du
mauvais côté de la nature humaine.
2
En français dans le texte

3
En se détachant de la psychanalyse de son époque, Berne eut pour objectif une critique radicale de
l’analyse traditionnelle du psychisme humain, celle utilisant l'association libre, l'interprétation des
rêves et d'autres techniques classiques. Il créa clairement une analyse transactionnelle et non pas
une psychothérapie relationnelle. Il ne suggéra nulle part dans ses écrits que c’est l’internalisation de
la relation thérapeutique qui guérit le client. La tâche du thérapeute analyste transactionnel est
plutôt de faciliter la réflexion du client sur les façons, les raisons et les croyances relatives à son style
de relation aux autres afin qu’il puisse faire le choix d’en changer. Le thérapeute est un observateur
prudent et honnête des structures relationnelles et des croyances qui y sont attachées. Chez Berne, il
est possible de le constater dans sa conceptualisation des jeux, des rackets et des scénarios. Il
observait, écoutait, réfléchissait, décrivait, interprétait, analysait et dérangeait la manière dont les
gens étaient en relation les uns avec les autres.
Berne défendait, en définitive, une thérapie unipersonnelle dans laquelle ces interactions étaient
analysées à la lumière des bénéfices sociaux et psychologiques que la personne pensait pouvoir en
retirer. Il a ainsi offert l’occasion de voir et de réfléchir à la manière dont la personne pense, se
comporte et de la changer. L'Analyse Transactionnelle de Berne vise à déstabiliser un cadre de
référence familier et défensif par la description, la confrontation, l'interprétation et l'humour. Il
semble tout à fait évident que son intention, en cela cohérente avec la vision psychanalytique
classique, était de modifier la structure et le fonctionnement intrapsychiques du client par des
interventions clarifiantes et non pas en fournissant une relation corrective.
« L'introspection […] retire le couvercle de la boîte noire et permet à l'Adulte de la personne de jeter
un œil dans son propre esprit pour voir comment il fonctionne : comment il assemble les phrases, d'où
viennent ses images et quelles voix gouvernent son comportement. » (Berne, 1972 p. 273)
C’est ainsi que, pour Berne, le traitement de groupe n’était pas un environnement contenant et
empathique, mais une matrice d’étude interpersonnelle. Dans Principes de traitement de groupe, il
passe en revue huit opérations thérapeutiques qui « constituent la technique de l’Analyse
Transactionnelle » (Berne, 1966 p.233). Ce sont : l’interrogation, la spécification, la confrontation,
l’explication, l’illustration (humour et comparaison), la confirmation, l’interprétation et la
cristallisation (pp.233-247). Ces opérations thérapeutiques sont soigneusement décrites, illustrées et
éclairées avec des recommandations sur quand et comment s'en servir ou pas. Remarquez que
l’empathie, le « holding » et l’attachement ne sont pas sur cette liste. Les interventions
thérapeutiques de Berne sont plutôt destinées à favoriser l'observation de soi et la curiosité, à
décontaminer et à stabiliser le fonctionnement de l'état du moi Adulte.
Berne (1966) y décrit ensuite "d'autres types d'interventions" (pp.248-249) pour lesquelles "le
thérapeute peut être amené à se conduire de manière délibérée en tant que Parent plutôt qu'en
Adulte pour une période plus ou moins longue, qui peut aller jusqu'à quelques années" (p.248). Ces
interventions parentales sont : soutien, réassurance, persuasion et exhortation ; lesquelles, suggère-
t-il, sont plus appropriées et nécessaires au traitement d'une schizophrénie avérée.
Malheureusement, il y a ici quelque chose de vague et de confus dans la manière dont Berne utilise
les mots, une confusion répétée à l’envi dans ses écrits et dans la pratique de l'Analyse
Transactionnelle. Le fait d'écrire Parent et Adulte avec des majuscules dans ce paragraphe laisse à
penser qu'il décrit le passage du thérapeute d'un état du moi Adulte possédant le pouvoir exécutif à
un état du moi Parent investi de celui-ci. Je doute que Berne ait eu l'intention de pousser le
thérapeute à devenir une figure parentale ; mais, de fait, ceci est devenu courant dans la pratique de
l’Analyse Transactionnelle.

4
Le thérapeute analyste transactionnel utilise quelquefois explicitement l'état du moi Parent, comme
cela apparaît clairement dans sa description de fonctions parentales comme la permission, la
protection et la puissance (Bern, 1972):
« Nous pouvons maintenant parler avec une certaine assurance des "3P" en thérapie qui déterminent
l'efficacité du thérapeute : la puissance, la permission et la protection. Il doit donner à l'Enfant la
permission de désobéir aux injonctions et provocations du Parent. Pour pouvoir faire cela
efficacement, il doit être et se sentir puissant - pas tout-puissant - mais suffisamment puissant pour
traiter avec le Parent du patient. Il doit ensuite se sentir suffisamment puissant - et l'Enfant du client
doit le sentir suffisamment puissant - pour offrir de la protection face à la colère du Parent.
Ici les transactions sont : 1. Accrocher l'Adulte, ou attendre qu'il soit branché. 2. Faire alliance avec
l'Adulte. 3. Nommer votre plan et voir si l'Adulte l'approuve. 4. Si tout est clair, donner à l'Enfant la
permission de désobéir au Parent. Ceci doit être fait clairement et en termes explicitement impératifs,
sans "si", "et" ou "mais". 5. Offrir à l'Enfant la protection par rapport aux conséquences. 6. Renforcer
cela en disant à l'Adulte que ceci est juste. » (pp.374-375))
Berne s'occupe clairement de l'identification et de la gestion du conflit intrapsychique. L’utilisation
de l’état du moi Adulte par le thérapeute est décrite comme ayant pour objectif de renforcer le
fonctionnement de l’Adulte du client lors de son conflit avec l’état du moi Enfant. Il ne propose pas
d’expérience parentale empathique et corrective.
Tout se passe comme s'il disait au client : "Je suis assez solide pour faire face aux forces psychiques
qui se manifestent à l'intérieur de toi et travailler hors de leur portée. Tu peux constater qu'il est
possible de supporter le conflit interne qui accompagne le changement. Tu peux faire tes propres
choix." Berne modélise la possibilité de contenir, fournissant moins un milieu contenant qu’un milieu
facilitateur, pour se servir des termes de Bion et Winnicott. Il donne un modèle de contestation,
d'alignement sur l'Adulte et d’interventions à des moments soigneusement choisis pour permettre
au client de penser et sentir en toute autonomie. Il ne verrouille pas le domaine du "comme si" du
processus thérapeutique en devenant une figure parentale. Il s'appuie sur la force des attitudes
parentales de permission, protection et puissance pour susciter un espace psychologique dans lequel
le client a l’occasion de développer un fonctionnement autonome.
R
ECHERCHE MERE
/
NOURRISSON
:
IMPLICATIONS CLINIQUES
.
Même si nous apprécions Berne et sa démarche thérapeutique, nous ne voulons pas passer sous
silence ses limites. Il est clair que la reconnaissance d’un insight cognitif, l’interprétation, l'analyse
des transactions, les schémas au tableau et les observations fines ne sont pas toujours suffisants
pour atteindre ces couches les plus profondes du psychisme qui parfois craignent et s’opposent à la
prise de conscience psychologique et au changement. L’Analyse Transactionnelle et d'autres
approches psychodynamiques ont commencé à regarder du côté de la recherche relative au
développement précoce de l'être humain afin d’approfondir la compréhension des troubles
préœdipiens. Une des forces des approches mettant l'accent sur l'empathie et l'attachement est en
fait l'attention portée aux expériences formatrices de l'époque préverbale puisque les difficultés
rencontrées dans les premiers mois de la vie peuvent être à l'origine de décisions scénariques
ultérieures.
Berne avait peu de notions concernant la relation préverbale mère/nourrisson. Dans Que dites-vous
après avoir dit Bonjour ? (1972), ce qu'il dit des influences sur le développement du scénario de
l'époque prénatale et de la période de la petite enfance est un tout petit peu plus qu’une liste

5
astucieuse de "titres à propos de l'allaitement" et de "scènes de salle de bain". Il semble n'avoir
accordé que peu ou pas d'importance aux observations de Winnicott sur les relations mère-
nourrisson (1958d, 1965) bien que celles-ci fussent publiées à l'époque même où il écrivait.
La recherche mère/nourrisson effectuée depuis la mort de Berne - comprenant, entre autres, Mahler
(1975), D.N. Stern (1985), Tronick (1999), Lachmann et Beebe (1996), Emde (1988), Ainsworth (1969)
et Main (1995) entre autres… - a grandement enrichi notre compréhension des éléments somatiques
et relationnels du scénario. Cette recherche a montré combien complexe était le développement du
psychisme infantile avec l'intégration progressive et constante du fonctionnement limbique, sensori-
moteur et cognitif (Bucci, 1997; Downing, 1995, Lichtenberg, 1989). Les dernières années ont aussi
vu l'application progressive à la psychothérapie adulte de la recherche sur les nourrissons. Ces
hypothèses cliniques sont importantes. Il est cependant tout aussi important de comprendre que la
relation thérapeutique adulte n'est pas un reflet ou une réédition de la relation mère-nourrisson. Il
est incontestable qu'avec beaucoup de clients, des aspects du vécu relationnel mère-nourrisson vont
apparaître dans le processus thérapeutique ; mais il en sera de même avec de nombreux autres
aspects et plusieurs autres époques du développement psychique. Green (2000) a écrit une critique
incontournable des applications cliniques des recherches sur les relations mère-nourrisson et
proposé un rappel puissant sur la complexité des forces en jeu lors de la psychothérapie d’un adulte.
Un volume entier de l’Infant Mental Health Journal (Tronick, 1998b) a été consacré à une série
d'articles produits par le Change Process Study Group de Boston traitant de l'application de la
recherche sur les nourrissons à la psychothérapie des adultes. Ces premières tentatives sont
intéressantes, fascinantes mais ont pas mal de défauts. Dans cette revue, discutant d'un point de vue
critique les articles, Modell (1998) met en garde contre :
« L'analogie entre les dyades nourrisson et les dyades adultes [qui] ne tient pas sur plusieurs points.
Premièrement la dyade thérapeutique adulte, contrairement à la dyade mère-nourrisson, n'est pas un
processus défini biologiquement ; deuxièmement, les deux participants d'une dyade thérapeutique
adulte sont chargés du poids de leurs souvenirs affectifs du passé ; alors que dans la dyade mère-
nourrisson, le passé du nourrisson ne fait que commencer. Le changement thérapeutique chez l'adulte
comporte une réécriture de la mémoire affective. Il existe, en particulier dans les cas de traumatismes,
une clause implicite – transcender et modifier le passé – qui n'est pas à l’ordre du jour chez le
nourrisson. » (pp. 342-343).
Une trop grande importance accordée à la relation mère-nourrisson en tant que modèle pour la
psychothérapie introduit de force la régression dans la relation thérapeutique et dévalorise
l’expérience vécue de l’adulte. L’attention portée à l’accordage, la réponse en miroir ou la régulation
mutuelle qui sont issus de l'accent mis sur la relation mère-nourrisson sont un des aspects du
développement psychique ; mais le nourrisson et le jeune enfant ont aussi des capacités motrices,
des compétences cognitives, de compréhension de soi et d'individuation.
Lichtenberg (1983, 1989 ; Lichtenberg, Lachmann et Fosshage, 1992) a présenté une application
détaillée de la recherche sur les nourrissons relative aux forces de développement actives durant
toute l'existence humaine et lors de la psychothérapie des adultes. Dans une théorie de la motivation
qui ressemble remarquablement au concept de Berne sur les « faims » humaines, Lichtenberg (1989)
décrit cinq systèmes de motivation présents à la naissance et opérationnels tout au long de la vie. Ce
sont:
1. La régulation psychique des besoins physiologiques
2. Le système attachement-appartenance
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%