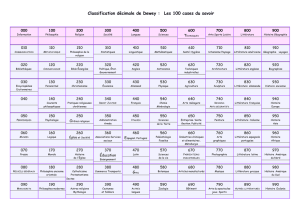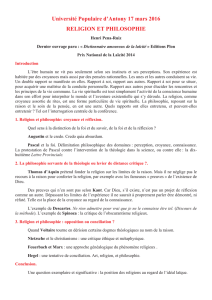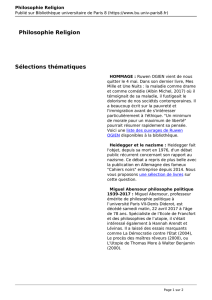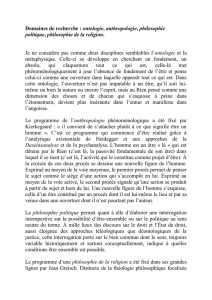DÉCLIN DE LA PHILOSOPHIE Comme institution de la culture, la

DÉCLIN DE LA PHILOSOPHIE
Comme institution de la culture, la philosophie, depuis un siècle au moins,
connait un déclin assez comparable à celui du christianisme. Les facultés
de philosophie, comme celles de théologie d'ailleurs, n'attirent plus à
l'Université qu’un nombre restreint d'étudiants. Il apparait avec évidence
que la philosophie ne peut plus maintenant être pratiquée comme un
métier ou une profession. Il n'y a plus une philosophie, mais des
philosophies multiples, qui ne se rejoignent pas toujours, qui toutes ne
communiquent pas entre elles et qui se rattachent souvent à une science
ou à un groupe de sciences particulières. Dans ce cas, on pourrait dire
qu'elles relèvent de la science elle-même, dont elles sont un
prolongement.
Ce phénomène est comparable à celui qui affecte la religion. La « mort de
Dieu », qui n'est évidemment pas acceptée par tous, n'a pas fait
disparaitre les Églises, mais elle les a fait décliner comme institutions.
Parallèlement, « la » philosophie a éclaté comme système, comme grand
discours permettant de tout comprendre, d'assigner à chaque être et à
chaque évènement sa place dans la totalité. Mais il ressurgit ici et là des
petits discours philosophiques, ponctuels, fragmentaires, lacunaires, à
prétentions limitées. Le sens de l'entreprise philosophique a donc changé
substantiellement, et l'homme ou la femme qui s'adressent de nos jours
à la philosophie pour trouver un substitut à ce que les grandes religions
offraient jadis, est sûr d'être déçu.
La philosophie est devenue incapable par elle-même de transformer la
vie. Il faut qu'elle passe pour cela par la politique. Mais dans ce domaine,
les effets sont lents à venir, et parfois ils sont désastreux. Contrairement
à la religion, qui est capable de donner de la profondeur et du sens au
quotidien en l'enveloppant dans un vêtement de mystère, en l'insérant
dans un cadre mythique, en le poétisant par sa mythologie ou son histoire
ancienne, en promettant des expériences vécues, parfois étranges et
merveilleuses (on les dit « mystiques »), la philosophie, elle, enseigne à
douter et à critiquer tout ce qui se fait. Elle a même plutôt tendance à
retirer les individus du présent, de l'action, et cela a pour effet parfois
d'appauvrir leur esprit plutôt que de l'enrichir. Chose certaine, elle brise
le charme qui enveloppe la science et la technique, tout comme elle brise
le charme propre aux mythes et aux discours religieux ; elle désenchante

le monde et refroidit tous les enthousiasmes, ce qui néanmoins a des
effets bénéfiques.
Un discours philosophique est encore possible de nos jours, mais il ne faut
pas vouloir que ce soit celui d'une pure raison énonçant de pures vérités,
car une pure raison ne parle pas. Il faut des personnes pour parler. La
parole – et celle de la philosophie n'est pas en cela différente de celle de
la vie quotidienne – jaillit de problèmes qui surgissent, où se manifestent
des sentiments, des croyances, des intérêts, des engagements, qui
infléchissent, déforment même la pensée de celui qui parle, même
lorsqu'il fait tout ce qu'il peut pour atteindre la plus pure vérité. C'est
pourquoi ce discours appelle le dialogue. Son but n'est pas tant d'attraper
le vrai que d’ouvrir vers lui un accès, il est de garder l'esprit vivant, de le
maintenir en éveil, de lui faire surmonter les obstacles qu'il rencontre sur
sa route, de le déprendre des mirages ou des illusions que fabriquent nos
passions, nos partis pris, nos préjugés.
La philosophie aujourd’hui ne consiste plus à surmonter le monde au
moyen d'un système de pensées, mais plutôt à l'affronter et à rechercher
le moyen d'en libérer son esprit. Elle est un défi qui se pose de multiples
façons et qui vise pour l'intelligence humaine, à garder le ciel dégagé au-
dessus de notre âme, à maintenir vivantes et actives nos puissances
d'aimer, d'admirer, de créer, et même de croire, car il est évident que si
la philosophie enseigne à douter, ce n'est pas pour aboutir au scepticisme
et au nihilisme qui paralysent l'esprit. Elle vise plutôt à nous orienter vers
une foi ou des croyances lucides, conscientes d'elles-mêmes et de leurs
limites.
Dans un pareil contexte, le christianisme a cessé d'être l'ennemi, comme
il le fut à une certaine époque, quand il a fallu que l'Église laisse entrer
dans la culture les sciences expérimentales et la démocratie. Face aux
assauts que ces sciences, la technique et les grands appareils
bureaucratiques ne cessent de porter contre ce qu'il y a encore d'humain
dans les hommes et les femmes, la religion serait plutôt l'amie ou l'alliée.
Religion et philosophie ne se confondent pas cependant. Le discours de la
foi – car la foi a besoin d'un discours – n'est pas justifiable parfaitement
par la raison. Les rapports de la raison et de la foi devraient être pensés
sur le mode de la complémentarité, ce qui signifie à peu près : autonomie
entière pour chacune, mais échange, dialogue, jeu entre elles, un jeu dans
lequel chacune trouve son profit.

Ici il n'est peut-être pas inutile de rappeler que, comme dans le cas de
n'importe quel couple de complémentaires, si l'un des deux nie à l'autre
son droit à l'existence, il se condamne par le fait même à se transformer
en cet autre, ce qui ne va pas sans monstruosité. On sait assez à quoi
ressemble une religion qui nie à la philosophie ses droits : elle devient elle-
même une philosophie dérisoire et délirante. Mais une philosophie qui
nie à la religion ses droits se change elle-même en un système de dogmes,
de vérités tenues pour intangibles, autrement dit en une pseudo religion
rigide et étroite. En fonction de cette même loi, certains scientifiques, à
qui il arrive encore de nier à la religion et à la philosophie leurs droits
respectifs, transforment le savoir scientifique en une sorte de super savoir
ou de religion philosophique. Plus précisément, ils proposent un
« humanisme » qui vise à remplacer les deux adversaires qu'ils ont
disqualifiés injustement. Mais regardons de plus près ce phénomène.
Comme la science est faite par des humains et des humains seulement, il
apparait tout naturel aux scientifiques qu'elle doit être faite pour les
humains. Rien n'est plus constant en effet que ces déclarations
humanistes ou humanitaristes chez les scientifiques. Cependant, que
signifie l'être humain dans ce contexte ? Une espèce naturelle capable de
faire de la science, capable d'explorer le monde avec des représentations
mentales et des outils de plus en plus sophistiqués, de plus en plus
puissants. Cet humain, tout en étant tourné vers le monde, centré sur le
monde, est néanmoins coupé de lui, coupé de la nature, et la distance
entre lui et elle augmente toujours. En conséquence, il n'y a plus qu'une
norme morale qui puisse servir à cet homme « scientifique » : son
bienêtre. Bienêtre matériel ou physique, mais aussi mental, intellectuel et
spirituel. D'où l'hédonisme, qui est sans conteste la morale du monde
actuel. Son principe s'énoncerait ainsi : ce qui contribue au bienêtre des
personnes est bon, et ce qui n'y contribue pas est mauvais.
Or ce bienêtre semble fuir devant nous, dans la mesure exacte où nous
faisons effort pour l'atteindre. Il ressemble à la carotte pendue au bout
d'un bâton attaché au dos de l'âne qui court après elle. Aussitôt qu'avec
un outil technique nouveau nous réussissons à produire un bienfait
certain, nous découvrons ensuite qu'il a des effets imprévus, ou que le
changement intervenu dans le milieu crée des malaises ailleurs, qu'il faut
maintenant essayer de combattre. Nous sommes ainsi constamment jetés
hors de nous-mêmes, à la recherche d'une satisfaction qui nous fuit ou

nous déçoit plus rapidement que prévu. De plus, le mouvement de la
science est tel que cet individu est constamment jeté vers l'avenir. Le
passé ne signifie plus grand-chose pour lui : il est ce dont il s'arrache, ce
qu'il fuit. Cet individu est d'ailleurs incapable de comprendre les hommes
du passé, vivant non seulement dans des conditions de vie tout autres,
mais se concevant eux-mêmes et concevant le monde d'une façon tout
autre.
L'humanisme scientifique est hédoniste et optimiste. Optimiste au sens
où il tient toujours l'homme pour innocent, quoi qu'il fasse. La notion de
faute, de péché, de culpabilité n'a plus guère de signification. Celle
d'erreur l'a remplacée, ou encore celle de maladie. Quoi qu'il arrive, si
quelque chose ne marche pas comme cela était prévu, soit il y a une
erreur à déceler et à corriger, soit il y a un malade à soigner ou à éliminer.
C'est le cas par exemple de ces grands malades que sont les terroristes.
L'existence s’en trouve ainsi simplifiée.
La science est tout autant pouvoir que savoir : elle n'est d'ailleurs savoir
que dans la mesure où elle est pouvoir, et c'est pourquoi le mal l'appelle
et la fascine. Pour le faire disparaitre, elle est prête à liguer tous les
hommes et femmes de bonne volonté. L'humanité est bonne, pense-t-
elle, et si la nature est méchante pour nous parfois, c'est parce que nous
ne la comprenons pas encore, mais cela viendra. En attendant, il faut faire
tout ce que nous pouvons. D'un point de vue scientifique, le seul devoir
qui existe consiste à tout faire ce qu'on peut pour détruire tout ce qui ne
peut pas se justifier rationnellement. De même que le pouvoir délimite le
savoir, c'est lui aussi qui détermine le devoir. Tout ce que l'on peut faire
doit être fait. Et cela dans la perspective du bienêtre humain, sinon
immédiat, du moins futur.
La culpabilité ne se laisse donc pas éliminer aussi facilement qu'il apparait
à première vue, quand on la tient pour une invention saugrenue de la
pensée religieuse, laquelle, pour un esprit positif, est une pensée
enfantine ou même infantile. De fait, si le chrétien vit en essayant de « se
sauver », c'est-à-dire, en pratique, en s'efforçant d'échapper au péché et
à la culpabilité, l'homme actuel, quant à lui, vit pour se justifier et pour
s'acquitter de sa responsabilité envers l'humanité. Ayant le pouvoir d'agir,
il doit agir et procurer aux humains le bienêtre. La recherche du bienêtre
par la science a un caractère moral, mais non métaphysique. Le monde
est pour elle un lieu d'action, il n'est pas qu'un lieu de jeu et de plaisirs,

d'épreuves et de larmes. Une telle conception de la vie n'est pas «
rationnelle ». Le bienêtre que la science se fait fort de procurer aux
habitants de la planète en est un qui devrait leur permettre de vivre
rationnellement, pour ne pas dire scientifiquement. Elle ne peut pas
libérer les personnes pour autre chose que la science elle-même. Entre la
science et l'humanité se noue ainsi une relation circulaire : l'une est au
service de l'autre pour que celle-ci soit au service de celle-là. Autant dire
que la connaissance est la finalité de l’existence.
La première conséquence de cette conception est la recherche de
l'universalité. La science en effet ne peut appuyer sa propre universalité
que sur celle du sujet qui la porte. Ce qui signifie que, sans recourir à Dieu,
elle posera que tous les humains sont égaux, parce qu'elle-même est
valable également pour eux tous. Cependant de l'égalité de tous les êtres
humains à la solidarité concrète avec certains d'entre eux, il y a un pas à
franchir. Or la science le franchit et le franchira toujours, car elle devra
toujours se justifier, notamment devant le pouvoir politique avec lequel
elle est associée étroitement désormais, aussi étroitement que la religion
l’était autrefois. Elle le fera toujours en disant qu'elle est au service de
l'humanité. Certes, certains savants peuvent se mettre au service d'une
armée, d'un tyran, d'un criminel, mais la connaissance scientifique, même
trouvée dans des conditions comme celles-là, finira toujours par servir au
bien de l'humanité. Cette « bonté » de la connaissance elle-même, tout
comme la bonté de l'être humain, est un dogme fondamental de
l'humanisme scientiste actuel.
Cet humanisme est de plus « positiviste », en ce sens que le monde a
acquis pour lui une densité, une solidité, une valeur en soi et pour soi
devant lesquelles il s'incline. Dieu dans ce contexte n'est plus
l'indéchiffrable et l'inéluctable réalité transcendante qu'il était, une
réalité plus importante que toutes les autres, puisque toutes les autres
étaient perçues comme se rapportant à elle. Dieu est devenu une idée,
une simple idée, et il n'y a rien dont on se passe plus aisément que d'une
idée.
Toutefois, notre monde n'est pas encore devenu totalement profane.
Bien au contraire, il s'est en grande partie sacralisé. Mais c'est un sacré
païen, non chrétien. Il serait sans doute plus juste de dire qu'il est devenu
« séculier », c'est-à-dire qu'il fait l'objet d'une appréhension non informée
par les mythes ou les dogmes religieux. La science ne connait pas le sacré,
 6
6
 7
7
1
/
7
100%