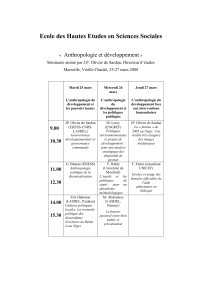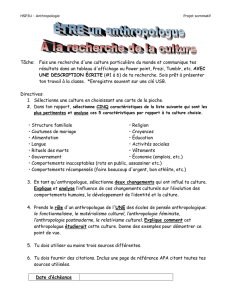Atelier 2bis - Les Journées de Tam Dao

Méthodes, concepts et chantiers en socio-anthropologie
du changement social
Olivier de Sardan Jean-Pierre (retranscription)
Journée 2, mardi 17 juillet
Hier, il a été beaucoup question de sciences exactes, de
sciences non sociales, de sciences de la nature. Beaucoup
d’exemples renvoyaient à ces sciences. Aujourd’hui, il sera
uniquement question des sciences sociales en général et
de l’anthropologie en particulier. Pour faire le lien avec hier,
je partirai d’un petit problème épistémologique : quel est le
régime épistémologique des sciences sociales ?
Je m’appuie sur le principal ouvrage de référence
en français sur l’épistémologie des sciences sociales,
celui de Jean Claude Passeron, « Le raisonnement
sociologique » :
•toutes les sciences sociales relèvent du même
régime épistémologique. L’histoire, la sociologie,
l’anthropologie, la géographie humaine, la science
politique et l’économie même, ont le même type de
rapport avec les réalités sociales. Ce rapport à leur
objet est assez différent que celui que les sciences de
la natureentretiennent avec la nature. Dans les
sciences sociales, il n’y a pas d’expérimentation
possible, ou quasiment pas. Elles ne peuvent
prétendre émettre des lois, il s’agit de pseudo-lois ;
les énoncés des sciences sociales n’échappent
jamais à des indexations dans le temps et dans
l’espace. Elles expriment fondamentalement leurs
énoncés dans leur langage naturel, dans le langage
commun, dans le langage de tout le monde. Il n’y a
pas de rupture entre langage savant et langage
commun ;
• il y a une autre caractéristique que je tire du sociologue
anglais Anthony Giddens1,lequel parle d’une « double
herméneutique ». Nous produisons du sens à propos
de gens qui produisent eux-mêmes du sens sur leur
propre vie. C’est sur ces significations que nous con-
struisons des significations plus complexes, ce sont
celles du chercheur. Tout ceci est commun aux scien-
ces sociales, mêmes celles qui utilisent des procédures
àdes moments très formalisées, mêmes très quantita-
tivistes, en amont et en aval d’un langage commun.
Même l’économie mathématique ou la linguistique qui
utilisent un langage très formalisé sont obligés
d’exprimer les interprétations dans le langage commun.
Ces sciences sociales se distinguent des sciences de la
nature sur une question fondamentale : leur rapport avec
la réalité qu’elles veulent décrire est fondamentalement un
rapport de plausibilité. Elles profèrent des énoncés sur
l’état du monde qui se veulent le plus plausible possible.
Elles ne sont pas du registre de la falsifiabilité (au sens de
Popper), ni du registre de la causalité (on ne peut pas dire
en sciences sociales, si A donc B). Tout l’appareil
argumentatif des sciences sociales est destiné à exposer
le plus possible la plausibilité des énoncés, avec des
arguments qualitatifs ou quantitatifs.
Acause de ces caractéristiques, pour certains
épistémologues, les sciences sociales ne sont pas de
véritables sciences (Popper notamment). Mais Passeron,
d’autres chercheurs, moi-même, n’avons pas cette
position. Même si nous ne sommes pas dans le même
registre de scientificité que les sciences naturelles, nous
essayons de proférer des énoncés aussi véridiques que
possible sur le monde. Cet objectif et cette rigueur sont le
propremême du projet scientifique par rapport aux projets
artistiques, sportifs, poétiques ou autres. Nous ne
pouvons jamais direque ce que nous énonçons du
monde est vrai et garanti. Mais nous cherchons à être
dans le véridique, en cherchant le maximum de garantie
possible et en l’exprimant avec le maximum de
cohérence. Dans cet ensemble des sciences sociales,
même si on peut discuter des propositions, elles sont tout
de même celles qui servent de bases à la grande majorité
des chercheurs en sciences sociales.
Mais s’il y a un même registre épistémologique, pourquoi
ya-t-il des différences entre les sciences sociales ?
Ces différences ne proviennent pas du fait que ces
sciences auraient un rapport interprétatif différent au
monde. Vous voyez que les grandes théories, les grands
paradigmes, ont traversé toutes les disciplines
(le marxisme, le structuralisme, l’analyse systémique par
exemple). Ce qui fait qu’un chercheur doit être un peu
pluridisciplinaire dans l’esprit. Même si on est un
anthropologue, c’est peut-être dans le travail d’un
historien ou d’un politologue que l’on va trouver des
éléments intéressants pour son propre travail de
1http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens

196 Les Journées de Tam Dao 2007
recherche. Alors pourquoi y a-t-il ces frontières discipli-
naires ? Je pense que c’est pour des raisons métho-
dologiques, institutionnelles et culturelles :
• les raisons méthodologiques sont les plus intéres-
santes. Il y a une certaine forme de dominance métho-
dologique plus ou moins attachée à chaque discipline :
l’histoire avec les archives, la sociologie avec le
questionnaire, l’anthropologie avec l’enquête de terrain.
Mais ce sont des tendances, il existe des croisements ;
• il y a des différences institutionnelles liées à la consti-
tution des disciplines et à leur organisation profes-
sionnelle : l’histoire est enseignée à l’école contrai-
rement à la sociologie et à l’anthropologie ; nous som-
mes obligés d’accepter la réalité de différents instituts
(anthropologie, histoire, etc.) même si cela ne fait pas
beaucoup de sens ;
• il y a enfin des différénces culturelles : au cours de notre
formation puis au-delà, nous lisons et nous constituons
une bibliothèque mentale différente de celle des autres,
cette bibliothèque est même différente physiquement.
Quelles sont les références érudites que l’on a des
disciplines voisines ? En France par exemple, les
sociologues ou les historiens ont Lévi-Strauss pour
référence en anthropologie, or ce n’est pas la référence
la plus importante pour les anthropologues. Les anthro-
pologues ou les historiens ont Bourdieu pour référence
en sociologie ;oril n’est pas le plus important pour les
sociologues. D’où la difficulté de trouver,hors de sa
discipline, les références pertinentes qui ne sont pas
connues ou qui ne sont pas à la mode.
Nous allons maintenant parler de l’anthropologie dans
son lien avec sa spécificité disons méthodologique,
l’enquête de terrain.
Le problème de l’anthropologie est qu’elle est la plus
qualitative des sciences sociales. Même si elle utilise les
procédures quantitatives, elle le fait moins que les autres
sciences sociales. De plus, elle produit ses matériaux à
travers la personne et la subjectivité de l’anthropologue
même.
Expliquons ce problème de scientificité : toute discipline
intègre une part de subjectivité, même dans les sciences
dures (rapports interpersonnels, rapport de pouvoir qui
peuvent guider les découvertes ou les activités scien-
tifiques, même en physique nucléaire). Dans les sciences
sociales, outre cette subjectivité qui est la même que
celle dans les laboratoires scientifiques, il y a des facteurs
subjectifs supplémentaires liés au registre épisté-
mologique (langage commun, travail sur un matériau
historique). Dans l’enquête anthropologique, il y a cette
même double subjectivité. Et dans l’enquête elle-même,
l’enquête passe par la personne qui ajoute encore à la
subjectivité. Tous ces éléments de subjectivité ne veulent
pas dire que l’on ne cherche pas à travailler le plus
possible dans un registre d’objectivité, au sens de la
recherche de plausibilité, ou d’une recherche de rigueur.
Comment se fait la production anthropologique à partir
de ce problème de rigueur ?
Agauche, on trouve la réalité sociale extérieure à nous.
Points abordés :
La rigueur du qualitatif et les contraintes empiriques de
l’interprétation en socio-anthropologie
1. L’approximative rigueur de l’anthropologie : la recher-
che de la plausibilité
2. Anthropologie et sciences sociales : unité épistémo-
logique et spécificités disciplinaires
3. Pourquoi parler de « socio-anthropologie » ?
4. La rupture avec l’exotisme et le passéisme : une
anthropologie non culturaliste
5. La légitimité de l’enquête de terrain : adéquation
« émique » et adéquation descriptive
6. Le « métier » de l’anthropologue et les risques de
surinterprétation
7. Le pacte ethnographique

197
Socio-anthropologie du changement social
Sur cette réalité, nous produisons différents types de
données (entretiens, observations, recension, sources
écrites, études de cas). Avec ces données, nous
produisons une œuvre scientifique (thèse, article, livre).
Nous « produisons » des données et non pas les
« récoltons » comme on disait il y a 50 ans. Avant, nous
étions dans une vision très positiviste de la recherche ;
on pensait que les données étaient le reflet de la réalité.
Aujourd’hui, on reconnaît que le travail est une
construction sociale qui fait intervenir plusieurs acteurs.
Si c’est une construction sociale, cela ne signifie pas que
c’est une construction sociale arbitraire. Cette
construction vise un rapport de plausibilité entre cette
construction et la réalité sociale. Un romancier peut, de
même, produire une construction sociale. Mais il n’est
pas intéressé par ce lien de plausibilité. Dans les
sciences sociales, nous sommes tenus à deux niveaux
de vigilance : entre nos données et le produit final. Cette
vigilance argumentative ou logique nous évite de dire une
chose et son contraire et nous permet d’approcher le
champ de la plausibilité argumentative ou interprétative.
Mais il faut aussi une vigilance et une plausibilité
empiriques, il est nécessairede définir un certain type de
liens entrela réalité et les données que nous produisons.
Pour produiredes données, nous partons de références
théoriques ou d’une culturescientifique qui nous est
propre. Nous les produisons en espérant apporter
quelque chose de nouveau par rapport au point de
départ. Cette culturescientifique intervient aussi dans
l’interprétation et l’organisation des données. Ce ne sont
pas les mêmes critères pour les interprétations qui nous
servent à produire des données et celles qui nous
servent à les organiser ou à les interpréter. Il y a une plus
forte exigence de cohérence sur les « interprétations
compréhensives ». Les « interprétations exploratoires »
sont plus ouvertes, plus variées, plus riches. Les
interprétations qui servent à produire des données font
appel à une productivité empirique. Pour les autres, on
parle de productivité de cohérence.
Faisons une pause pour passer à une discussion. On
peut discuter si vous le voulez sur le régime épisté-
mologique et sur les deux tableaux présentés.
Christian Culas
Tu as parlé de plausibilité et de rigueur. Pourrais-tu
donner un exemple précis, une situation précise ?
C’est le problème de l’épistémologie pratique. Il s’agit de
voir, dans un domaine où l’on ne peut pas produire de lois,
de vérité incontestable, où l’on est dans les approxi-
mations, les ordres de grandeur, dans des interprétations
prudentes, des explications justifiées, comment nous
essayons de garder un souci de représentation aussi fidèle
que possible du réel. On a souvent critiqué les sciences
sociales et l’anthropologie à cause de ces biais
interprétatifs permanents, ou en raison des pressions
idéologiques permanentes (poids des stéréotypes ou des
idéologies extérieures) : « Ce que vous dites, c’est du
bavardage, ou vos propres clichés, votre propre
interprétation, mais on peut tout à fait dire le contraire ».
Trinh Van Tung
Je propose la phrase de Passeron :« Les sciences
sociales cherchent à montrer, pas à démontrer ».
On peut dire aussi que nous décrivons le monde. Si nous
changeons de lunettes, nous décrivons un monde
différent. Face à cette objection, il y a deux positions :
• soit on est d’accord pour dire que ce n’est jamais
qu’une série de points de vue subjectifs, qu’il n’y a
pas de véritable connaissance en sciences sociales
sérieuses possibles. C’est la position de l’anthropo-
logie postmoderne, ou encore de « l’anarchisme
épistémologique »;
• etil y a la position majoritaire, celle que je défends,
qui consiste à direque même si nous sommes
toujours dans le registre de l’approximatif, même si
nous avons toujours des lunettes pour voir la réalité,
nous essayons de limiter les déformations inévitables
de cette réalité.
L’appareil théorique que nous avons à l’avance est
souvent vu comme devant permettre de produire des
hypothèses que l’enquête va vérifier ou infirmer.
C’est une vision relativement déductive. En anthropologie,
la tendance la plus intéressante consiste, je pense, à
utiliser l’appareil théorique pour produire sur le terrain des
théories nouvelles, changer quelque chose dans sa
perspective théorique, même produire des théories qui
soient en partie issues de l’enquête de terrain elle-même.
C’est une démarche relativement inductive. Les anglo-
saxons parlent de Grounded Theory,de théorie enracinée
dans le terrain, se dégageant du terrain. C’est ce que
j’essaye de faire ici avec l’épistémologie, j’essaye de faire
de la Grounded Epistemology,de l’épistémologie
enracinée dans le terrain. Quand on parle de rigueur, un
problème principal qui est souvent oublié est bien celui du
lien entre « données » et « réalité sociale », alors que
l’épistémologie a surtout étudié le lien entre « données »
et « interprétations finales ».
Je vais tirer un exemple du texte sur la « description
dense » de Clifford Geertz1.
1http://fr.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz

198 Les Journées de Tam Dao 2007
Clifford Geertz parle de description dense car la
description y est interpénétrée d’interprétations.
Le modèle de description dense est un texte qui porte
sur un combat de coq à Bali. Geertz utilise une étude de
cas grâce à laquelle il bâtit une interprétation de la culture
balinaise. On a contesté ses interprétations de la culture
balinaise. Mais on n’a pas contesté son étude de cas.
Or l’autre rigueur, c’est de savoir si cette étude de cas est
conforme, typique, représentative de la réalité du combat
de coq à Bali.
Il existe des exemples où le rapport réalité-données a été
biaisé ;c’est un autre aspect important de la critique.
Prenons l’exemple de l’anthropologue Griaule1qui a fait
une description du système religieux des Dogon au Mali.
Un anthropologue néerlandais a critiqué sa façon de
relever les données. Il convoquait les informateurs chez
lui pour les questionner de façon très directive. Il faisait
du terrain mais en projetant une petite enclave coloniale :
le colonisateur convoquait des indigènes. De plus, il
utilisait des informateurs privilégiés, certains étaient
passés par des écoles catholiques ou coraniques. Aussi,
la critique a montré que dans la vision du système
Dogon, des éléments musulmans et catholiques ont été
introduits par ces informateurs privilégiés.
Je pense qu’il est utile qu’il y ait ces discussions, qu’on
puisse faire ensemble du terrain. Il n’y a pas moyen de
donner des recettes sur la rigueur.La rigueur dans ce
domaine, c’est la combinaison d’un désir de rigueur et
d’un métier, d’un savoir-fairequi s’apprend sur le terrain.
Sans désir, mieux vaut faire autre chose. En même temps,
c’est toujours un combat permanent pour rester rigoureux.
Je peux résumer cela dans une formule empruntée à
Gramsci2:« il faut conjuguer le pessimisme de la raison et
l’optimisme de la volonté ». Dans notre domaine, cela
signifie ici « conjuguer le pessimisme épistémologique et
l’optimisme du désir scientifique ».
Frédéric Thomas
Je voudrais revenir sur l’idée de la rigueur, ne pas faire les
erreurs des autres. Je ne suis pas sûr que cela soit une
bonne méthode pour définir cette tentative de
rapprocher nos théories du monde social réel.
Pour revenir un peu à la critique que j’ai faite hier de
Bachelard, c’est procéder un peu comme de l’histoire
récurrente, c’est dire que les systèmes passés ont fait
des erreurs donc qu’ils étaient mauvais, c’était de la
mauvaise science. J’ai découvert de l’ethnographie
coloniale (Cadière pour l’Indochine, d’autres sur la
Nouvelle Calédonie) avec tout un tas de procédés
d’enquêtes méthodologiques qui sont aujourd’hui très
critiqués. Il n’empêche que ces outils ont ouvert la réalité
de ces sociétés à des Européens. Ils ont dit une vérité sur
ces sociétés. Il faut se méfier de ces démarches de
condamnation des systèmes passés à la lumière de ce
que l’on fait aujourd’hui, et trouver d’autre biais.
Voici un bon exemple des difficultés des débats en
sciences sociales. Peut-être qu’on peut le considérer sur
le domaine de l’adéquation descriptive ou pas. Frédéric
Thomas critique quelque chose que je n’ai pas dit et
construit une interprétation qui ne correspond pas à ce
que j’ai voulu dire, ce qui arrive souvent en sciences
sociales. Je vais essayer de le démontrer.
Je vais d’abord essayer de restituer ce qu’il a dit pour être
sûr que je ne rajoute pas une nouvelle couche de
surinterprétation.
Pour lui, j’ai fait de l’histoire récurrente, je veux prouver
un énoncé sur la rigueur en utilisant des exemples de
méthodologie du passé, d’histoire coloniale, de
disqualifier les méthodes du passé, alors qu’elles ont
produit des connaissances intéressantes et que par
ailleurs, ce n’est pas la bonne façon de démontrer ce
qu’est la rigueur.En prenant comme exemple une
mauvaise méthodologie du passé, à la fois je discrédite
l’ethnologie coloniale qui a produit par ailleurs de bons
travaux, d’autrepart, ce n’est pas une bonne méthode
pour démontrer la rigueur aujourd’hui.
Je peux discuter à ce niveau là :
•non, l’histoire récurrente peut être une bonne
méthode ;
• la colonisation n’a jamais produit de bons travaux à
cause de sa mauvaise méthodologie.
Je suis tout à fait d’accordavec son dernier énoncé :
je cite toujours dans mes exemples des travaux fameux
de l’époque coloniale auxquels je me réfère. De même,
je n’ai jamais écrit d’histoire récurrente.
Pourquoi Frédéric aboutit-il à des choses sur lesquelles
je suis d’accord en les présentant comme étant un
désaccord ?
Il me semble que je n’ai pas dit cela. A partir de ce que j’ai
dit, il a déjà traduit dans le recueil des données, il a
interprété. Je suis l’indigène et il est l’ethnologue. J’ai pris
un exemple de l’époque coloniale qui n’était pas épisté-
mologique mais purement pédagogique. J’ai cherché un
exemple de quelqu’un qui n’avait pas fait preuve de
rigueur. Ce n’était pas un postulat que pour démontrer ce
1http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Griaule
2http://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

199
Socio-anthropologie du changement social
qu’est la rigueur, il fallait que je prenne l’inverse. C’est une
facilité pédagogique. D’abord, je voulais dire qu’il n’y a pas
de recette, puis j’ai pris un exemple pour faire sentir le
problème de manque de rigueur à travers un exemple
documenté. Autrement dit, je crois qu’il y a un décrochage
entre la donnée recueillie qui est devenue que j’utilisais une
mauvaise méthodologie de l’époque coloniale par rapport
àmon propos. J’aurais pu utiliser, de la même façon,
l’exemple d’un article paru hier dans lequel l’auteur n’a pas
respecté les « trucs » de terrain.
Je pense que pour nous, la garantie est le respect du sens
donné par les informateurs à leurs propos. Même entre
intellectuels de bonne foi, il peut y avoir des malentendus
sur le sens des propos. Moi, en tant qu’indigène, je sens
dans ce qu’il dit, à tort ou à raison peu importe, qu’il a
déformé mes propos, qu’il les a mis dans un sens dans
lequel je ne me reconnais pas. Il y a deux types de
garanties pour renforcer la tendance vers la rigueur, le désir
de rigueur que j’appelle dans mon jargon :
•Emicité : ce mot vient d’emic, dans la tradition
anthropologique anglo-saxonne qui veut dire :
« le sens pour l’indigène, pour l’informateur, le niveau
des représentations populaires, des discours
populaires, du sens pour les informateurs ». Il s’agit
de se donner les moyens de respecter autant que
possible le sens que donne l’informateur dans les
données, le point de vue de l’indigène ;
•Descriptivité :de même, au niveau des obser-
vations, on peut parler de descriptivité pour que les
situations que nous observons soient les plus fidèles
àla situation de départ.
Nous le faisons tous sans arrêt : prendre les propos
de l’interlocuteur pour les arranger dans ce qui nous
arrange selon notre schéma argumentatif. Je viens de
dire de façon moderne et méthodologique ce que
Weber avait pressenti en parlant « d’adéquation
quant au sens ».
Frédéric Thomas
J’ai envie de compléter l’analyse de ce débat en repartant
aux conclusions. Tu les as prises comme une surinter-
prétation (tout travail d’ethnographie coloniale est à jeter,
l’enquêté se sent trahi par le travail d’interprétation et il y
arévolte par rapport à l’enquête). Je pense qu’il y a une
deuxième explication : la pensée d’Olivier de Sardan
nous arrive sous forme d’énoncé qui se déroule. Chaque
énoncé séparé a un sens propre et à un moment il a dit
la phrase, je cite : « la rigueur, c’est de ne pas faire ce que
Griaule faisait ». Cet énoncé, on l’a tous entendu. Ce
n’est pas ce qu’il veut dire. Il a raison de dire que je la sors
de son contexte, mais l’énoncé est là. Je pense que dans
toute enquête sociologique ethnographique, il faut savoir
si ce que nous dit notre interlocuteur représente sa
pensée globale, sa représentation du sujet. Donc il n’y a
pas eu de ma part surinterprétation mais volonté
finalement de pointer le problème de nos énoncés.
Ces derniers ont une vie qui est indépendante de notre
pensée globale.
J’ajouterai deux mots pour finir. Le système de sens de
l’enquêté est différent de celui du système de sens de
l’enquêteur. Ce n’est pas uniquement le fait de la langue.
Dans notre propre langue, cela arrive. Alors que là nous
sommes, Thomas et moi, dans le même système de
sens et de référence. Quand on est à deux systèmes de
sens, le mal entendu est normal. Il est normal que votre
informateur ne soit pas d’accord avec votre système
d’interprétations. Sinon, vous dîtes ce qu’il dit, ce qui
n’est pas le travail du chercheur. Mais quand vous citez
ses propos, vous devez éviter le mal entendu, car là,
c’est la faute du chercheur qui ne respecte pas le
système de sens de l’indigène. Vous comprenez qu’il y
aainsi deux niveaux :
• celui où l’on respecte les mots et la logique interne
du discours de l’informateur ;
• celui où l’on reprend une liberté et où l’on est respon-
sable des interprétations que nous proposons.
Le second problème soulevé par l’intervention de
Thomas, c’est celle du registre des discours.
Quand il prend un énoncé proféré et qu’il le traite comme
un énoncé écrit, il fait un changement de niveau de
registre. C’est aussi des problèmes auxquels nous
sommes tous confrontés. Ce que je m’autorise dans un
séminairepédagogique, je ne me l’autoriserai pas dans
un écrit. Les intellectuels ne sont pas les seuls à avoir
plusieurs niveaux de discours, les gens auprès desquels
nous travaillons aussi (discours privé-public). Faire ainsi,
c’est une preuve d’infidélité émique.
Cela renvoie à la question de la compréhension des
métaphores naturelles que l’on utilise. Par exemple :
« ne pas avoir de bol » pour exprimer « ne pas avoir de
chance ». Imaginons un anthropologue kenyan qui vient
en France, qui ne parle pas bien français, qui entend
cette expression régulièrement et qui élabore une théorie
sur le bol : le bol est au centre de la structure symbolique
des Français ; c’est un dieu absent, les Français
déplorent tout le temps qu’il n’est pas là. Cela paraît
absurde mais dans le passé, on en a eu de nombreux
exemples. Moi-même, j’ai eu au Niger une telle
expérience avec un américain. A partir d’une
incompréhension d’ordre linguistique (il a compris à tort
que les mots « chef » et « chance » étaient identiques), il
aécrit un article sur ce même mot qui signifie chance et
chef, alors que c’est entièrement faux, qu’il s’agit de
deux mots distincts mais phonétiquement très proches.
Mais avant même le problème de linguistique, il y a déjà
celui du passage du registre populaire au registre du
langage symbolique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%