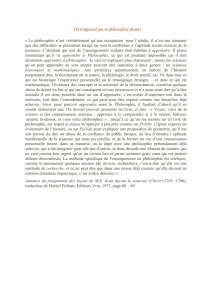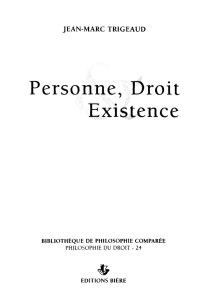Les débuts de la philosophie allemande au Canada français

Les débuts de la philosophie allemande au Canada français:
Contexte et raisons
Paru dans R. KLIBANSKY et J. BOULAB-AYOUB (Dir.), La pensée philosophique
d’expression française au Canada. Le rayonnement du Québec, Québec: Presses de
l’Université Laval, 1998, 207-229
Jean Grondin
Université de Montréal
La pratique de la philosophie se refuse à toute description purement
extérieure, a fortiori à tout survol comme celui qui m’est demandé ici. Kant, le
grand maître à penser de la philosophie allemande, a eu raison de rappeler que
l’on ne pouvait pas apprendre de philosophie, mais tout au plus à philosopher.
Aucun effort visant à rendre compte de l’intérêt porté à la philosophie
allemande au Canada ou au Québec n’arrivera donc à en cerner, ne serait-ce
qu’approximativement, l’accomplissement véritable, encore moins les causes ou
les motifs secrets.1 Mais c’est justement cette impossibilité de définir avec
assurance ce à quoi l’on a affaire, ou ce qui nous arrive, qui caractérise aussi les
questions proprement philosophiques. «Un problème philosophique», disait
justement le philosophe allemand Wittgenstein, «prend toujours la forme
suivante: je ne sais pas où j’en suis». Mais le premier à l’avoir su aura été
Socrate, dont la seule doctrine consistait à savoir qu’il ne savait rien. Et, de son
1Je remercie mes collègues Claude PICHÉ (Université de Montréal) et Laurent-Paul LUC
(Université de Sherbrooke) des précieuses informations qu’ils ont bien voulu me confier.
Pour les fins limitées et strictement indicatives de ce texte et conformément aux consignes qui
m’ont été données, je m’en suis tenu à la recherche en philosophie allemande pratiquée par les
professeurs dans les universités de langue française, et plus précisément à ceux qui avaient
publié au moins un livre. Si ces consignes avaient l’avantage de restreindre considérablement
l’éventail des chercheurs, elles m’interdisaient de tenir compte de la recherche qui s’est
surtout manifestée dans des thèses et des articles. Et plutôt que de simplement énumérer les
recherches qui se font en philosophie allemande, qui présentent un caractère si varié qu’un
résumé ne leur aurait jamais fait justice, j’ai tenté, à mes risques, d’expliquer pourquoi
certaines thématiques s’étaient imposées avec peut-être plus d’urgence que d’autres. Cette
perspective un peu hégélienne m’a amené à parler aussi du contexte général, institutionnel et
intellectuel, dans lequel était apparue la recherche en philosophie allemande au Canada
français.

2
propre aveu, il ne faisait que suivre un mystérieux démon intérieur lorsqu’il
s’adonnait aux questions de la philosophie. Les forces de la cité ont pensé, à
tort ou à raison, qu’il introduisait ainsi de nouveaux dieux. En fait, ce sont les
idoles existantes qu’il cherchait à affoler. Depuis, toute philosophie a pu se
reconnaître dans la figure de Socrate.
Vus de l’extérieur, les chercheurs qui s’intéressent à la philosophie
allemande doivent faire l’effet d’une drôle de secte. Pourquoi s’intéresser à une
pensée aussi exotique et d’une lourdeur aussi rébarbative? Mais aussi, pourquoi
s’entêter à perpétuer une tradition dont certains pensent qu’elle se compose
pour une très large part de charlatans (Hegel et Heidegger étant les plus
indécrottables), qui mépriseraient avec une désinvolture trop souvent imitée les
règles les plus élémentaires de la logique? Certains vont même jusqu’à croire
que ce sont ses courants romantiques qui ont conduit aux pires catastrophes de
l’humanité récente (essentiellement, et sans faire dans la subtilité, au nazisme et
au marxisme)?
Pourtant, la pensée allemande exerce un attrait inouï. Même ceux qui ne
se consacrent pas principalement à la pensée allemande ne peuvent se permettre
de l’ignorer. En ontologie, en éthique, en esthétique, en philosophie politique,
en philosophie analytique, en épistémologie, et, plus généralement, dans le vaste
champ des sciences sociales et humaines, les philosophes allemands demeurent
incontournables. Depuis deux siècles, les philosophes allemands sont peut-être à
la philosophie ce que les musiciens allemands sont à l’histoire de la musique
moderne, c’est-à-dire qu’ils forment quelque chose comme les quatre
cinquièmes du répertoire. Les derniers très grands philosophes (c’est-à-dire
ceux que l’on lira encore dans cent ans) ont pour nom Kant, Fichte, Schelling,
Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Dilthey, Freud, Husserl et Heidegger.1
Et pour ceux qui pensent devoir diagnostiquer un essoufflement de la
philosophie allemande au XXe siècle, on se contentera d’ajouter les noms de
Frege, Wittgenstein, Weber, Hartmann, Scheler, Jaspers, Adorno, Bloch,
Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Plessner, Arendt, Gadamer, Apel, Habermas,
Popper, Jonas, Marquard ou Blumenberg. Pas si mal pour une pensée qui
manque de souffle! On pourrait montrer sans peine que les traditions étrangères
1Cf. aussi François VEZIN, «Philosophie française et Philosophie allemande», in Heidegger
Studies 10 (1994), 143-162.

3
se sont aussi amplement inspirées de la pensée allemande, et d’une façon que
d’aucuns jugent parasitaire. Cela est très évident pour ce qui est de la
philosophie analytique issue du Cercle de Vienne dont les grandes étoiles
demeurent, après Frege, Wittgenstein, Carnap, Schlick, Neurath et Popper.
Quant à la philosophie française, de l’existentialisme jusqu’à la déconstruction,
c’est-à-dire de Sartre à Foucault et Derrida, ses impulsions essentielles lui sont
aussi venues de l’espace culturel allemand: Nietzsche, Heidegger, Hegel, Kant.
On doit cependant rappeler que ceux qui se sont intéressés à la
philosophie allemande, ici comme ailleurs, ne l’ont pas fait parce qu’elle était
allemande ou parce qu’ils reconnaissaient quelque distinction intrinsèque à la
pensée, voire à la langue germaniques. Rien de tout cela n’est vraiment
pertinent. En un sens, on aimerait dire que les philosophes allemands n’étaient
«allemands» que par accident. Que l’on s’entende bien, Hegel est aussi
allemand que Locke peut être anglais, mais ce n’est jamais cet aspect qui justifie
l’intérêt qu’on leur porte. Si on étudie ces auteurs, c’est à chaque fois en raison
de la radicalité et de la portée universelle de leurs interrogations, venues de très
loin, mais qui, grâce à eux, retentissent jusqu’à nous. S’occuper des philosophes
allemands, c’est donc s’intéresser aux penseurs de la modernité qui ont su
maintenir et renouveler cette universalité du questionnement philosophique.
C’est pourquoi les philosophes allemands n’ont, quant à l’essentiel, rien
d’allemand. C’est qu’ils sont d’abord et avant tout les héritiers de Parménide,
Héraclite, Platon, Aristote, Plotin, Anselme, Thomas, Descartes, Leibniz, Locke
ou Spinoza. Nous savons tous qu’Aristote et Platon étaient des Grecs, très
grecs, mais, du point de vue de la philosophie (quelle que soit l’idée que l’on
s’en fasse), cela n’a aucune importance. On aimerait, face aux Grecs ou aux
Allemands, se retrouver dans la situation qui est largement la nôtre face aux
auteurs du Moyen Âge dont on ignore volontiers l’enracinement géographique.
Saint Augustin était-il un philosophe «algérien» et saint Thomas un «italien»? Ils
étaient philosophes, un point c’est tout. Il en va de même des philosophes
allemands.
L’intérêt porté à la philosophie allemande ne doit donc rien d’essentiel à
quelque «germanophilie». La seule question qui doit nous occuper ici est de
comprendre pourquoi la pratique de la philosophie allemande a pu exercer un
certaine rôle dans l’essor, mais très récent, de la philosophie au Canada français.

4
On ne rappellera pas la petite histoire de la philosophie au Québec, mais il est
clair qu’avant 1970 la philosophie y était une affaire encore cléricale et que la
philosophie dite allemande n’y jouait à peu près aucun rôle.1 Dans ce cadre, la
philosophie s’effectuait à l’aide de manuels et d’un découpage de disciplines
(pratique qui se retrouve encore en philosophie analytique) qui ne suivait pas
nécessairement le déploiement historique de la pensée. L’histoire de la
philosophie servait uniquement d’illustration et, dans le cas de la philosophie
allemande, très souvent aussi de repoussoir. Les plus grands classiques de la
pensée allemande, en commençant par Kant, se trouvaient alors à l’«index» des
auteurs proscrits. Dans la mesure où la pensée cléricale se voulait hostile à la
modernité, elle s’opposait ipso facto à la pensée des auteurs allemands qui
n’ont pas peu contribué à la définition du monde moderne. Il n’est pas
impossible que cette hostilité à la pensée moderne, et allemande, ait suscité un
engouement clandestin pour le fruit défendu qu’a pu représenter cette
philosophie. C’est ainsi, sans doute, qu’un penseur comme Marx a fait son
entrée dans les facultés de sciences sociales, dont la création a fini par
provoquer la débâcle de la pensée traditionnelle. C’est ce que l’on a appelé la
Révolution «tranquille», mais, avec le recul, il faut bien reconnaître qu’elle fut
passablement tapageuse. Toujours est-il que la pensée moderne et très souvent
allemande qui avait été refoulée a alors pu reconquérir la place qui lui revenait.
Mais avant d’y venir, on peut aussi rappeler qu’il y avait eu une autre
présence de la philosophie allemande avant la révolution pseudo-tranquille. On
pense ici au modernisme secret qui a infiltré l’apologie de la philosophie
chrétienne dans les courants du néo-thomisme et du personnalisme, qui se sont
abreuvés de l’existentialisme allemand (de Heidegger et Jaspers, par exemple)
lorsqu’ils ont voulu ranimer les questions de la métaphysique et de l’ontologie.
On pensera ici à des auteurs comme Mounier, Gilson, Marcel, Lavelle ou
Maritain, aujourd’hui un peu oubliés, mais dont l’ascendant sur l’intelligentsia
canadienne fut naguère considérable. Or ces penseurs européens, dont certains
ont enseigné au Canada (Gilson notamment), étaient bien conscients de leur
1Ma source la plus récente est ici la thèse de Doctorat de Louis LEVASSEUR, Savoirs
traditionnels, savoirs modernes et enseignement philosophique de niveau collégial dans la
modernité québécoise, Département de sociologie, Université de Montréal, 1996. Malgré son
titre, la thèse brosse aussi un tableau éclairant de la philosophie pratiquée avant la Révolution
tranquille.

5
dette envers la grande tradition de la philosophie allemande. Il n’est pas exclu
qu’ils aient ainsi indirectement contribué à une meilleure appréciation des
auteurs allemands. Par le biais du néo-thomisme, du personnalisme et de
l’existentialisme chrétiens, donc des courants relativement modernes, mais qui
servaient bien les fins de la pensée cléricale, de jeunes esprits ont ainsi été
sensibilisés aux vertus de la phénoménologie de Husserl (enseignée par Soeur
Germaine Cromb a l’Université de Montréal à partir des années 60) ou de la
pensée de l’être de Heidegger (introduite, par le biais du thomisme, par
Bertrand Rioux1).
À la suite de la déroute subite de la pensée cléricale dans les années
soixante, un aggiornamento philosophique devenait inéluctable. On sait à quelle
vitesse il s’est emparé de toutes les sphères de la société, jetant un discrédit
total, et parfois excessif, sur la pensée traditionnelle, assimilée du jour au
lendemain à une «grande noirceur». Comme si tout devenait clair à partir de
maintenant. En fait, c’est alors qu’a débuté une très profonde confusion et dont
nous ne sommes probablement pas sortis. On laissera à d’autres le soin
d’éclairer les pathologies plus sociologiques que cette révolution de chapelle a
provoquée au Québec. On ne s’intéressera ici qu’au destin de la philosophie
allemande et au sort qui a pu lui être réservé dans les bouleversements qui sont
venus hanter la société canadienne-française (ou québécoise, car la crise en était
aussi une d’identité).
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces convulsions
philosophiques, dont on aurait tort de croire qu’elles ne concernent que les
tribulations de quelques professeurs d’université. Ce serait sous-estimer la
portée universelle et pédagogique de la philosophie. Car la révolution qui s’est
produite dans la société canadienne française était à sa racine philosophique,
puisque ce qui fut mis en question (geste philosophique, s’il en est un), ce fut
précisément le cadre intellectuel, thomiste pour ne pas le nommer, qui présidait
à l’ensemble de l’ordre social. Car c’est bien par l’enseignement et la
transmission de cette philosophie que s’était maintenue la cohésion de la société
plus traditionnelle. Mais il faut bien voir que l’effondrement de cet horizon
1Auteur d’une étude comparative remarquée, Heidegger et saint Thomas d’Aquin, Préface de
Paul RICOEUR, Presses de l’Université de Montréal, 1963 (B. Rioux avait fait une thèse sur
la pensée politique de J. Maritain en 1953).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%