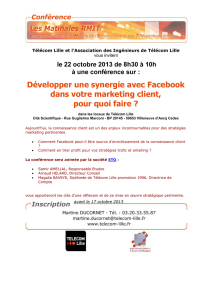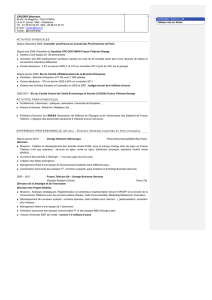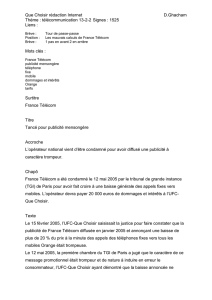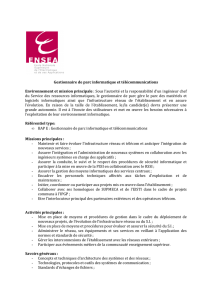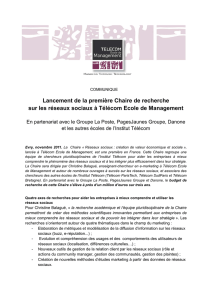Politiques sécuritaires en question dans l`entre

1
OPINION
Politiques sécuritaires en question dans l’entre-deux
tours
Par Pierre-Antoine Chardel, philosophe et maître de conférences en sciences
sociales à Télécom Ecole de Management
Dans l’entre deux tours de l’élection présidentielle, on peut être frappé par l’importance du thème de
la sécurité dans la stratégie des deux derniers candidats en lice. On sait pourtant que ces discours
constituent une réponse globale à l’heure où l’accélération médiatique en démultiplie la portée dans
l’opinion publique. Les soubassements socio-philosophiques qui sous-tendent les politiques
sécuritaires étant clairement identifiables, ne doivent-ils pas, sans doute plus intensément
aujourd’hui, nous inciter à nous interroger sur les effets à long terme de ces stratégies et sur leur
signification pour les sociétés démocratiques ?
Non seulement en France, mais à travers le monde, un nombre croissant de responsables politiques
se montrent de plus en plus avides de cibles de substitution pour nous rassurer par des mesures
protectrices sans pour autant rendre possible une quelconque interrogation sur les raisons profondes
des malaises sociaux qui affectent nos sociétés.
La montée des partis d’extrême-droite un peu partout en Europe est à cet égard significative, comme
l’est d’ailleurs le score élevé de Marine Le Pen lors du premier tour de la campagne présidentielle.
On sait qu’il est loin d’être neutre pour les politiques d’intervenir sur les symptômes plutôt que sur les
causes des pathologies sociales qui tendent aujourd’hui à affecter le vivre-ensemble.

2
Le sociologue anglo-polonais Zygmunt Bauman a parfaitement mis en évidence comment une telle
exploitation de la peur a des retombées politiques souvent très fortes, au moins à court terme. Faire
quelque chose, ou donner l'impression de faire quelque chose, contre la délinquance menaçant la
sécurité des personnes, accélérer l’installation des caméras de surveillance dans les rues ou les
couloirs du métro revient à pratiquer une politique immédiatement rentable : « Toute action menée
contre l'insécurité est infiniment plus spectaculaire, visible, télégénique, que tout ce que l'on peut faire
pour atteindre les couches profondes du malaise social, qui sont de ce fait moins perceptibles et
apparemment plus abstraites. Quel spectacle plus intéressant et plus excitant que la lutte contre le
crime, que le crime lui-même, surtout celui qui vise les corps et les propriétés privées. Les
producteurs et les scénaristes des médias en sont parfaitement conscients »1. On assiste ainsi à une
instrumentalisation politique de la peur : les angoisses portant sur la sécurité, et qui sont en définitive
davantage liées à des incertitudes de fond, d’ordre psychologique et existentielle, l’emportent sur
toutes les autres.
La dimension économique est loin d’être neutre dans ce processus qui voit la généralisation des
systèmes de surveillance, telle que la « vidéo-protection » devenue en France l’un des maillons forts
de la politique du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Même si des débats autour des technologies de
surveillance ou de contrôle voient timidement le jour sur la toile, ou de manière encore très
circonscrite à l’échelle municipale par exemple, on peut déplorer le fait que l’opinion publique
demeure encore trop passive sur de telles questions, nous renvoyant pour une part à la situation que
décrivait Alexis de Tocqueville dans son fameux ouvrage de 1840, De la démocratie en Amérique,
lorsqu’il tentait d’imaginer sous quels traits le despotisme pouvait se produire dans le
monde contemporain. Il songeait alors à « une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui
tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. (…) Au-dessus
de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de
veiller sur leur sort (…) ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins… »2.
A un tel risque d’épuisement de la vie démocratique qui fut si justement décrit par Tocqueville, vient
aujourd’hui se greffer un fort déterminisme qui fait que les comportements de résistance à l’égard
d’innovations technologiques sont immédiatement perçus comme des attitudes rétrogrades dans un
monde où la nouveauté, quelle que soit sa forme, est perçue comme positive, comme allant dans le
sens du progrès, créant les conditions d’acceptabilité de dispositifs qui soulèvent pourtant des
questions considérables en termes de respect des libertés.
A ce niveau, il est opportun de déceler une économie politique de la technologie, c’est-à-dire, une
réalité économique et industrielle qui accélère le développement et l’acceptabilité de technologies qui
s’avèrent pourtant démocratiquement problématiques. On observe en effet que plus la mondialisation
économique s’intensifie, générant une forte insécurité sociale (avec tout l’état de psychose collective
qu’elle peut entraîner), plus nous sommes enclins à vouloir retrouver les marques de ce qui nous est
familier et à nous protéger les uns des autres. Comme l’a écrit à ce propos Seyla
Benhabib, professeur de sciences politiques à l’Université de Yale, « la mondialisation s’accompagne
d’exigences isolationnistes et protectionnistes, de velléités d’élever toujours plus haut et de
consolider les murs qui nous séparent les uns des autres »3.
Dans ces mouvements de repli, on assiste à une insidieuse homogénéisation de l’imaginaire collectif
1 Zygmunt Bauman, Le coût humain de la mondialisation, traduit de l’anglais par Alexandre Abensour, Paris, Hachette,
1999, p. 178.
2 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1840), Tome II, IVème partie, chapitre VI, Paris, Gallimard,
1961, p. 434.
3 Seyla Benhabib, « Renverser la dialectique de la raison : le réenchantement du monde », in Emmanuel Renault &
Yves Sintomer (sous la direction de), Où en est la théorie critique ?, Paris, la Découverte, 2003, p. 91.

3
qui facilite l’acceptabilité de dispositifs technologiques censés rendre nos vies quotidiennes plus
sûres, réduisant ainsi l’espace public à un espace sécurisé, mais également de mesures politiques
qui se confondent avec des rhétoriques sécuritaires.
Or vis-à-vis de ces logiques réductrices, nous pouvons être en droit de nous inquiéter de l’évolution
des valeurs dans nos sociétés démocratiques où les actions politiques sont de plus en plus soumises
à des critères télégéniques. Nous avons fortement à craindre de cette concordance du politique et du
sécuritaire. Car si des interventions partielles et limitées dans le temps prospèrent dans notre société
de l’information, elles sont loin de répondre à des demandes beaucoup plus fondamentales de sens,
elles ne se confrontent pas à la complexité des maux qui affectent nos sociétés et qui devraient
pourtant inciter les politiques à se concentrer davantage sur des problématiques qui sont induites par
la fragilisation du lien social et du système éducatif, que sur des mesures sécuritaires dont la
rentabilité immédiate risquerait, à plus ou moins long terme, de porter définitivement atteinte au
devenir de la démocratie elle-même et d’en épuiser les ressources.
Il est à cet égard inquiétant d’entendre des politiques se prononcer essentiellement en termes
sécuritaires alors que les réponses à la plupart des violences et des pathologies sociales qu’elles
recouvrent devraient être avant tout sociales et éducatives. C’est seulement par là qu’il devrait être
possible de réinstaurer du dialogue et du sens là où la parole s’est perdue.
Contact presse - Télécom Ecole de Management
Tristan Horreaux - (+33)6 81 53 37 39 - tristan.horreaux@telecom-em.eu
Philosophe de formation, Pierre-Antoine Chardel est maître de conférences à Télécom Ecole de
Management et chercheur associé au CERSES, CNRS / Université Paris Descartes. Il est co-
responsable à la Sorbonne du séminaire « Espace public et reconstruction du politique ». Parmi ses
ouvrages : Technologies de contrôle dans la mondialisation : enjeux éthiques, politiques et
esthétiques, en collaboration avec Gabriel Rockhill (Editions Kimé, 2009).
Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique
accréditée AACSB et AMBA. Elle forme des managers particulièrement recherchés des entreprises
qui apprécient leur expertise dans l’économie numérique et leur maîtrise des technologies de
l'information. Télécom Ecole de Management est la business school de l’Institut Mines-Télécom,
premier groupe d’écoles d’ingénieurs en France, sous tutelle du ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie. Elle partage son campus avec Télécom SudParis, grande école
d'ingénieurs. Dirigée par Denis Lapert, elle compte 1200 étudiants, 73 enseignants-chercheurs et
plus de 4000 diplômés. www.telecom-em.eu
1
/
3
100%