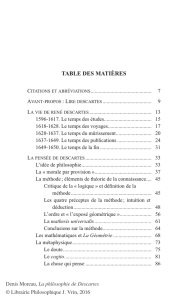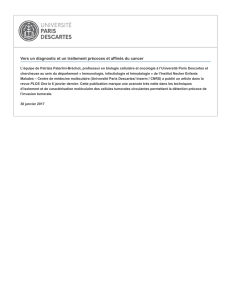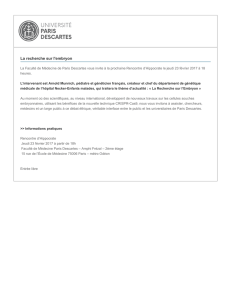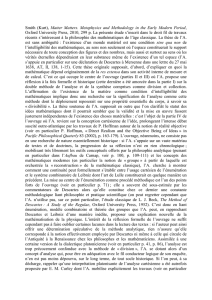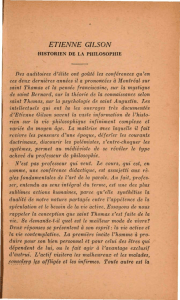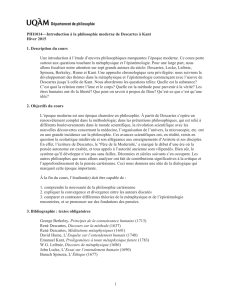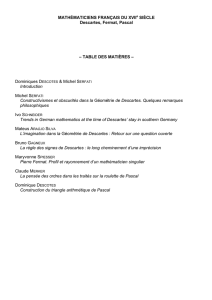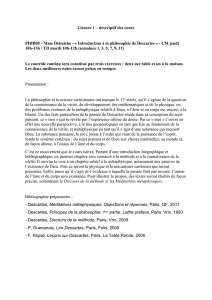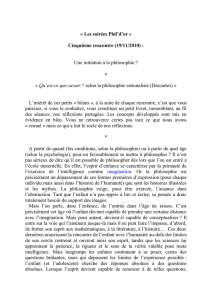La liberté chez Descartes et la théologie

Gilson et Descartes
à l’occasion du centenaire de
‘La liberté chez Descartes
et la théologie’
Édité par Dan Arbib et Francesco Marrone
EXAMINA PHILOSOPHICA
“I QUADERNI DI ALVEARIUM” 2

EXAMINA PHILOSOPHICA
I quaderni di Alvearium 2
ISBN: 978-889646-51-9
2015
EXAMINAPHILOSOPHICA
I Quaderni di Alvearium 2
GILSON ET DESCARTES
À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE ‘LA LIBERTÉ
CHEZ DESCARTES ET LA THÉOLOGIE’
Édité par Dan Arbib et Francesco Marrone
Questo volume è pubblicato nell’ambito del progetto
PRIN 2010-2011 «Atlante della ragione europea (XV-XVIII sec.).
Tra Oriente ed Occidente» (Unità di Lecce)
egrazie alladonazione di Ettore Lojacono
(«Lascito testamentario Lojacono»).

3
Gilson et Descartes à l’occasion
du centenaire de ‘La liberté chez Descartes et la théologie’
Table des matières
JEAN-ROBERT ARMOGATHE
Introduction ................................................................................................................................... 5
DENIS KAMBOUCHNER
Le discours de la méthode d’Étienne Gilson .................................................................................. 7
IGOR AGOSTINI
Qu’est-ce que constituer un Index scolastico-cartésien ? ............................................................. 11
JEAN-CHRISTOPHE BARDOUT
Descartes ou Thomas d’Aquin ? Note sur la fonction historique de Descartes
dans la défense gilsonienne d’un réalisme thomiste ..................................................................... 25
DELPHINE BELLIS
Météores cartésiens et météores scolastiques : la lecture philosophique d’Étienne Gilson ........... 41
VINCENT CARRAUD
Socratisme chrétien, dépassement de la philosophie et chosisme : le Pascal d’Étienne Gilson ..... 57
FRANCESCO MARRONE
Étienne Gilson et Roland Dalbiez. Sur la genèse de la notion cartésienne de réalité objective .... 71
GIULIA BELGIOIOSO
L’« itinéraire cartésien » d’Étienne Gilson dans son dialogue avec Augusto Del Noce ................ 87
Appendix A ............................................................................................................................... 105
Appendix B ................................................................................................................................ 108
FRANCESCO MARRONE
Descartes, Gilson et l’histoire de la philosophie. Une postface .................................................. 117
Index Nominum ........................................................................................................................ 123

4
EXAMINA PHILOSOPHICA
I quaderni di Alvearium 2
À Massimiliano Savini

5
Gilson et Descartes à l’occasion
du centenaire de ‘La liberté chez Descartes et la théologie’
Introduction
La soutenance du doctorat d’Etat d’Étienne Gilson n’a pas clos la discussion de ses deux thèses la
principale sur La liberté chez Descartes et la théologie, la complémentaire qui était un Index scolastico-cartésien.
Leur publication en 1913 constitue une césure dans les fécondes études sur le philosophe français : la
discussion des thèses annonçait déjà ce destin. Les réserves de François Picavet, André Lalande et Henri
Delacroix sur l’Index et celles, plus appuyées, de Victor Delbos sur la thèse principale n’ont pas cessé de
trouver des échos depuis leur soutenance.
Il appartenait aux Centres d’études cartésiennes de Paris-Sorbonne et de l’Université du Salento à
Lecce de parcourir ce siècle pour mesurer combien ces deux livres ont, par leur originalité, profondément
marqué les études cartésiennes. En premier lieu, les débats : Francesco Marrone a retenu celui avec Roland
Dalbiez (1893-1976), qui fut un des maîtres de Paul Ricoeur. En 1929, Dalbiez attaque Gilson sur Les
sources scolastiques de la théorie cartésienne de l’être objectif (« Revue d’histoire de la philosophie », 3, pp.
464-472). L’esse obiectivum peut bien n’être qu’un être de raison pour les thomistes, mais les scotistes ne
le laissent pas tomber dans le pur néantdes étants de raisonet des impossibilia ; Duns Scot, en somme,
avait reconnu aux contenus des idées divines une entité tout à fait semblable à celle que Descartes aurait
attribué, en 1641, aux contenus de la connaissance humaine. La critique de Dalbiez conduira Gilson à
introduire (timidement) le scotisme dans l’horizon doctrinal du XVIIe siècle.
Elargir cette introduction en tenant compte des développements récents autour des courants
doctrinaux et de leur interaction, c’est ce qu’Igor Agostini propose de faire en reprenant et complétant
l’Index scolastico-cartésien. Sa communication repose à frais nouveaux la question des rapprochements et
des inuences, surtout dans le domaine lexical.
Autre échange d’idées, un demi-siècle plus tard, entre Étienne Gilson et le philosophe italien
Augusto Del Noce (1910-1989), dans la correspondance échangée entre les deux hommes (1964-1969)
et étudiée par Giulia Belgioioso. Les questions de Del Noce (et la sortie, en 1965, de son volume sur
Descartes) permettent à Gilson de relire son iter cartésien et d’y apporter des nuances, surtout en fonction
des travaux de son élève Henri Gouhier (et nous trouvons ici des pièces inédites).
Ce qui nous introduit à l’évolution interne de Gilson, non seulement comme historien (et professeur)
de la philosophie, mais comme penseur du réalisme méthodique. Jean-Christophe Bardout, dans sa Note sur
la fonction historique de Descartes dans la défense gilsonienne d’un réalisme thomiste. La « querelle du réalisme »
de 1935-1936 (avec Etienne Gilson et Léon Noël, de Louvain [1878-1955], comme protagonistes) engage
une prise de position sur le cartésianisme, qui joue le rôle d’un ltre pour éprouver les différents réalismes.
Réalisme thomiste et critique de la connaissance (1939) constitue donc, selon une heureuse formule de Bardout,
« un traité du bon usage du cartésianismeen philosophie ».
Comme le montre Delphine Bellis, l’étude gilsonienne des Météores n’est pas seulement un exercice
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%