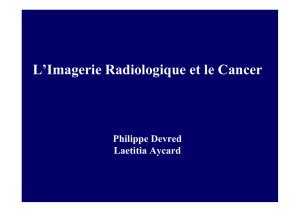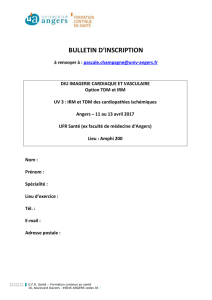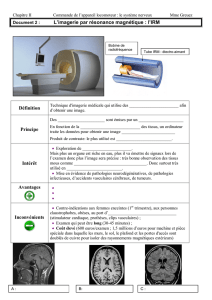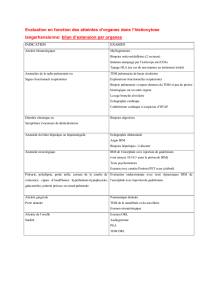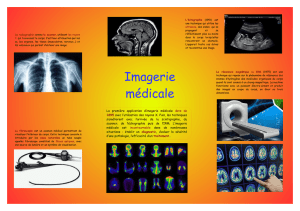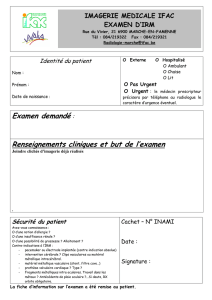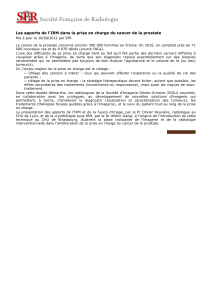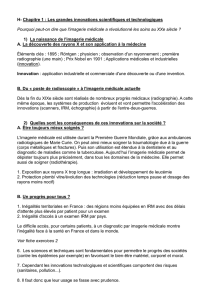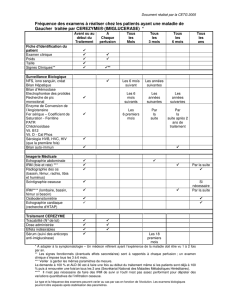Stroke Diagnostic par imagerie en cas d`accident vasculaire

Tomodensitométrie
Avec la TDM sans injection de pro-
duit de contraste, les hémorragies in-
tracrâniennes peuvent être diéren-
ciées des infarctus ischémiques. Un
thrombus intravasculaire peut être
visible sous forme de signe de l’artère
hyperdense (« hyperdense artery
sign », Fig. 1A). Des signes précoces
perceptibles à la TDM peuvent surve-
nir dans les 3 heures suivant une oc-
clusion vasculaire, particulièrement
dans les ganglions de la base ou dans
Thème principal : Stroke
Diagnostic par imagerie en cas d'accident vasculaire cérébral aigu
Réponses apportées par l'imagerie médicale .........................................................1
Tomodensitométrie ......................................................................................................1
Imagerie par résonance magnétique .....................................................................2
TDM ou IRM ? ..................................................................................................................2
Neuroréhabilitation après infarctus cérébral
« Rescue and Recovery » .............................................................................................3
Base théoretique de la récupération fonctionnelle ..........................................3
Neuroréhabilitation multidisciplinaire ..................................................................3
Concepts thérapeutiques spéciques et développements novateurs ......4
Pharmanews ...................................................................................................................4
Stroke
Auteurs de ce numéro :
Dr med. P. Mordasini pour le Stroke Team de
l'Inselspital Berne, Institut für diagnostische und
interventionelle Neuroradiologie, Inselspital,
Berne; Dr. med. S. Beer, Klinik für Neurologie und
Neurorehabilitation Valens
Société Suisse
de Neurologie (SSN)
09.1
Pasquale Mordasini, Seran Beer
Chères lectrices, chers lecteurs,
Comme mentionné dans un pré-
cédent article sur le traitement de
l’infarctus cérébral aigu (Neurology.
ch 06.2), un diagnostic rapide est ab-
solument fondamental en raison de
la fourchette thérapeutique étroite.
Les techniques d’imagerie médicale
modernes permettent un diagnostic
précoce et fournissent des informa-
tions essentielles pour le choix des
options thérapeutiques. Des mesures
de réhabilitation initiées tôt, un trai-
tement intensif ainsi que l’initiation
cordonnée de thérapies multidisci-
plinaires sont déterminants pour le
succès de la réhabilitation.
Dr Pasquale Mordasini
Dr Seran Beer
Un diagnostic par imagerie rapide,
ciblé et en permanence disponible
joue un rôle clé dans la chaîne de
traitement de l’accident vasculaire
cérébral (AVC) aigu. Ce diagnostic
est, par ailleurs, partie intégrante
du concept d’unité neurovasculaire
(« Stroke Unit »). Les techniques
d’imagerie médicale modernes per-
mettent un diagnostic précoce et
fournissent des informations essen-
tielles pour l’instauration des dié-
rentes options thérapeutiques.
Réponses apportées par
l’imagerie médicale
Dans le diagnostic d’un AVC aigu,
l’imagerie diagnostique devrait ré-
pondre avec rapidité et abilité
aux quatre questions suivantes
1
:
Hémorragie intracrânienne ? Occlu-
sion vasculaire ? Zone de nécrose ?
Pénombre ? Cette approche permet
d’exclure une hémorragie intracrâni-
enne, d’identier et de localiser une
occlusion vasculaire et de faire la dis-
tinction entre un parenchyme cérébral
infarci et un parenchyme cérébral pou-
vant encore être sauvé (« pénombre »
ou « tissu à risque »). A côté de l’état
clinique du patient et du temps écoulé
depuis le début des symptômes, ces
informations sont déterminantes pour
le choix de l’option thérapeutique.
Grâce à la tomodensitométrie (TDM)
et à l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM), pratiquées selon des pro-
tocoles d’exploration adaptés, il est
possible de répondre à ces questions
en situation d’urgence.
Diagnostic par imagerie en cas
d’accident vasculaire cérébral aigu
Une information de la SSN aux médecins généralistes, internistes et pédiatres
Sommaire

209.1
le cortex insulaire (« insular ribbon
sign »). La détection de ces altérations
précoces et souvent subtiles nécessi-
te toutefois une certaine expérience.
Au moyen de l’angioscanner, des
sténoses vasculaires ainsi que des
occlusions peuvent être mises en évi-
dence à partir de la crosse aortique
jusqu’aux branches intracrâniennes
de troisième ordre (Fig. 1B). La TDM
de perfusion permet de déterminer
diérents paramètres de perfusion
(CBF, CBV, MTT, TTP). En combinant
ces paramètres, il est possible de
tirer des conclusions sur la zone de
nécrose et sur un éventuel « mis-
match » en tant que marqueur de la
zone de pénombre (Fig. 1C).
Imagerie par résonance
magnétique
Les séquences spin-écho convention-
nelles permettent de visualiser des
altérations liées à un œdème cyto-
toxique ou vasogénique uniquement
après plusieurs heures. L’imagerie
de diusion (DWI) permet toutefois
d’obtenir, déjà après quelques minu-
tes, une représentation très sensible
de l’œdème cytotoxique. Cet œdème
correspond très largement à la zone
de nécrose
2
mais peut aussi compor-
ter des lésions réversibles issues de
la pénombre. La diérence entre les
anomalies de diusion et de perfusion
est appelée mismatch. Ce dernier re-
ète le degré de la pénombre. Le con-
cept de mismatch diusion-perfusion
présente quelques inexactitudes mais
il s’est tout de même imposé comme
une aide décisionnelle majeure pour
un éventuel traitement thrombolytique
dans une fenêtre thérapeutique de 3-6
heures après le début des symptô-
mes. L’angiographie par temps de vol
(TOF - « time of ight ») permet une re-
présentation des vaisseaux sensibles
aux ux, sans injection de produit de
contraste. Le protocole d’exploration
par IRM devrait comprendre : DWI, sé-
quence pondérée en DP/T2, TOF arté-
riel, perfusion, angio-RM avec produit
de contraste et séquence pondérée
en T1 après injection de produit de
contraste (Fig. 2). En complément, des
séquences de susceptibilité magné-
tique (T2*) sensibles au sang ou une
séquence FLAIR (« uid attenuated
inversion recovery ») peuvent être pra-
tiquées.
TDM ou IRM ?
En principe, à la fois la TDM (muti-
modale) et l’IRM fournissent su-
samment d’informations pour ré-
pondre aux questions pertinentes
en cas d’un AVC aigu. La disponibi-
lité de chacune de ces techniques
et l’expérience que possède chaque
centre sont décisifs. Une exploration
initiale par IRM présente néanmoins
certains avantages : la DWI permet
une représentation sensible très
précoce du parenchyme cérébral is-
chémique et est supérieure à la TDM
à cet égard. Par ailleurs, les infarctus
lacunaires récents sont représentés
avec plus de certitude. Grâce à l’IRM
de perfusion, une représentation de
l’ensemble du parenchyme céréb-
ral peut être obtenue alors que la
TDM de perfusion ne montre qu’un
volume de quelques centimètres
d’épaisseur. L’IRM est équivalente à
la TDM pour visualiser les hémorra-
gies aiguës et même supérieure en
cas d’hémorragies chroniques. L’IRM
montre une plus grande sensibilité
en cas de lésions au niveau de la fo-
sse crânienne postérieure. En outre,
les patients n’ont pas à supporter les
contraintes liées aux rayons ionisants
et à l’administration de produits de
contraste iodés.
En raison de ces avantages, l’IRM
est de plus en plus employée en tant
que modalité d’imagerie médicale de
première intention. L’IRM fournit sou-
vent des informations supplémen-
taires sur l’étendue et l’ancienneté
de l’infarctus, qui sont utiles pour la
prise de décisions quant à un traite-
ment interventionnel.
Parmi les inconvénients de l’IRM -
gurent la complexité à pratiquer cet
examen ainsi que les mesures de
surveillance onéreuses à appliquer
chez les patients agités ou nécessi-
tant une surveillance. Pour l’IRM, la
durée d’examen est d’env. 15 minu-
tes, ce qui est supérieur aux 5 minu-
tes nécessaires pour la TDM, durée
à laquelle il faut à chaque fois ajou-
ter les changements de position du
patient, le traitement des données
et la reconstruction des images.
A : TDM crânienne sans injection de
produit de contraste : représentation
hyperdense du segment M1 gauche
(„hyperdense media sign“).
B : Angioscanner : après naissance des
branches lenticulostriées, perte du
contraste dans les portions centrale
et distale du segment M1 de l’artère
cérébrale moyenne gauche.
C : TDM de perfusion : allongement du MTT
(mean transit time) dans le cortex fronto-
pariétal et la substance blanche sous-
corticale mais pas dans les ganglions de la
base gauche. (Figure en couleur sur : www.
neurology.ch)
Fig. 1 :

3
09.1
La neuroréhabilitation multidiscipli-
naire constitue un pilier essentiel
dans un concept thérapeutique com-
plémentaire complet. Une évaluation
et une instauration précoces de me-
sures de réhabilitation, un traitement
intensif et l’initiation cordonnée de
thérapies multidisciplinaires par une
équipe spécialisée sont déterminants
pour le succès de la réhabilitation.
« Rescue and Recovery »
Alors que le traitement aigu de
l’infarctus cérébral vise principale-
ment à prévenir ou à minimiser les
lésions cérébrales structurelles (« res-
cue »), la neuroréhabilitation a pour
objectif de favoriser la récupération
(« recovery ») des fonctions cérébra-
les et de minimiser les répercussions
sur les activités personnelles et la vie
sociale. Ces interventions constituent
aujourd’hui la composante essentiel-
le d’un concept thérapeutique com-
plémentaire complet qui, dans le cas
idéal, se poursuit de la phase aiguë
jusqu’à la réintégration. Ce concept
se base sur le modèle biopsychoso-
cial de la classication internationale
du fonctionnement, du handicap et de
la santé de l’OMS (International Classi-
cation of Functioning, Disability and
Health - ICF). Il enrichit la notion bio-
médicale classique (maladie, patholo-
gie, trouble fonctionnel) par la prise
en compte des répercussions d’une
aection sur les activités personnelles
et la vie sociale tout en considérant
des facteurs contextuels majeurs.
Base théorique de la récu-
pération fonctionnelle
Après une lésion cérébrale se pro-
duit une adaptation fonctionnelle
du pattern d’activation corticale. En
raison de la décience de certaines
aires cérébrales, les fonctions aec-
tées doivent être prises en charge
par d’autres aires. Cette « reprogram-
mation » est rendue possible par un
entraînement actif spécique : en plus
des aires cérébrales à proximité immé-
diate des aires touchées, des aires de
l’hémisphère sain controlatéral sont
également sollicitées. Ces processus
de réorganisation d’abord compensa-
toires puis par la suite toujours plus
fonctionnels peuvent être observés au
moyen de l’IRM fonctionnelle et des
potentiels évoqués moteurs. Relative-
ment récemment, il a été découvert
qu’un infarctus cérébral unilatéral
entraînait un déséquilibre entre les hé-
misphères cérébraux : l’hyperactivité
résultante de l’hémisphère non touché
a un impact négatif sur la fonction et la
récupération.
Neuroréhabilitation
multidisciplinaire
Dans la présentation du traitement
aigu de l’infarctus cérébral paru dans
un précédent numéro (Neurology.ch
06.2), l’importance des unités neuro-
vasculaires avait déjà été soulignée.
En plus de la prise en charge inter-
disciplinaire spécialisée, un avantage
majeur du concept d’unité neurovas-
culaire réside dans l’instauration pré-
coce de mesures de réhabilitation.
L’initiation coordonnée de mesures in-
terdisciplinaires de réhabilitation par
une équipe spécialisée s’est avérée
nettement supérieure par rapport à un
encadrement plus tardif dans une uni-
té non spécialisée. Le déroulement est
structuré sur la base d’un cycle de ré-
habilitation clairement déni, avec des
objectifs spéciques et des concerta-
tions d’équipe régulières intégrant le
Neuroréhabilitation après infarctus cérébral
Fig. 2 :
A : DWI : diusion limitée dans la tête
du noyau caudé, le putamen et la capsu-
le interne gauche.
B : Cartographie du coecient appa-
rent de diusion (CAD) : valeur CAD
diminuée de plus de 50 % dans la zone
de diusion limitée.
C : Perfusion : allongement du MTT
dans l’ensemble du territoire de l’artère
cérébrale moyenne gauche.
D : Signal hyperintense en séquence
pondérée T2 et tuméfaction débutante
des ganglions de la base et de l’insula.
E : TOF artériel : interruption du signal
dans le segment M1 proximal.
F : Angio-RM : contraste correct des
vaisseaux cervicaux.

409.1
Pzer AG
Aricept
®
(donépézil) : traitement
de 1ère intention de la maladie
d’Alzheimer
Aricept
®
, inhibiteur sélectif de
l’acétylcholinestérase, a fait ses preu-
ves dans le traitement de la maladie
d’Alzheimer : il permet une stabilisa-
tion des fonctions cognitives, le main-
tien des gestes de la vie quotidienne
et une réduction des troubles du com-
portement. Le recours à Aricept
®
ent-
raîne un report de presque deux ans du
placement en EMS, ce qui représente
une épargne considérable si l’on consi-
dère les coûts de la santé publique. En
réduisant l’ampleur des soins, le traite-
ment par Aricept
®
soulage également
les proches des malades.
Edité en collaboration avec la Société Suisse de
Neurologie. Comité consultatif de rédaction :
Pr Dr C. Bassetti, Pr Dr Ch. Hess, Pr Dr L. Kappos,
Dr P. Myers, Pr Dr A. Schnider, Dr M. Wiederkehr ;
rédaction : S. Jambresic
Edition:
IMK Institut pour la médecine et la communication
SA, Münsterberg 1, 4001 Bâle, [email protected]
Parution: 6 x par an
ISSN 1661-4860 © IMK
Les noms de marque peuvent être protégés par le
droit des marques, même si l’indication correspon-
dante devait faire défaut. Aucune garantie n’est
donnée en ce qui concerne les indications relatives à
la posologie et à l’administration de médicaments.
Avec l’aimable soutien de
Merck Serono (division de Merck (Suisse) SA),
CSL Behring, Pzer AG, UCB-Pharma AG.
Les sponsors n’exercent aucune inuence sur le
contenu de la publication. Ils peuvent faire paraître de
brefs communiqués sous la rubrique Pharmanews.
Edition n° 1, vol. 4, mars 2009
Tous les textes publiés sous la rubrique Pharmanews sont des
armations émanant de l’industrie.
Merck Serono
Traitment à long terme de la
sclérose en plaques
Nouveau: désormais, Rebif Nouvelle
Formulation est disponible et remp-
lace le Rebif actuel. Il ne contient pas
de serum-albumine humaine, présen-
te une meilleure tolérance cutanée lo-
cale et une immunogénicité reduite1.
Des symptômes pseudo-grippaux peu-
vent être traités par des analgésiques
antipyrétiques
2
.
Giovannoni G. et al. Multiple Sclerosis 1.
2009; 15: 219-228.
Compendium suisse des médicaments 2.
2009.
patient. Grâce à cette neuroréha-
bilitation structurée, il est possible
d’obtenir une réduction signicative
de la mortalité, du placement en in-
stitution et de la dépendance.
Après un AVC, les mesures de réha-
bilitation devraient être instaurées
rapidement, après avoir évalué, à la
phase précoce, les risques individu-
els liés aux processus physiopatho-
logiques. Dans la majorité des cas,
une mobilisation croissante et un
entraînement actif devraient déjà
être possibles quelques jours après
un infarctus cérébral, ce qui accé-
lère la récupération et permet une
réduction signicative des séquelles
à long terme et des limitations en
termes d’activité et de participation.
Ces eets positifs sont indépen-
dants du degré de sévérité et de
l’âge. Pour cette raison, une telle
neuroréhabilitation spécialisée de-
vrait être envisagée précocement
chez tous les patients victimes d’un
accident vasculaire cérébral.
Concepts thérapeutiques
spécifiques et développe-
ments novateurs
Les concepts thérapeutiques ac-
tuels reposent sur un entraîne-
ment individualisé orienté vers les
tâches et le quotidien, se dérou-
lant dans des conditions propices à
l’apprentissage. Pour y parvenir, la
condition de base reste un entraîne-
ment le plus intense et actif possible
des fonctions perturbées et la mise
en pratique de ces exercices dans
les activités quotidiennes. Grâce
aux connaissances récentes sur
l’inhibition interhémisphérique, un
nombre croissant d’approches thé-
rapeutiques visent à compenser ou
réduire ce déséquilibre. La thérapie
par contrainte induite (« constraint-
induced training » - CIT), qui consiste
à immobiliser la main saine au moyen
d’une attelle ou d’un plâtre, permet à
la fois d’inhiber l’hémisphère sain hy-
peractif par inactivation et d’activer
l’hémisphère lésé par une utilisation
forcée. Des eets similaires peuvent
être obtenus par stimulation mag-
nétique transcrânienne répétitive :
la stimulation facilitatrice à haute
fréquence de la région cérébrale
touchée et la stimulation inhibitrice
à basse fréquence (ou Theta-burst)
de l’hémisphère sain controlatéral
peuvent améliorer la récupération
fonctionnelle. Une autre possibilité
de moduler l’activité corticale est la
stimulation transcrânienne à courant
continu (« transcranial direct current
stimulation » - tDCS) qui, en fonction
de la polarisation (anodique ou ca-
thodique), permet une stimulation
ou une inhibition de l’aire cérébrale
correspondante. Ces techniques per-
mettent non seulement d’améliorer
les fonctions motrices mais elles
peuvent également être utilisées pour
corriger les troubles de la percepti-
on (par ex. négligence). Même si ces
techniques ne sont pas encore utili-
sées en routine, elles pourront peut-
être considérablement améliorer la
plasticité corticale et donc le suc-
cès du traitement dans le futur. Les
formes d’entraînement robotisé ou
assisté par ordinateur sont d’autres
innovations techniques importantes,
qui pourraient contribuer à élargir
les possibilités de réhabilitation. Les
développements techniques, la mise
au point de nouveaux concepts de
réhabilitation ainsi que la meilleure
sélection des sous-groupes appro-
priés devraient à l’avenir permettre
de mieux spécier les possibilités
de réhabilitation. De cette façon, le
recours aux diérentes ressources
devrait devenir plus ecace et plus
économique.
Bibliographie : www.neurology.ch
1
/
4
100%