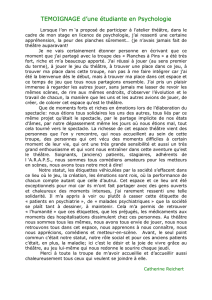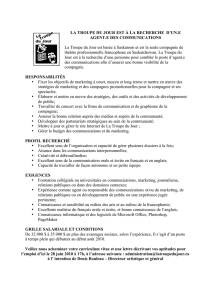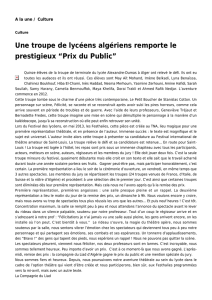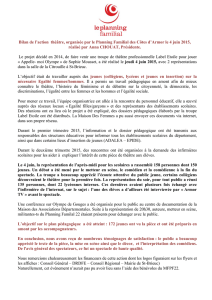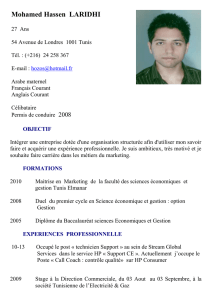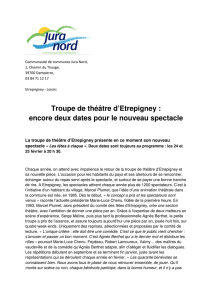Histoire des troupes - Théâtre de Cornouaille

Histoire des troupes
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SAISON 2013-24
Dossier réalisé par Laurence Périn
conseiller relais pour les enseignants en collaboration avec le Théâtre de Cornouaille
CONTACTS
DAVID GUYARD Chargé des actions éducatives | david.guyard@theatre-cornouaille.fr
LAURENCE PÉRIN Conseiller relais pour les enseignants | laurence.perin@theatre-cornouaille.fr
THEATRE DE CORNOUAILLE CENTRE DE CRÉATION MUSICALE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER // DIRECTION FRANCK BECKER
1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55 // contact@theatre-cornouaille.fr WWW.THEATRE-CORNOUAILLE.FR
Ariane Mnouchkine | Théâtre du Soleil

ThéâtredeCornouaille1
Petite histoire des troupes de théâtre
I. La notion de troupe - Qu’est-ce qu’une troupe de théâtre ?
En guise d’introduction : quelques définitions
Commençons par définir la notion de troupe… s’il on en croit le dictionnaire du
théâtre de Michel Corvin, on peut ainsi distinguer compagnie et troupe :
Troupe de théâtre. Groupe de comédiennes et comédiens réunis de
façon relativement artisanale autour de projets de représentation. La
troupe est le plus souvent solidaire et parfois entretenue par un
mécène, une communauté, une famille.
Compagnie de théâtre. Société de production dont les statuts sont
généralement soumis aux lois du commerce (avec conseil
d’administration, exécutif, etc.). le choix des pièces revient
généralement à une direction artistique et l’embauche varie avec la
distribution.
Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Michel CORVIN, éd. Bordas, 2008.
On note d’emblée l’aspect familier de la troupe : l’artisanat qui préside à la réunion
des comédiens marque à la fois la simplicité et le caractère un peu fragile et aléatoire
de leur lien. Par ailleurs, la dimension économique, donc la question d la viabilité de
la troupe fait partie intégrante d la définition. Cette caractéristique vaut plus encore
pour la compagnie, qui se distingue par aspect plus structuré et conditionné.
Le Théâtre du Soleil propose aussi sa définition…
Par troupe, nous entendons trois choses qui distinguent de la notion de
compagnie :
- être nombreux sur le plateau,
- se projeter ensemble dans une aventure commune pour plus d’un
spectacle,
- travailler dans un esprit « d’école permanente » en se stimulant les
uns les autres.
La troupe prend ici une dimension plus politique : le collectif y est énoncé comme la
valeur-clé. Cette affirmation est répétée dans chaque postulat de la définition. La
troupe s’inscrit aussi dans la durée, ce qui la distingue fondamentalement de celle
définies précédemment.

ThéâtredeCornouaille2
Petite histoire des troupes de théâtre
Parler de “troupe théâtrale” au sens actuel du terme avant l’avènement de la
commedia dell’arte est un peu hors de propos.
L’idée d’un “groupe théâtral” naît cependant dès l’antiquité.
1. La troupe antique...
Ainsi, en Grèce, on peut évoquer de petites formations artistiques placées sous la
direction de leur acteur principal, protagoniste, “metteur en scène” et parfois auteur.
Une troupe compte alors trois acteurs en tout, dits hypocritès, littéralement “qui
répond(ent) au choeur” avant de dialoguer avec lui, puis entre eux. C’est ici le métier,
l’ancienneté et la reconnaissance publique qui désignent le dirigeant du groupe.
Les acteurs constituent aussi des groupes “institutionnels”, ils sont fédérés dans des
associations garantes d’une certaine qualité de représentation et qui s’emploient à
préserver les valeurs d’un théâtre essentiellement religieux.
À Rome, certains acteurs se distinguent individuellement et peuvent être adulés au
même titre que des gladiateurs par exemple, mais le lot du plus grand nombre est de
travailler sous les ordres d’un “dominus gregis” qui les instruit avant de les diriger
dans leur jeu. Les acteurs sont des professionnels, esclaves ou affranchis, qui n’ont,
de fait, aucun autre pouvoir que celui de se soumettre aux indications scéniques de
leur maître...
2. La troupe médiévale...
Au Moyen-Âge, le théâtre devient affaire de corporations et pour la première fois,
d’étudiants :
Le théâtre est d’abord religieux : les acteurs sont des amateurs, clercs et laïcs,
parfois issus de la bourgeoisie qui se rassemblent pour interpréter des mystères.
L’autorité revient là encore au meneur de jeu, indépendamment de son rang social,
et non, comme on aurait pu l’imaginer, à un “ancien” ou à un notable...
Paradoxalement, le fait que ces groupes interprètent des pièces d’inspiration
religieuse leur garantit une certaine liberté d’action : le canevas du mystère est sans
doute assez contraignant pour qu’aucun débordement ne soit à craindre ! (idée dont
le bien-fondé sera bien vite mis à mal , voir plus bas).
Parallèlement au développement du théâtre religieux, un théâtre profane foisonnant
voit le jour : des étudiants (en droit) montent à leur tour sur les tréteaux pour y
représenter moralités et sotties. La contestation, la revendication sont autant
d’affirmations d’indépendance. Peut-être en réaction à la basoche, dont elles
émanent, et qui est fortement organisée et hiérarchisée autour d’un roi et de son
gouvernement, ces compagnies sont libertaires et aucune hiérarchie prédéterminée,
aucune structure préétablie n’y prévaut donc. Ces groupes bénéficient parfois de

ThéâtredeCornouaille3
l’appui bienveillant des autorités des cités qui les accueillent. Celles-ci ne s’octroient
pour autant pas de pouvoir de contrôle sur les productions de ces groupes.
Le théâtre profane n’est cependant pas vraiment du goût des autorités religieuses et
les acteurs font fréquemment l’objet de poursuites et de rejet.
C’est pourtant le théâtre religieux qui, le premier, fera les frais de cette vindicte.
Ainsi, ce sont des écarts avec la morale, répétés et notoires, si l’on en croit le
Parlement de Paris, qui, en 1542, font interdire les représentations des Confrères de
la Passion, une des compagnies les plus emblématiques (fondée en 1402),
précipitant par là-même la fin du théâtre religieux. Les Confrères de la Passion
continueront cependant à exercer un rôle et une vraie autorité sur le théâtre et la vie
des troupes à venir, puisque leur lieu de représentation attitré, l’Hôtel de Bourgogne
(encore unique théâtre “en dur” de l’époque), qu’ils continueront à contrôler jusqu’en
1676, sera désormais loué aux troupes (profanes) de passage.
Dans le même temps, la défiance de l’Église redouble. Les acteurs sont rattrapés par
l’image ambivalente qui les caractérisait déjà durant l’antiquité : fascinants
“menteurs”, ils suscitent tout autant l’admiration que la méfiance et les troupes
doivent compter sur la protection de l’un et redouter l’hostilité de l’autre.
L’errance, la précarité qui résultent de cette situation modifient durablement la façon
de vivre des acteurs, les liens qui les unissent au sein d’une troupe et aussi les
rapports qu’ils ont avec celui qui les dirige...
3. Les prémices de l’Âge Classique
Le XVIIème siècle voit l’avènement d’une nouvelle forme de troupe : la compagnie
familiale. Ce genre de formation naît en Italie, sous l’impulsion de la commedia
dell’arte. Ces troupes jouissent de la faveur du public tout autant que de la protection
des grands. Elles peuvent donc connaître une certaine prospérité. Les directeurs de
ces troupes sont à la fois auteurs, acteurs et metteurs en scène. L’exemple le plus
emblématique est sans doute celui des “Gelosi” (les “Jaloux”) à l’origine de laquelle
on trouve le couple Isabella Canali (1562-1604) et Francesco de Cerrachi de Pistoia
(1548-1624) plus connus sous les noms d’Isabella et Francesco Andreini. Leur
troupe vint en France en 1603 et Isabella fut alors la première femme à monter sur
les planches parisiennes. L’un de leurs fils, Giambattista, fonda à son tour une
troupe sur un modèle comparable, les “Fideli” (à la cause des Gelosi) eux-mêmes à
l’origine des “Comédiens Italiens” qui partagèrent le Petit-Bourbon avec Molière, à
partir de 1658...
Le modèle “familial” s’est en effet aussi imposé en France : les troupes se fédèrent
autour de véritables dynasties de comédiens. La direction de ces formations est le
plus souvent assurée par un des membres de la famille fondatrice.
Par exemple :
- les Baron - André Baron 1600-1655, son fils Michel 1653-1729, son petit-fils
Étienne 1676-1711, ses arrière-petits-enfants !...

ThéâtredeCornouaille4
- les Béjart - Joseph 1616-1659, ses soeurs Madeleine 1618-1672 et Geneviève
1624-1675, leur frère Louis 1630-1678, ou encore Armande, fille ou soeur de
Madeleine 1640-1700...
Des troupes comparables sillonnent l’Angleterre, connaissant les mêmes conditions
de vie précaires, les mêmes vicissitudes. Comme en France, l’édification de théâtres
“en dur” apporte une forme de sécurité aux acteurs : Le premier sera The Theatre,
des Leicester’s men, dont la construction, à la périphérie de Londres, avait été
autorisée par Elisabeth Ière en 1574. Les troupes se placent sous la protection des
grands dont elles adoptent le nom et parfois l’autorité morale. Ainsi les Burbage,
James et son fils Richard, fondent le théâtre The Globe, où officiera la troupe des
Chamberlain’s men, rebaptisée King’s men, en 1603, lorsqu’elle obtient le parrainage
de Jacques Ier ou les Admiral’s men rivaux des précédents, au théâtre The Rose...
Mais ce très relatif confort se paie cher : les troupes doivent répondre aux exigences
des propriétaires (souvent auteurs) qui les habilitent, et restent vulnérables aux
crises puritaines qui agitent leur pays. Ce qui explique notamment la fermeture des
théâtres entre 1642 et 1660, par exemple.
En Allemagne, ce sont, à l’instar des Comédiens Italiens en France, des troupes
ambulantes anglaises, sous la direction d’un bouffon, qui parcourent le pays durant
toute la deuxième partie du XVIème siècle. Ces formations perdent peu à peu leur
intention de diffuser le théâtre anglais pour préférer des pièces farcesques inspirées
de l’actualité. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le théâtre allemand se dotera d’un
théâtre fixe (1751), au château de Schwerin, où le comédien Konrad Ekhof (1720-
1778) fera travailler des acteurs avec discipline et professionnalisme. Il y fondera
d’ailleurs la première école dramatique du pays en 1753.
4. Les grandes troupes du XVIIème siècle : L’aventure de l’Illustre Théâtre
C(=’est dans l’enthousiasme de la jeunesse que naît cette troupe, sous l’impulsion de
Molière et de Madeleine Béjart. Elle est la seule, parmi les dix membres fondateurs,
à être déjà montée sur les planches.
Le 30 juin 1643 est établi le contrat de société fondant « L’Illustre Théâtre ». On y
trouve, outre celles de Molière et de Madeleine Béjart, les signatures de Denis Beys,
qui quitte ainsi la librairie paternelle, de Germain Clérin, futur chef de la troupe de
Gaston d’Orléans, de Joseph Béjart, de Nicolas Bonenfant, dit « Croisac », à l’origine
clerc de procureur passionné de théâtre, de Georges Pinel, dit « La Couture », qui,
plus âgé que Molière, lui a jadis donné des leçons d’écriture, de Madeleine Malingre,
de Catherine des Urlis, dont tous les frères et sœurs sont comédiens, ainsi que celle
de Geneviève Béjart, plus effacée que sa sœur et que son frère Joseph, mais fidèle
à la troupe et au théâtre qu’elle n’abandonne qu’à la mort.
Molière fait partie de diverses troupes tout au long de sa carrière, et il en est toujours
le chef, qu’il s’agisse de l’Illustre Théâtre de ses débuts, de celle du duc d’Epernon,
de celle de Monsieur qui devient ensuite Troupe Royale. Les comédiens de Molière
font plus que vivre en bonne intelligence, ils sont de véritables amis, ne serait-ce que
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%