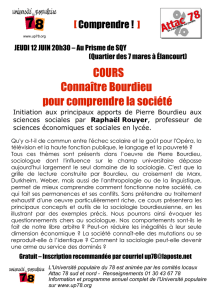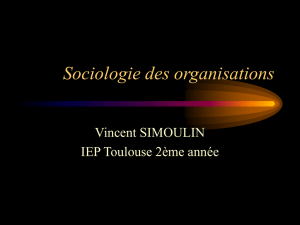GEMASS Raymond Boudon

GEMASS
GROUPE D’ÉTUDE DES MÉTHODES DE L’ANALYSE SOCIOLOGIQUE DE LA SORBONNE
Raymond Boudon
entretien avec Brigitte Mazon, Directrice des Archives à l’EHESS
Paris, le 27 janvier 2012
Brigitte M – Je souhaite interroger l’homme singulier, Raymond Boudon, dans le contexte des institutions
d’enseignement et de recherche. Vous avez eu une trajectoire de chercheur, une carrière de professeur, j’aimerais
savoir comment vous, Raymond Boudon, en tant qu’individu singulier, vous vous êtes adapté aux institutions,
elles vous ont formé, vous vous êtes éventuellement identié à celles qui vous ont accueilli, ou vous avez résisté
peut-être par moment. Quel a été le sens de votre action individuelle dans ces institutions ? Chronologiquement,
en commençant par la thèse, le choix du sujet, sa direction, le rituel de la soutenance.
Raymond B – Deux personnages ont joué un grand rôle au début de ma carrière : Jean Stœtzel
et Paul Lazarsfeld, qui est sans doute le sociologue contemporain que j’aurai le plus admiré dans ma vie. J’ai fait
des études de philosophie. J’ai beaucoup hésité entre les sciences et la philosophie. Comme il faut bien choisir,
je me suis orienté vers les études littéraires et ai été admis en khâgne à Louis-le-Grand. La philo et l’histoire-
géographie étaient les seules sciences humaines reconnues à l’époque. J’ai eu très rapidement un sentiment
d’insatisfaction s’agissant de la philosophie. Les philosophes d’alors avaient tendance à ne s’occuper que
de l’histoire de la philosophie. De l en aiguille j’ai perçu un peu la sociologie comme étant une philosophie,
mais qui s’intéresserait au monde moderne, au monde concret, à la diérence de la philosophie telle qu’elle était.
BM – Vous suiviez les cours de la Sorbonne ?
RB – Oui, j’ai suivi les cours de la Sorbonne, mais Georges Gurvitch m’a collé deux fois à la licence. Il avait une
théorie de ce qu’il appelait « les paliers en profondeur de la réalité sociale ». La diculté, c’est qu’il découvrait
constamment des paliers nouveaux. Il me manquait toujours un palier.
BM – Gurvitch régnait sur la sociologie ?
RB – Il avait la seule chaire de sociologie à la Sorbonne, dirigeait la seule collection de livres de sociologie
aux Presses Universitaires de France, la « Bibliothèque de sociologie contemporaine ». Il présidait à la seule
revue de sociologie orissante à cette période, les Cahiers internationaux de sociologie. Il régnait en despote sur
la sociologie française.
BM – Il y a eu la soutenance célèbre de Touraine avec Gurvitch dans son jury. Vous y étiez ?
RB – Oui. J’ai été surpris et choqué par le côté théâtral des interventions des membres du jury, y compris
par celle de Stœtzel, que j’admirais. Stœtzel occupait une chaire de psychologie sociale à la Sorbonne, qui avait
été créée pour lui. Il m’a dit une fois « je préférerais perdre mon portefeuille que perdre mes notes de cours
». Il était très rigoureux dans ses cours, toujours très documentés, comme son cours de sociologie historique
du vêtement.
BM – Vous étiez donc attiré par quelque chose de très concret, alors que votre thèse était très abstraite ?
RB – J’en suis venu au sujet de ma thèse par des chemins de traverse. J’avais un temps hésité entre l’économie
et la sociologie et avais cherché pour cette raison à me perfectionner en mathématiques. J’étais un peu comme
1

l’âne de Buridan, qui n’arrivait pas à choisir entre deux sacs de son. J’ai coné mes hésitations à Raymond Aron,
qui avait dirigé mon Diplôme d’Études Supérieures (l’étape qui suivait alors la licence). Aron m’a répondu :
« il y a beaucoup d’économistes, faites donc plutôt de la sociologie, le terrain est moins occupé ». J’ai suivi
son conseil et, lorsqu’il s’est agi de dénir un sujet de thèse, je me suis tourné vers Paul Lazarsfeld, qui,
connaissant mon parcours, m’a suggéré de chercher à faire le bilan des apports des mathématiques à la sociologie.
BM – C’est donc Raymond Aron qui a inuencé votre choix ? Si Gurvitch régnait sur la sociologie universitaire,
Raymond Aron avait des moyens nanciers, grâce à la Fondation Ford. Il mettait en place les enquêtes
du Centre de sociologie européenne.
RB – Exactement. Et je m’y suis trouvé directement impliqué. Un jour, Pierre Bourdieu m’appelle pour me dire
que Raymond Aron avait de l’argent de la Fondation Ford pour faire une enquête sur les mineurs du Nord,
à Ostricourt. Bourdieu m’a dit que ça ne l’intéressait pas et m’a demandé si je voulais la prendre en charge.
J’y ai vu l’occasion de rentrer dans l’univers de la recherche. J’ai éprouvé beaucoup de satisfaction à me trouver
engagé dans une enquête de terrain et à découvrir les mécanismes d’intégration des mineurs d’origine polonaise
à la société française. Nous étions trois chercheurs sur le terrain. Nous logions chez l’habitant. L’une d’entre nous
s’appelait Anni Horine et s’appelle maintenant Mme Borzeix.
BM – Anni Borzeix, nous la connaissons, elle nous donne ses archives. J’ai pris le rapport hier à la bibliothèque.
« Ostricourt : préenquête »
RB – Le troisième homme était Henri Majewski, qui est mort peu après d’un accident de voiture.
BM – Et Bourdieu, qui était à Lille à ce moment-là, n’a pas voulu participer.
RB – Non, il avait d’autres idées en tête.
BM – Il rentrait d’Algérie… Bourdieu était un peu plus âgé que vous ?
RB – Oui, je suis de 1934, il devait être de 1930. Il était alors assistant de Raymond Aron.
BM – Votre premier poste ensuite a été à Bordeaux ?
RB – Oui. J’y ai remplacé François Bourricaud, à titre temporaire d’abord. Il avait été invité à Harvard
par Talcott Parsons, avec qui il était très lié. Puis il a été élu à Nanterre. Je me suis présenté à sa succession,
sur le conseil de Stœtzel. C’était l’époque où trois personnes faisaient la pluie et le beau temps en sociologie :
Aron, Stœtzel et Gurvitch. Ils se détestaient cordialement. Je me souviens qu’un jour où, jeune professeur,
je présidais un jury de thèse, j’avais Aron à ma droite et Stœtzel à ma gauche. Pendant l’intervention d’Aron,
Stœtzel se penche vers moi et me susurre : « c’est de l’idéologie ». Au cours de l’intervention de Stœtzel,
Aron me glisse : « il recommence son numéro ». Stœtzel était à la fois un universitaire, un homme d’aaires
et un homme de décision. Il dirigeait l’IFOP, qu’il avait fondé, ociait à la Sorbonne et occupait plusieurs fonctions
de responsabilité dans des instances nationales et internationales dédiées au développement des sciences
humaines. N’ayant pas le temps de lire les thèses, il se justiait en déclarant que toute thèse, étant le fait
d’un apprenti, était nécessairement mauvaise et il sortait à chaque soutenance le même discours passe-partout :
« Une thèse doit être un modèle, etc. ». La rumeur veut qu’il ait toujours eu une piètre opinion de sa propre thèse
sur La éorie des opinions, qui mérite pourtant toujours d’être lue.
BM – Aron prenait-il le temps de lire les thèses ?
RB – Il les lisait très vite. Mais c’est qu’ils n’étaient que trois à siéger dans tous les jurys. Dans les années
suivantes, les choses ont changé. Les recrutements d’enseignants se sont multipliés et des étudiants de plus
en plus nombreux furent attirés par la sociologie. Je me souviens qu’un collègue à la Sorbonne dirigeait cent
thèses dans les années 1960, et s’en attait !
2

BM – Vous avez soutenu votre thèse avec qui ?
RB – Avec Stœtzel, sur L’Analyse mathématique des faits sociaux. Conformément au diagnostic de Stœtzel,
c’est une mauvaise thèse, mais je me suis beaucoup instruit en la préparant.
BM – Elle vous a permis d’être nommé très jeune à la Sorbonne.
RB – Oui, à 33 ans. Aron me bizuta en me donnant la responsabilité des enseignements de première année.
J’ociais dans le grand amphi de Censier, avec retransmission dans d’autres amphis.
BM – Le cours ex cathedra…
RB – Oui, j’ai vite compris que l’exercice consistait surtout à ne pas buter sur les mots.
BM – En 1967 donc.
RB – Oui, jusqu’en 1968, où tout s’arrête. J’avais toujours eu une grande admiration pour Flaubert et 68
m’a vite rappelé Frédéric Moreau et l’ouvrier mexicain de L’Éducation sentimentale qui, au cours
d’une assemblée générale, d’une « AG », disait-on en 68, propose de délivrer les diplômes au surage universel.
J’ai eu le sentiment de voir les institutions se détruire en profondeur. Mon expérience à l’Université
de Fribourg en Brisgau et à Columbia m’avaient fait comprendre que l’université était le produit
d’une longue histoire. J’estimaisqu’il était dangereux de détruire une institution reposant sur un aussi long passé.
BM – Et à cette époque, Bourdieu venait juste d’écrire Le Métier de sociologue que vous aviez eu entre les mains,
j’imagine, et Touraine était à Nanterre aux côtés de Cohn-Bendit.
RB – J’ai eu Cohn-Bendit comme étudiant. Alain Touraine m’avait demandé d’assurer un cours de méthodologie.
J’avais la réputation d’avoir le monopole du savoir dans ce domaine. Cohn-Bendit m’a donné l’impression
à travers ses questions d’un étudiant posé et intelligent.
BM – Touraine nous en a parlé. Goulven a collecté les archives du CADIS… Quant à Bourdieu, avec la parution
de son Métier de sociologue ?
RB – J’ai trouvé à l’époque que Bourdieu était quelqu’un de plutôt sympathique. Mais très tôt je l’ai perçu
comme n’ayant pas un esprit scientique. Mon maître Paul Lazarsfeld avait inauguré sa carrière à Vienne
par une thèse sur le périhélie de Mercure, s’appuyant sur la théorie de la relativité. Il est venu aux sciences
sociales après, mais il avait gardé de sa formation scientique une rigueur implacable, qui se mélangeait
avec un humour juif viennois légendaire. Lazarsfeld, c’était l’homme des enquêtes rigoureuses, des mathématiques
appliquées aux sciences sociales. Il était un redoutable patron de thèse. Il a fait refaire trois fois sa thèse à un ami
américain pour nalement lui refuser l’accès à la soutenance.
BM – C’était injuste à votre avis ?
RB – La thèse témoignait d’une certaine confusion. Paul Lazarsfeld en rajoutait probablement un peu
sur la rigueur, parce qu’il lui fallait se montrer à la hauteur aux yeux de ses collègues américains. Il avait eu
des débuts de carrière diciles aux États-Unis. En ce qui me concerne, j’avais adopté les valeurs que
Paul Lazarsfeld m’avait mises en tête. Aussi me suis-je senti immédiatement éloigné de Bourdieu dès lors
que j’ai constaté qu’il retenait les coecients de corrélation qui l’arrangeaient et négligeait les autres.
BM – Mais il faisait des enquêtes ?
RB – Oui, il faisait des enquêtes qui avaient l’apparence, mais pas la réalité, de la scienticité.
3

BM – Quand Raymond Aron s’est séparé de lui, il a été très fairplay avec l’argent de la Fondation Ford
qu’il a laissé à Bourdieu pour mener les enquêtes entreprises que lui, Raymond Aron, n’avait aucune envie
de mener lui-même. Bourdieu a fait ces enquêtes. Et il avait toute une équipe avec lui.
RB – Il a toujours eu un sens de l’organisation et beaucoup de talent, quoique littéraire plutôt que scientique.
Surfant sur la vague structuraliste, il a défendu mordicus la thèse que les structures sociales ont un eet
déterminant sur le comportement de l’individu. L’homo sociologicus de Bourdieu est un zombie manipulé
par des habitus, une espèce de virus que, si l’on suit ses analyses, lui inigeraient les structures sociales.
Goulven Le Brech, collaborateur de B. Mazon – Y a-t-il eu des échanges entre vous ?
RB – Peu. Il avait probablement l’impression de vivre dans un monde diérent du mien et réciproquement.
BM – Dans son Esquisse pour une auto-analyse, Bourdieu revient évidemment sur ses origines sociales.
Puis-je me permettre de vous demander les vôtres ?
RB – Mon père a commencé comme magasinier au Printemps, puis il est monté progressivement en grade
et s’est retrouvé nalement responsable d’un large secteur d’achats. Il avait des dons musicaux un peu
exceptionnels et aurait voulu devenir musicien. Il jouait superbement du hautbois, son instrument, mais
tâtait aussi fort bien du violoncelle. Lors de son service militaire, pendant l’occupation de la Rhénanie, il
avait été aecté à un orchestre symphonique. Il était lui-même parisien. Son père et sa mère étaient tous les
deux bretons. Il y avait beaucoup de livres chez mes parents. C’est là que j’ai lu Flaubert, dans la collection
de la Pléiade. S’agissant de la musique, mon père m’a découragé par ses exigences. Je suis très mélomane,
mais pas musicien. Le capital culturel n’est pas passé. Aussi ai-je été surpris que, dans son compte-rendu
de La Sociologie comme science, – une brève autobiographie intellectuelle –, un plumitif m’ait reproché de
méconnaître le dogmedu déterminisme social.
BM – Revenons-en à la Sorbonne, après 1968.
RB – Après l’éclatement de la Sorbonne, je me suis trouvé rattaché à Paris V. Jamais à court d’idées,
Stœtzel voulait y créer un « sociotron », l’équivalent dans son esprit pour les sciences sociales du cyclotron
des physiciens. Il avait fait le calcul qu’en se mariant avec des médecins, on allait avoir de l’argent. Il se faisait
des illusions. Quelques années après, nous eûmes, François Bourricaud et moi, l’impression que la sociologie
de Paris V se dégradait. Les recrutements avaient été nombreux. Comme le département comptait des africanistes,
le général de Gaulle avait poussé à y reclasser de hauts fonctionnaires de retour d’Afrique, bons connaisseurs
de leurs terrains d’origine, mais incultes en sciences sociales. Nous avons donc décidé de proter de la décision
de la Ministre de l’Enseignement supérieur, Alice Saunier-Seïté, de supprimer l’exigence d’exeat. Les philosophes
de Paris IV nous ont alors accueillis à bras ouverts. Maurice Clavelin, certainement l’un de nos meilleurs
historiens des sciences, présidait le département de philosophie. Or il souhaitait en étendre les activités
en y introduisant la sociologie. Le problème, c’était qu’il n’y avait pas au début beaucoup d’étudiants.
Mais progressivement apparurent des étudiants avancés qui visaient un doctorat en philosophie avec mention
sociologie. Puis un DEA de sociologie fut créé, que fréquentèrent de l’ordre de dix, puis de vingt étudiants.
L’une de mes ertés est que sur la centaine d’étudiants que j’aurai eu au total jusqu’à mon départ à la retraite,
pas un seul ne soit resté sur le pavé.
BM – Avez–vous eu Philippe Besnard comme étudiant ?
RB – Non, mais comme collègue, il était au CNRS. J’ai appartenu à son jury de thèse : une thèse sur l’anomie.
Il avait un humour parfois noir. Il a lancé avec succès la sociologie des prénoms. C’était un homme droit
et animé par l’esprit scientique.
BM – Vous avez connu et rencontré beaucoup de monde. Avez-vous un refuge pour écrire ?
4

RB – J’ai un refuge, mais pas seulement pour écrire. J’ai beaucoup aimé jardiner. À l’origine, nous avons,
ma femme et moi, acheté une ancienne prairie, sur laquelle nous fîmes construire une petite maison normande
à colombages. On y a planté nous-mêmes de nombreux arbres, dont un magnique tulipier. Ils ont maintenant
30 ans et sont grands. J’ai découvert au cours du temps qu’un arbre pouvait mourir comme un homme,
non de mort lente, mais assez brusquement. Un jour où j’ai voulu sottement abattre un arbre encore bien
vivant, la hache a atterri sur mon pied. Cela m’a valu d’être alité pendant un mois. Dans notre refuge normand,
j’étais loin de passer mon temps à écrire. Comme à Paris, j’écrivais très tôt le matin, entre 5 heures et 10 heures
du matin.
BM – D’où vous vient votre aisance en informatique ?
RB – De mon ls. Il dirige un fonds de placement dans le secteur des énergies renouvelables. Il est normalien
et a décroché une agrégation de physique chimie. Encore adolescent, il avait déclaré à ma mère qu’il voulait
depuis toujours devenir un homme d’aaires.
BM – Avez–vous été tenté par le Collège de France ?
RB – Un jour, je suis allé voir Aron rue de Tournon pour lui proposer la publication d’un article
dans les Archives européennes. À ma grande surprise, il me demanda alors tout à trac : « voulez-vous rentrer
au Collège de France ? Si oui, ce sera ma succession ou celle de Lichnerowitz ». Mais, le moment venu, il a passé
un marché avec Bourdieu. J’ai donc renoncé à me présenter et en fus à vrai dire soulagé : habitué à m’adresser
à des étudiants, je me voyais mal discourir devant des publics de passage.
BM – Lucien Febvre, qui était professeur au Collège de France a eu ces mot lors de l’inauguration de la sixième
section de l’École pratique des hautes études, j’aimerais savoir ce que vous en pensez : « La sociologie n’est pas
pour nous une suite d’enquêtes sur le temps présent. La sociologie est à la base d’un humanisme nouveau,
en mettant en lumière les analogies que présentent les diverses sociétés humaines saisies au même stade
de leur développement culturel, elle constitue ces archives de l’humanité dont nos ls auront besoin
pour constituer fortement sur les racines de nos civilisations fragmentaires, l’édice cohérent d’une civilisation
humaine. »
RB – Ce texte résume bien l’essence de la sociologie, dont la méthode de base est eectivement le comparatisme.
Montesquieu l’avait clairement vu, Tocqueville l’a pratiqué, Durkheim n’a pas fait autre chose, Weber non plus.
BM – Et vous non plus.
RB – Eectivement : j’ai appliqué le comparatisme dans mes travaux sur les inégalités et la mobilité sociale,
ainsi que dans mes recherches ultérieures en matière de sociologie des croyances collectives, de sociologie
des valeurs et de sociologie politique. D’autre part, j’ai tenté de montrer qu’il expliquait la puissance des analyses
de Tocqueville, de Durkheim et de Weber.
BM – Ce qui est intéressant c’est l’expression « les archives de l’humanité », c’est ce que nous collectons,
nous, les archivistes, avec les archives des sociologues et ces enquêtes qui laissent des traces. Et cette notion
de « civilisation fragmentaire »…
RB – Je suis tombé récemment sur une maxime de La Rochefoucauld que je n’avais pas repérée jusqu’ici.
Elle représente une superbe invitation au comparatisme : « il y a une innité de conduites qui nous paraissent
ridicules, mais dont les raisons cachées sont le plus souvent fécondes et solides ». Durkheim applique
cette maxime dans son explication par exemple des rituels de pluie. Ceux qui croient à leur ecacité
ne sont pas victimes d’une mentalité primitive mythique. Ils ont des raisons de croire en ce à quoi ils croient.
BM – Je vois qu’on a encore un tas de choses à se dire.
190 avenue de France - CS 71345 - F-75648 - Paris cedex 13
tél 33 (0)1 49 54 21 55 - courriel [email protected] - fax 33 (0)1 42 22 33 66 - http://www.gemass.fr
1
/
5
100%