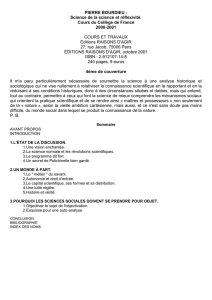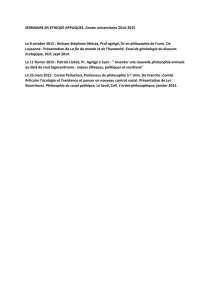Les lieux de l`esprit

Intellectica, 2012/1, 57, pp.
7-19
© 2012 Association pour la Recherche Cognitive.
Les lieux de l’esprit
Introduction au dossier
Pascale GILLOT
,
Guillaume GARRETA
I
NTRODUCTION
Ce numéro réunit les contributions de treize chercheurs en philosophie et
sociologie, élaborées à partir de leurs interventions au colloque « Les Lieux de
l'esprit », tenu les 6 et 7 juin 2009 dans le cadre du Collège International de
Philosophie.
Comme le titre l'indique, c'est la question – persistante – d'une localisation
des phénomènes mentaux en général qui structure ce numéro. Il s'agit là d'une
question récurrente autant que problématique, dans la mesure où elle engage
simultanément le constat d'une inscription de l'esprit dans le monde, inscription
« matérielle » au sens large pourrait-on dire, et l'impératif épistémologique
d'une compréhension de la spécificité conceptuelle des événements mentaux,
de l'activité mentale. Ce problème, toutefois, dans sa formulation initiale, ne
se réduit pas au problème classique du corps et de l'esprit : problème méta-
physique pourrait-on dire, en ce que, historiquement, il se trouve rapporté à un
« dualisme des substances » souvent associé, de façon expéditive, au nom
même de Descartes.
La question initiale donc, celle du « lieu » ou plus précisément des lieux de
l'esprit, s'étend bien au-delà des débats autour du dualisme classique et de de
ses multiples réfutations historiques. Elle constitue une sorte d'invariant
structurel en philosophie et en sciences sociales, puisqu'elle est reliée à un
questionnement général, dans ces champs disciplinaires distincts des « sciences
dures », concernant les modalités d'effectuation de la pensée en général.
Toutefois, elle ne s'entend pas, il faut le préciser, comme une question à propos
du lieu spécifique du mental, qu'il s'agisse du cerveau, ou bien de la chose
pensante immatérielle, ou bien du monde dit extérieur. Autrement dit, elle
s'attache à un réexamen critique des débats internalisme/externalisme,
dualisme/monisme, mentalisme/réductionnisme ; ou, à tout le moins, elle
s'attache à en débusquer certaines impasses, certains postulats non interrogés
1
.
En ce sens, elle sonne également comme une interrogation sceptique, le signe
d'une attention à une difficulté conceptuelle ou grammaticale, dans la lignée de
l'enseignement de Wittgenstein : comment l'esprit pourrait-il avoir un lieu
spécifique ?
Institut d'Histoire de la Pensée Classique, CERPHI, UMR 5037, ENS Lyon.
gillot.pascale<at>wanadoo.fr.
Université Paris-1 et Collège International de Philosophie. garreta<at>univ-paris1.fr.
1
Le débat « Internalisme/Externalisme » en sciences cognitives a déjà fait l'objet d'un numéro
thématique de la revue Intellectica, précisément intitulé Internalisme/Externalisme, 2006/1, n°43.

Pascale GILLOT, Guillaume GARRETA
8
La perspective adoptée dans ce numéro est fortement marquée par l'héritage
d'une philosophie externaliste, ce qui n'interdit pas, bien au contraire, une
interrogation critique à propos de quelques-unes de ses difficultés théoriques
persistantes. Mais sans doute convient-il ici de préciser cette position
externaliste, au-delà du slogan traditionnel : « L'esprit est dehors ». L'on peut
dans ce but s’appuyer sur une distinction explicitée récemment par Andy Clark
sur la manière d’envisager la contribution du corps aux états et aux contenus
mentaux
2
. La compréhension de la relation esprit-corps-monde suppose de
choisir entre deux classes de modèles (ou topiques). On peut soutenir d'un côté
qu’il y aurait une contribution spécifique du corps, de notre corps, dans la
détermination des contenus, états et propriétés mentaux. La présence d’esprits
de type humain dépendrait alors directement de la possession d’un corps de
type humain, pour des raisons physiologiques, historiques ou autres. Mais d’un
autre côté on peut envisager que corps et (parties du) monde puissent compter
comme éléments de systèmes plus larges, comprenant corps, cerveaux, états
informationnels d’artefacts de divers types, etc. Les états de ces systèmes plus
larges détermineraient, ou contribueraient à déterminer, leurs propriétés et états
mentaux. Cette dernière position, défendue par Andy Clark lui-même
3
, est celle
du « fonctionnalisme étendu » et est en plein essor aujourd’hui. Il s'agit en
l'espèce d'un « externalisme actif », qui affirme le rôle causal de
l'environnement, et se présente comme une perspective plus radicale que
« l'externalisme standard » revendiqué dans les années soixante-dix par des
auteurs comme Hilary Putnam ou Tyler Burge
4
. Ce premier externalisme ne
serait qu'un « externalisme passif » dans la mesure où il ne ferait pas jouer un
rôle causal direct aux facteurs externes, à l'environnement extérieur immédiat.
L'externalisme actif en revanche pose l'existence d'un tel rôle causal
immédiat, avec la notion de « systèmes couplés » liant l'organisme humain et
l'environnement, naturel ou artificiel, comme les artefacts et les dispositifs
informationnels et technologiques: ces systèmes couplés recoupent les
« systèmes plus larges » précédemment évoqués, dont la définition même
récuse le partage classique de l'esprit et du monde extérieur. La théorie du
fonctionnalisme étendu, à l'œuvre dans cet externalisme actif, distribue ainsi la
cognition et l’esprit dans l’environnement et les objets qui servent de support et
de conditions aux pratiques. Cette perspective, celle de « l'esprit étendu »
(extended mind), remet en cause l’opposition trop souvent caricaturale entre les
tenants d’une autonome « sphère mentale » (prétendument) cartésienne et les
défenseurs d’une réduction des phénomènes intentionnels à des déterminations
physiologiques ou comportementales. L’enjeu plus décisif pour notre propos
ici est que le statut même du corps est profondément modifié par ce
fonctionnalisme étendu. Celui-ci entend identifier le corps avec tout ce qui joue
une série de rôles absolument cruciaux dans l’existence humaine intelligente
2
Clark A« Pressing the Flesh: A Tension in the Study of the Embodied, Embedded Mind ? »
Philosophy and Phenomenological Research, 56, 1, 2008, pp. 37-59.
3
Cf. en particulier le célèbre article de 1998, écrit conjointement par Andy Clark et David Chalmers,
intitulé « The Extended Mind », Analysis, 58, 1998, pp. 10-23.
4
Cf. Hilary Putnam, « The Meaning of 'Meaning' », in Mind, Language and Reality. Philosophical
Papers, vol II, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 215-271, Tyler Burge,
« Individualism and the Mental », Midwest Studies in Philosophy, 4, 1979, pp. 73-122.

Les lieux de l’esprit. Introduction au dossier
9
(c’est le lieu de l’action volontaire, l’instance de la confluence sensorimotrice,
le vecteur de l’interaction intelligente avec l’environnement, etc.). Clark
soutient ainsi que « rien ici ne requiert un corps unique persistant dans l’espace
tridimensionnel ordinaire. Au lieu de cela, il pourrait y avoir des formes
authentiques mais dispersées d’incorporation, incorporation dans des réalités
virtuelles ou mixtes, et de multiples incorporations pour une intelligence
unique »
5
.
Ainsi peut s'entendre plus précisément l'importance de l'usage du pluriel
dans l'intitulé même du numéro: les lieux de l'esprit. La perspective générale
est en effet celle d'une interrogation autour des multiples manifestations du
mental, considérées en relation avec la sphère publique du monde symbolique,
social, technologique, et non pas seulement en référence à une identité
psychophysique de type individuel. L'esprit par conséquent, ce qui pense,
perçoit, mais aussi agit, désire, ressent, n'occupe pas nécessairement, ou par
définition, un lieu privilégié, comme une sphère mentale individuelle, un
cerveau (ou une partie du cerveau), ou même un certain corps du monde, un
corps individuel.
Il ne s'agit donc pas de tenter d'assigner au mental une « demeure » ou un
« habitacle » particulier, pour reprendre la formule spinoziste
6
. Il s'agit bien
plutôt de comprendre l’inhérence constitutive de l’esprit au monde, c’est-à-dire
non seulement à l’univers physique, mais également à la sphère anthro-
pologique des pratiques sociales, symboliques, technologiques, économiques
ou politiques. S'impose alors une critique de la traditionnelle « philosophie
mentale », pour reprendre l'expression de Vincent Descombes, philosophie
mentale fondée sur le postulat de la séparation de l’esprit et du monde
7
. Ce
dernier postulat, massif et transversal, trouve peut-être son origine dans la thèse
d’une distinction conceptuelle et réelle du corps et de l’esprit corrélative de la
constitution de la nouvelle science de la nature à l’âge classique. Mais il ne
commande pas seulement ce que l’on pourrait qualifier, rapidement, de
conception mentaliste ou dualiste d’obédience – supposément – cartésienne. Ce
postulat demeure à l'œuvre, souvent subrepticement, dans nombre de théories
contemporaines du mental et de sa relation au corps. Celles-ci, alors même
qu’elles récusent le dualisme des substances, ou l’hypothèse d’une chose
immatérielle au principe des volitions et des représentations, dans une
perspective ouvertement réductionniste et physicaliste, n’en demeurent pas
moins marquées par la définition des états mentaux comme des états internes,
fussent-ils des états cérébraux. De telles théories se trouvent encore traversées
par la caractérisation de la vie psychique dans les termes de l’expérience
privée, comme le suggèrent notamment l’importance accordée au problème des
qualia, ou encore la notion persistante d’une essentielle énigme de la
conscience, à l'oeuvre dans la philosophie contemporaine de l'esprit.
5
art.cit., p. 59.
6
Spinoza, Éthique II, Scolie de la Proposition 35, traduction de Bernard Pautrat, Paris, Seuil,
1999,p. 159.
7
Cf. Vincent Descombes, La denrée mentale, en particulier ch. 1, Paris, Éditions de Minuit, 1995,
pp. 19-23.

Pascale GILLOT, Guillaume GARRETA
10
Quelles peuvent être cependant, précisément, les conditions théoriques de la
critique d’une telle philosophie mentale, si cette critique ne se satisfait pas de
l’exhortation abstraite au dépassement du dualisme et du mentalisme sous
toutes ses formes, classiques et contemporaines ? Autrement dit, si la
perspective adoptée est bien celle d’un externalisme, ce dernier se révèle
nécessairement paradoxal puisqu’il récuse le partage même, ou l’antithèse
traditionnelle, de l’intérieur et de l’extérieur, et ne vise pas une réduction
physicaliste des phénomènes mentaux.
Le premier axe du numéro appréhende la question de la relation esprit-
corps-monde, au lieu même de son institution, dans la philosophie du XVII
e
siècle. Le propos tend d’abord à une relecture de la conception de l'esprit et de
l’identité psychophysique telle qu'elle se trouve originellement promue dans la
philosophie de Descartes.
L'originalité d'une telle conception s'est trouvée très rapidement recouverte,
ou transformée, dans l'histoire de la philosophie moderne ; à tel point que le
modèle canonique du cogito, doit probablement autant à certaines
interprétations postérieures, qu'à Descartes lui-même, comme le montre
Étienne Balibar dans l'article intitulé « Kant critique du « paralogisme » de
Descartes. Le « je pense » (Ich denke) comme sujet et comme substance ».
Kant lit la conception cartésienne du “Je pense” comme marquée par un
paralogisme et une illusion substantialiste, consistant à attribuer au pur sujet de
la pensée des caractéristiques qui sont celles de la chose, ou de la substance
(res cogitans). Si Descartes est bien le fondateur de la philosophie moderne,
avec la place centrale accordée au cogito, il serait simultanément l'auteur d'une
méprise quant à la véritable nature de la subjectivité, faussement identifiée à la
possibilité d'une « connaissance de soi », dans le cadre d'une « psychologie
rationnelle ». Kant ouvre ainsi la voie à une longue série de lectures du cogito,
toutes articulées, jusqu'à la période contemporaine, à ce même postulat d'un
paralogisme à l'œuvre dans la conception cartésienne de l'esprit-sujet. Étienne
Balibar souligne cependant le caractère incertain d'une telle ligne inter-
prétative, s'agissant de la philosophie même de Descartes, et la nécessité de
distinguer celle-ci d'une autre tradition philosophique à propos de la
« conscience », ouverte notamment par Locke.
Ainsi, en marge des interprétations communément reçues, sans doute faut-il
réinterroger l’originalité et la complexité première de la philosophie
cartésienne. Cette originalité a souvent été méconnue dans l'histoire de la
philosophie, et dans la philosophie contemporaine de l'esprit elle-même, dont
l'anti-cartésianisme de principe recouvre un certain nombre de malentendus
théoriques. C'est ce que s'attachent à montrer plus particulièrement les articles
de Pascale Gillot et de Denis Kambouchner.
Pascale Gillot (« Y a-t-il un « mentalisme » cartésien ?») entend montrer
que la compréhension courante, en particulier dans la philosophy of mind, du
cartésianisme comme lieu d'invention du mentalisme et de l'internalisme est
fondée sur de fausses prémisses. Si la question de la représentation est
effectivement centrale dans la théorie cartésienne de l'esprit, elle engage
pourtant une disjonction des catégories de représentation et de ressemblance,
qui rend difficiles l'assimilation de cette théorie à une doctrine des sense data,

Les lieux de l’esprit. Introduction au dossier
11
ainsi que la définition des idées sur le modèle de petits duplicats intérieurs, ou
d'images mentales mimétiques des objets extérieurs. Le représentationalisme
cartésien, s'il existe, va de pair avec la notion originale d'une intériorité vide,
non psychologique, très différente de l'intériorité foisonnante du supposé
« théâtre mental » couramment identifié à l'esprit dans sa définition
cartésienne. Denis Kambouchner (« Descartes et l'indépendance de l'esprit »)
entend souligner quant à lui la spécificité de la thèse cartésienne de la
distinction corps-esprit. L'analyse vise à débouter les interprétations, encore
dominantes dans les sciences cognitives et la philosophie contemporaine de
l'esprit, qui réduisent le cartésianisme et la théorie cartésienne de la relation
corps-esprit à un « dualisme » métaphysique. Contre cette lecture tradition-
nelle, D. Kambouchner met au jour le rôle du corps dans l'accomplissement des
fonctions mentales selon Descartes. Ce rôle ne vaut pas seulement pour le
registre des sensations et des passions, il concerne également le domaine de la
connaissance scientifique-mathématique, et jusqu'au domaine de l'intellection
pure, la seule exception étant constituée par la pensée que l'âme a d'elle-même.
Ainsi se trouve reconsidérée entièrement la thèse cartésienne de la distinction
entre pensée et étendue, distinction qui ne peut avoir de sens que
« fonctionnel », et d'autre utilité qu'une utilité « intellectuelle et pratique ».
Il est dès lors possible de reconsidérer les lignes de partage qui, dès l’âge
classique, opposent les philosophes à propos de ce « problème de l’union », et
commandent par exemple la polémique engagée par Spinoza, dans l’Éthique,
contre la théorie cartésienne de l’union psychophysique. L'on peut proposer
une autre hypothèse, pour la compréhension de cette opposition Spinoza-
Descartes, que celle d’une simple lutte entre monisme et dualisme. Ne serait-ce
que dans la mesure où, chez Spinoza lui-même, le refus de la distinction réelle
ou substantielle du corps et de l’esprit est associé à l’axiome d’une distinction
conceptuelle (que l’on pourrait presque qualifier, si l’on ne craignait pas
l’anachronisme, de « grammaticale ») entre pensée et étendue, et fait aussi
appel à une théorie générale de l’individuation. Celle-ci permet de rendre
compte de l’identité de l’esprit et du corps humain, précisément parce que ce
corps est défini comme un corps complexe, simultanément affectant et affecté
par les corps dits extérieurs, et nécessairement inscrit, à ce titre, dans le monde
et plus particulièrement dans le champ des pratiques humaines. Par là se laisse
entrevoir, dès l’âge classique, la possibilité d’un déplacement de la question de
l’unité psychophysique, de la théorie de l’esprit vers une théorie des affects.
Cette théorie des affects apparaît indissociable de l’hypothèse d’une
appartenance constitutive du corps à la sphère sociale et anthropologique, en
tant que corps agissant, corps parlant, corps capable peut-être, pour reprendre
une expression de l’Éthique, d’être, en vertu de sa propre nature, cause « des
édifices, des peintures et des choses de ce genre, qui se font par le seul art des
hommes »
8
Pareil déplacement, il est vrai, a pour condition la critique d’un modèle
interactionniste affirmant la possibilité d’un commandement du corps par
l’esprit (mouvement volontaire) ou d’une action causale du corps sur l’esprit
(sentiments, passions, émotions). La question qui se pose, dès lors, et qui
8
Spinoza, Éthique III, Scolie de la Proposition 2, op. cit., pp. 207-213.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%