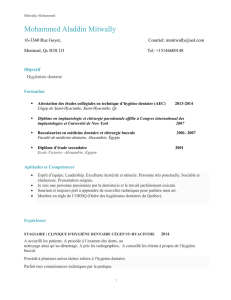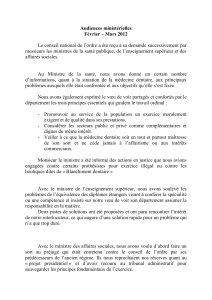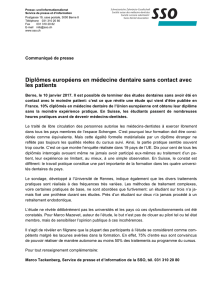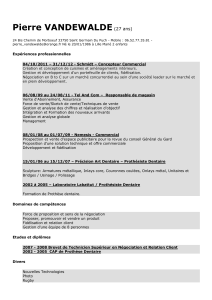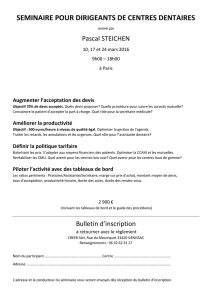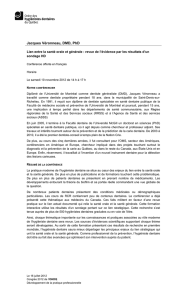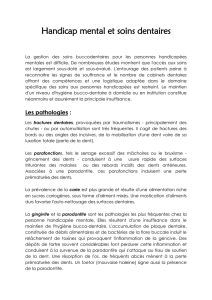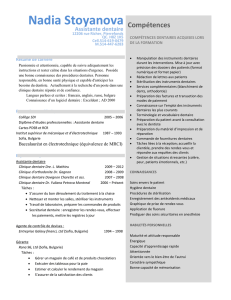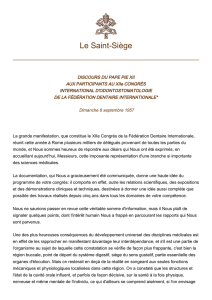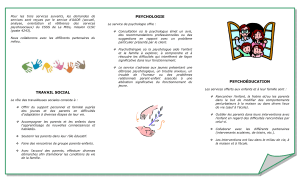Les précurseurs de la narcose à l`éther

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 965
L’actualité en médecine dentaire
Controverses médicales au cours du 19e siècle
Les précurseurs de la narcose à l’éther
Marcel Hänggi (traduction de Jean-Jacques Gindrat, source: NZZ)
On considère que le 16 octobre 1846 est le jour qui a vu la naissance de l’anesthésie (NZZ du
5 mai 2004). Ce jour-là, pour la première fois, un patient aurait été opéré à Boston sans douleur
grâce à une narcose à l’éther. L’auteur de l’article qui suit a consacré son mémoire de licence
aux débuts de l’anesthésie en Suisse. Il a été amené à une appréciation quelque peu différente
de ces événements.
«And there shall be no more pain», cette
dédicace émouvante peut être lue, à Bos-
ton, sur le socle du monument célébrant
l’éther. Il rappelle le souvenir du médecin-
dentiste Thomas Green Morton, à l’ini-
tiative duquel, le 16 octobre 1846, pour la
première fois, grâce à une anesthésie à
l’éther sulfurique, un patient fut opéré
sans douleur devant un public de spécia-
listes. Ce jour est considéré comme la date
de naissance de l’anesthésie. Certains
faits toutefois font entrevoir les choses
sous un angle un peu différent. Tout
d’abord, avant l’«Ether Day» déjà, on avait
procédé à plusieurs reprises à des opéra-
tions sans douleur. En avril 1846, l’ «Augs-
burger Allgemeine Zeitung» avait décrit
avec beaucoup de détails des opérations
sans douleur, couronnées de succès. L’his-
toire traditionnelle de la médecine rap-
porte de tels succès, elle les considère
cependant comme peu vraisemblables.
Deuxièmement, selon des récits de té-
moins oculaires, le patient, ce fameux
16 octobre, n’a pas crié comme à l’accou-
tumée, mais il a gémi et déclaré, au réveil
de l’état d’euphorie dû à l’éther, qu’il avait
eu mal. On prit bien soin d’ignorer cette
déclaration. Troisièmement enfi n, c’est en
1800 déjà, que dans un article fort remar-
qué, Humphrey Davy avait proposé
l’anesthésie par inhalation d’un gaz (il
suggérait l’utilisation de gaz hilarant).
Davy devint plus tard président de la
Royal Society – et c’est précisément cette
société qui, à réitérées reprises, refusa de
vérifi er des communications de ses mem-
bres dans lesquelles ceux-ci affi rmaient
avoir découvert une méthode leur per-
mettant d’opérer sans douleur. La société
sœur en France agissait de même.
Le mesmérisme controversé
En 1842 déjà, à Londres, là aussi en pré-
sence d’un public de spécialistes, William
Topham amputait la cuisse d’un patient qu’il
avait préalablement «mesmérisé», c’est-à-
dire mis en état de transe par l’intermédiaire
d’une technique ressemblant à l’hypnose. Si
l’on excepte un discret grognement, le pa-
tient ne fi t entendre aucun son. Cela n’em-
pêcha pas la majorité des spécialistes de
l’assistance de considérer l’intervention
comme un échec: on soupçonnait le patient
de s’être comporté de façon à faire croire
qu’il n’aurait pas eu mal!
Comment interpréter, dans un intervalle
d’à peine quatre ans, des réactions si fort
différentes aux deux opérations? Au cours
de la première moitié du 19e siècle, on
pouvait assister, dans le domaine de la
médecine, à des luttes acharnées pour la
défi nition de ce qu’il y avait lieu de consi-
dérer comme relevant de la science. A la
fi n du 18e siècle, Franz Anton Mesmer
avait suscité l’intérêt avec sa théorie du
«magnétisme animal». Selon celle-ci, de
même que les métaux magnétiques, les
organismes disposeraient d’un certain
«magnétisme». S’il est altéré, il peut être,
à en croire les mesméristes, rétabli par des
interventions manuelles. Les effets de tel-
les manipulations pouvaient être compa-
rés à ceux de l’hypnose, qui apparaîtra
ultérieurement. Après la mort de Mesmer,
la théorie a connu à Londres un grand
nombre d’adeptes. Au début de 1838, le
médecin londonien John Elliotson, entre-
prit un certain nombre de séances de
mesmérisation sur une patiente épilepti-
que. Le milieu spécialisé, et notamment la
revue médicale «The Lancet», qui était
son organe de communication le plus
puissant, se montrèrent fort impression-
nés. Mais, lentement, Elliotson perdit tout
contrôle de sa patiente, jusqu’au moment
où, en présence de spectateurs apparte-
nant à la noblesse, elle se mit, dans son
état d’euphorie, à les railler et à proférer
des paroles obscènes. Elliotson perdit la
faveur dont il jouissait auprès du public et,
en juillet, le «Lancet» se détourna de lui.
Dès lors, la revue adopta une furieuse
attitude antimesmériste.
Les «pneumaticiens», ceux qui dans les
années 1800 faisaient des expériences
avec les gaz – le jeune Davy était l’un
d’entre eux – jouissaient de la même ré-
putation de manque de sérieux. Les gaz
provoquaient un état d’ivresse semblable
à la transe mesmérienne. Cet effet s’op-
posait diamétralement à la tendance des
médecins qui visaient un contrôle tou-
jours plus grand du corps du patient.
Le rôle de la revue «The Lancet»
On peut voir une preuve de l’association
des essais d’opérer sans douleur à la char-
latanerie dans l’exclamation de John C.
Warren, le 16 octobre 1946:
«Messieurs, ceci n’est pas un canular!». La
NZZ du 20 janvier 1847 réagissait de ma-
nière identique lorsqu’elle écrivait: «Il ne
s’agit en aucun cas d’une narcose par
magnétisation». Si la percée s’est produite
aux Etats-Unis, ce n’est certainement pas
dû au hasard. La professionnalisation de
la médecine y avait moins progressé qu’en
Angleterre, en France ou en Allemagne,
pays dans lesquels un universitaire aurait
compromis sa réputation en pratiquant
une telle opération.
L’establishment médical s’était opposé
aux publications de Davy de 1800, qui
préconisaient l’utilisation de l’anesthésie
– maintenant, elle les célébrait comme
une victoire. Il était temps, les annonces
selon lesquelles les mesmériens étaient en
mesure d’opérer avec succès sans douleur
allaient en s’accumulant. Le mesmérisme
gagnait de nouveau du terrain. Certains
historiens de la médecine attirent toute-
fois l’attention sur le fait que le mesmé-
risme était une technique manquant de
fi abilité. Joseph Liston, qui utilisa l’anes-
thésie par inhalation pour la première fois
en décembre 1846, fêta cette dernière
comme une victoire sur le mesmérisme:
«Cette idée géniale des Yankees (…)
dépasse sans conteste le mesmérisme.
Quelle chance!».

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004
966
L’actualité en médecine dentaire
La rapide dissémination de l’idée nouvelle
n’aurait pas été possible sans l’aide du
«Lancet». La revue spécialisée consacra
112 articles à ce sujet au cours du premier
semestre de 1847. Les médecins, qui quel-
ques mois auparavant repoussaient toute
idée d’anesthésie, se trouvaient dès main-
tenant prêts à accepter des échecs et
même à considérer des décès comme
quelque chose d’accessoire. Les journaux,
eux aussi, rapportaient en long et en large.
Le médecin glaronnais Johann Jakob Jenni
publiait des articles enthousiastes dans la
NZZ. Les patients se mirent bientôt à
réclamer des narcoses – alors que les chi-
rurgien, plus prudents, préféraient encore
opérer selon les méthodes traditionnelles
– c’est-à-dire des patients parfaitement
conscients. Q
senter son invention au Professeur Urs
Brägger, à l’époque directeur administratif.
Grâce à la composition spéciale des diffé-
rents éléments constitutifs et au procédé
de fabrication (le matériau est d’abord
trempé, puis recuit), Hugo Spicher a été en
mesure de développer des fraises qui fa-
çonnent le matériel synthétique de façon
aussi effi cace que les fraises en métal dur
habituelles, sans toutefois laisser les habi-
tuelles traces au niveau fi l/métal. Urs Bräg-
ger entra en contact avec Unitectra, l’unité
des universités de Berne et de Zurich char-
gée du transfert des connaissances et de la
technologie. Unitectra, par ses prestations,
fournit une aide aux chercheurs dans tous
les domaines du transfert des connaissan-
ces et de la technologie, en les mettant par
exemple en contact avec des partenaires
industriels, en les aidant dans le domaine
des brevets ou lors de la négociation de
contrats, etc.
Par la suite, des contacts ont été pris avec
l’offi ce européen des brevets, la descrip-
tion du brevet a été rédigée et adressée à
l’offi ce le 19 juin 2003. Le brevet a été
accordé le 29 septembre 2003.
Des essais durent encore avoir lieu avec
différentes maisons de fabrication, avant
que les fraises dont on dispose actuelle-
ment ne puissent être défi nitivement
montées.
Le processus, dans son ensemble, a duré
quelque deux ans. A ce sujet, l’inventeur
s’exprime ainsi: «Les dépôts de brevet sont
une chose très coûteuse, puisqu’il faut tout
d’abord démontrer qu’aucun produit iden-
tique n’existe dans le monde.» Selon Uni-
tectra, une invention ne peut bénéfi cier
d’un brevet que lorsqu’elle est nouvelle,
qu’elle constitue un développement signi-
fi catif, réalisé de façon autonome et qu’elle
est techniquement applicable.
C’est précisément ce dernier point, la pos-
sibilité technique de l’application, qui a
menacé le projet pendant un certain
temps. Après les premiers essais couron-
nés de succès des premières fraises pro-
duites en série, des problèmes sont appa-
rus de façon inattendue. La deuxième
série de fraises était trop dure, de telle
sorte qu’apparaissaient de nouveau des
traces de détérioration. Après qu’il fut
Hugo Spicher pose des jalons: «Dentalakzente»
Anna-Christina Zysset (traduction Jean-Jacques Gindrat)
Le technicien dentiste Hugo Spicher, par le développement de sa fraise en matériel synthétique,
a posé des jalons importants dans les domaines de l’adaptation et du façonnage des appareils
d’orthodontie. Pour lancer sur les marchés européens la distribution de la fraise Spicher,
récemment brevetée, une nouvelle fi rme a été créée. Cette fi rme, dont le siège se trouve à
St. Antoni, porte le nom de «Dentalakzente».
«Dentalakzente» a été créée spécialement
en 2004 pour assurer la distribution de la
fraise Spicher, en Suisse et sur les marchés
européens. Les fraises Spicher sont de
nouvelles fraises en matériel synthétique,
brevetées universellement, qui facilitent
signifi cativement le façonnage des appa-
reils d’orthodontie. A l’heure actuelle,
«Dentalakzente» étend son réseau de dis-
tribution à la Suisse romande, ainsi qu’à
la France et à l’Italie.
Le directeur de «Dentalakzente» s’appelle
Jens Moecke. C’est un directeur de vente
diplômé, né en 1962, de nationalité alle-
mande, il habite la Suisse depuis 1996.
Avant de choisir une activité indépen-
dante, il était directeur des ventes, au ni-
veau mondial, dans une importante mai-
son de commerce de biens d’investisse-
ment de haute valeur. «La famille Moecke
a une lourde hérédité dentaire», c’est ce
que nous déclare l’entrepreneur. «Mon
beau-frère est médecin-dentiste, mes
deux frères et ma mère sont techniciens
dentistes et ma sœur assistante dentaire».
Jens Moecke est convaincu d’être en me-
sure, grâce à la fraise en matériel synthé-
tique – swiss made – de conception nou-
velle et brevetée universellement, de dé-
velopper une entreprise aux reins solides.
Un produit de qualité et un marketing
intelligent devraient garantir le succès.
Moecke nous informe que la mise sur le
marché des fraises Spicher, dans les diffé-
rents marchés, est toujours planifiée de
telle sorte qu’elle coïncide avec une pré-
sentation en collaboration avec des clini-
ques universitaires. Le lancement aura
effectivement lieu dans le cadre des clini-
ques de médecine dentaire de l’Université
de Berne, là où l’inventeur, le technicien
dentiste Hugo Spicher, exerce son activité
depuis 1991, dans le cadre de la division
d’orthopédie maxillo-faciale. Ce qui a
mené Moecke à changer de domaine
d’activité et ce qui a déterminé l’Univer-
sité de Berne à déposer un brevet, vous
sont racontés dans ce qui suit.
Les cliniques de médecine dentaire
déposent un brevet
Fribourgeois de langue allemande Hugo
Spicher a consacré d’innombrables heures
de travail au perfectionnement des fraises
en matériel synthétique destinées à la fa-
brication d’appareils d’orthodontie. En
2003, il a atteint son objectif et a pu pré-
Hugo Spicher
Les fraises Spicher

L’actualité en médecine dentaire
Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 967
possible de démontrer que les fraises ne
satisfaisaient pas à la «recette» prescrite,
Hugo Spicher prit un nouveau départ avec
un autre partenaire pour la production.
Sans l’aide de sa famille cette invention
n’aurait jamais abouti. Un des frères
d’Hugo Spicher, qui a des connaissances
techniques dans le domaine de la métal-
lurgie, sa femme, qui s’est consacrée aux
innombrables travaux administratifs, n’ont
pas cessé de le soutenir. Il faut maintenant
souhaiter que cette invention, qui sera
peut-être suivie d’autres encore, va rap-
porter quelque chose à son inventeur et à
sa famille. Ce dernier, technicien inventif,
qui a perdu tôt ses parents et a eu ainsi un
début de vie professionnelle diffi cile, mé-
riterait de profi ter de son invention au
plan matériel également. S’il devait
aujourd’hui faire le choix d’une profes-
sion, il ne choisirait plus celle de techni-
cien dentiste. L’absence de possibilités de
promotion, à moins de se décider pour la
maîtrise fédérale de technicien dentiste, a
déjà souvent préoccupé Hugo Spicher.
Cela ne l’empêche pas d’aimer son métier.
C’est le sentiment d’être en mesure
d’améliorer quelque chose qui le motive.
La palette des différentes fraises en ma-
tière synthétique va considérablement
faciliter le travail des futures générations
de techniciens dentistes et de médecins-
dentistes. Lorsqu’on lui demande si lui,
l’inventeur, est déjà sur le chemin d’un
nouveau projet, Hugo Spicher répond:
«Oui, il y en a un, en théorie il y a déjà des
idées, mais pas encore au niveau pratique
(le matériel de départ n’est pas satisfai-
sant). J’ai déjà pris des notes sur d’éven-
tuels autres projets, mais rien n’est encore
défi nitif.»
A la fi n du mois de septembre ou au début
du mois d’octobre, après le coup de départ
à l’Université de Berne, Moecke va person-
nellement se rendre chez les médecins-
dentistes et leur présenter les avantages des
fraises en matière synthétique. Pour l’ins-
tant, la palette des produits de «Dentalak-
zente» se limite aux fraises Spicher, puis-
qu’il s’agit de lancer ces fraises avec com-
pétence et professionnalisme sur les diffé-
rents marchés. Peut-être que, entre-temps,
Hugo Spicher aura eu la possibilité de dé-
velopper avec succès un nouveau produit.
«Dentalakzente» envisage de mettre à son
catalogue d’autres produits innovants, de
même que du matériel standard.
Pour celui qui s’intéresse aux fraises en
matériel synthétique:
«Dentalakzente» Jens Moecke
Niedermonten
CH-1713 St. Antoni/Switzerland
Tél. +41 (0)26 495 04 45
Fax +41 (0)26 495 04 26
www.dentalakzente.ch Q
Ancien fil
Nouveau fil
Taxe anticipée de recyclage (TAR)
Dr U. Wanner
La législation suisse au sujet de la protection de l’environnement est sans conteste très avancée
en comparaison de celle des pays qui nous entourent.
testation confi rmant que l’élimination de
ses appareils, y compris leur transport, ont
eu lieu conformément aux règles, ceci pour
éviter tout problème en cas de contrôle de
la part des autorités chargées de la protec-
tion de l’environnement.
La taxe anticipée de recyclage, sous la
forme d’un «système de répartition», va
permettre, à partir du 1er octobre, le fi -
nancement de l’élimination des anciens
appareils pour lesquels aucune taxe de
recyclage n’avait été prélevée à ce jour.
L’Association suisse du commerce den-
taire déclare formellement qu’elle ne réa-
lisera aucun profi t par l’intermédiaire de
la TAR. La SSO aura par conséquent la
possibilité de consulter les comptes an-
nuels de la TAR.
L’élimination proprement dite des ancien-
nes installations sera confiée à des entre-
prises de réutilisation et de recyclage cer-
tifiées par l’EMPA. L’élimination se fera
ainsi «lege artis».
L’Association suisse du commerce den-
taire, ainsi que les dépôts dentaires qui lui
sont associés, espèrent que les médecins-
dentistes feront preuve de responsabilité
pour la cause de l’environnement et le
manifesteront en acceptant de payer la
TAR. Un certifi cat sera remis aux méde-
cins-dentistes qui doivent payer pour la
première fois pour des installations; il at-
teste, de la part de l’ASICD et de la SSO,
que le cabinet dentaire participe aux efforts
en vue d’une élimination respectueuse de
l’environnement des installations électri-
ques et électroniques dentaires.
Pour d’éventuelles questions en relation
avec la TAR, le secrétariat de l’Association
suisse du commerce dentaire se tient volon-
tiers à disposition (tél. 031/952 76 75). Q
En ce qui concerne le recyclage respectant
l’environnement, le législateur a fort heu-
reusement laissé l’initiative aux associa-
tions professionnelles et, s’en tenant une
fois pour toutes au principe bien établi de
subsidiarité, n’intervient au moyen de
normes que lorsque l’industrie privée ne
prend aucune mesure ou des mesures
insuffi santes.
Tenant compte de ces éléments, l’Associa-
tion suisse de l’industrie et du commerce
dentaire (ASICD) a pris la décision d’éta-
blir un concept d’élimination du matériel
électrique et électronique dentaire et de
laboratoire, qui assure une réutilisation
aussi grande que possible du matériel et
des constituants, ainsi qu’une élimination
professionnelle des parties non réutilisa-
bles de telles installations de médecine
dentaire. En décidant de collaborer avec
SWICO, l’Association économique suisse
de bureautique, qui a déjà une très grande
expérience dans le domaine de l’élimina-
tion des ordinateurs, des écrans, des ap-
pareils téléphoniques et de photocopie,
etc., il a été possible de trouver un parte-
naire en mesure de réaliser les objectifs du
commerce dentaire.
A dater du 1er octobre 2004, les dépôts
dentaires de l’ASICD vont prélever une
taxe anticipée de recyclage sur les appareils
électriques et électroniques. Elle permettra
de couvrir les frais d’élimination, ou de
réutilisation. Les coûts de démontage,
ainsi que le transport du cabinet vers le lieu
de collecte pour élimination, ne sont tou-
tefois pas inclus. Pour ces derniers, le dépôt
dentaire établira au médecin-dentiste une
facture en fonction des frais réels. Il est
vivement conseillé au médecin-dentiste de
faire établir par le dépôt dentaire une at-

L’actualité en médecine dentaire
Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004 971
Je suis bien certain que la plus grande
partie des éléments qui font notre répu-
tation sont erronés, mais ils n’en existent
pas moins pour autant et c’est à nous qu’il
appartient de tout faire pour éliminer ces
éléments. Nous en avons les moyens. Il ne
nous reste qu’à les utiliser judicieusement;
il convient tout d’abord d’examiner cal-
mement la réalité telle qu’elle se présente
à nous tous les jours.
Entreprendre le traitement
en psychologue
Le traitement que vous devez effectuer ne
peut pas laisser indifférent le patient et vous
devez agir avec délicatesse et prudence.
Nous ne pouvons pas oublier que notre
intervention s’effectue dans une matière
particulièrement sensible et que nos pa-
tients non plus ne peuvent l’oublier. Les
sentiments qui les animent face à leur
dentiste peuvent être très pénibles même
s’ils sont soigneusement cachés. Et un
sentiment, quel qu’il soit, ne peut rester
intérieur que pour autant qu’une force
plus grande en empêche l’extériorisation.
Cette force inhibitrice peut être aussi bien
la peur que le courage, la sociabilité, la
courtoisie, la vanité, ou encore un facteur
pathologique, somatique ou psychique.
Il est bien évident que le monde sensible
ne peut être séparé arbitrairement du
monde psychique, et il est impossible
d’agir sur l’un des deux sans provoquer
une réaction de l’autre. Mais cette réaction
peut aussi bien être une réaction de sym-
pathie qu’une réaction de défense. Il faut
savoir qu’on ne peut pas soigner un corps
et oublier que le corps est animé par une
âme. On ne peut pas être neutre avec son
patient; il a besoin de nous, par consé-
quent, on doit lui apporter plus qu’une
thérapeutique somatique, mais encore, et
c’est aussi important, une thérapeutique
psychologique, ou, plus exactement, en-
treprendre le traitement en psychologue.
Conseils pratiques
Quelques conseils pratiques vous aide-
ront, je l’espère. Ils entrent, à mon avis,
dans ce que j’appelle la psychologie den-
taire.
Ainsi, je pense que le praticien doit abso-
lument voir son patient avant que ce der-
nier ne soit assis dans le fauteuil. Il faut
donc que le dentiste aille lui-même cher-
cher le patient à la salle d’attente, ou, à
tout le moins de le recevoir dans son ca-
binet de consultation. Il pourra, de cette
façon, juger aisément de la taille de son
patient, de sa morphologie, de son com-
portement; il pourra lui parler.
Car si votre patient (nouveau) est installé
par la demoiselle de réception avant l’ar-
rivée du dentiste, il se trouve en état
d’infériorité et d’inconfort, si j’ose dire,
vis-à-vis de vous. En effet, se trouver en-
foncé ou couché dans un fauteuil avec une
serviette autour du cou, un linge sur les
genoux, peut être extrêmement désagréa-
ble. Et cela ne crée pas un climat de con-
fi ance et de détente, ni de relâchement
musculaire ou nerveux.
S’il ne s’agit pas d’un nouveau patient, le
problème est différent, bien entendu, car
il ne s’agit alors plus de faire connais-
sance.
Maintenant je vais vous dire ce que je
pense d’un cabinet dentaire, c’est-à-dire,
de l’endroit où nous passons la moitié de
notre vie. Il vaut tout de même la peine de
s’en occuper, pour nous et pour nos pa-
tients.
Psychologie dentaire
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier
Le dentiste, dans l’exercice de son art, «bénéfi cie», si l’on ose dire, d’une réputation plutôt dé-
favorable. Il ne peut pas ignorer cette situation sans prendre le risque de commettre des impairs
qui ne manqueront pas de compliquer sa tâche. Il ne faut pas oublier qu’il y a peut-être
150 ans, le dentiste était encore un arracheur de dents – et très souvent aussi un charlatan. Et
le proverbe «menteur [ou mentir] comme un arracheur de dents» nous collera sans doute à la
peau pendant longtemps encore.
Le cabinet de consultation
Le cabinet de consultation doit être clair
et spacieux. Par clair, je ne veux pas dire
blanc, car c’est trop brillant et fatigant
pour les yeux. Et je vous recommande de
ne laisser aucun instrument rébarbatif
trop en vue, ni d’instruments tranchants
ou piquants sous les yeux du patient qui
n’en demande pas tant. Il sait bien, ce
patient, que vous avez toute l’instrumen-
tation nécessaire et même plus; cela ne
présente pour lui qu’un intérêt fort limité.
S’il est venu chez vous, c’est qu’il vous fait
confi ance, ce n’est pas pour vérifi er la
beauté de votre panoplie instrumentale.
Sachez bien, de plus, que vous n’augmen-
terez pas votre autorité ni votre impor-
tance auprès de vos patients en ayant
posé ostensiblement un crâne humain sur
Pour tous ceux qui se seraient quelque
peu lassés des «barbus» qui ont mar-
qué l’histoire de notre profession, votre
fi dèle chroniqueur a décidé d’interca-
ler dans cette rubrique une mini-série
de quelques observations plus person-
nelles de notre confrère Roger Joris,
ancien président de la Société suisse
de l’histoire de la médecine et de la
Société européenne de l’histoire de la
médecine. En effet, plusieurs textes
provenant de ses archives, et gracieu-
sement mis à disposition de nos lec-
teurs, concernent les aspects psycho-
logiques des relations entre le praticien
et ses patients. Si ces réfl exions ne
nous emportent pas en arrière de plu-
sieurs siècles, elles ne sont pourtant
nullement désuètes ou poussiéreuses,
comme vous allez voir. Il est rafraîchis-
sant de constater que certaines idées
formulées par un praticien ayant exercé
il n’y a que quelques décennies sont
toujours d’actualité.
Thomas Vauthier
CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 114: 9/2004
972
L’actualité en médecine dentaire
votre bureau, même si vous l’utilisez avec
désinvolture comme cendrier … Il est bien
préférable d’y avoir un bouquet de fl eurs
ou même une fl eur seule.
Les planches anatomiques accrochées aux
murs sont absolument à proscrire. Elles
n’apportent rien à vos patients et si elles
vous sont utiles, vous pouvez alors les
fi xer contre le panneau intérieur de la
porte d’un buffet ou d’une armoire. Il y a
mieux à mettre contre un mur.
Mettez-y des tableaux ou des gravures de
qualité et de bon goût; vous pouvez éga-
lement y mettre des photos; mais abste-
nez-vous d’y mettre votre photo avec un
fusil, les pieds sur la tête d’un lion ou d’un
éléphant. Les photos de votre famille
n’intéressent personne non plus.
D’autre part, je ne saurais assez vous
mettre en garde contre l’aimable et hu-
moristique habitude, qui me semble
d’ailleurs, fort heureusement en perte de
vitesse actuellement, d’épingler au mur
des caricatures représentant des dentistes;
elles ne peuvent pas égayer un patient qui
souffre, ou simplement un patient peu-
reux. De plus, il faut reconnaître que c’est
d’assez mauvais goût. Ces caricatures
peuvent très bien orner les murs du labo-
ratoire, où le technicien n’en sera pas le
moins du monde incommodé, et vous
pourrez en jouir vous-même chaque fois
que la nécessité d’une sédation de vos
nerfs se fera sentir …
La salle d’attente
La salle d’attente doit être avenante et ne
pas être encombrée de meubles trop dis-
parates. Ce n’est en tout cas pas l’endroit
pour achever la vie d’un vieux salon dé-
foncé qui ne trouve plus de place ailleurs.
Et il n’est pas recommandable de faire
voisiner pour la fi n de leur carrière de faux
sièges Louis XV avec de vrais tabourets,
même recouverts de velours délavés et
sans couleur.
la table, elle est à proscrire. Et toute publica-
tion à laquelle il manque des pages doit être
éliminée pour éviter que votre salle d’at-
tente ne devienne un marché aux puces. Il
y a assez de revues très intéressantes qui
peuvent y prendre place et résister aux
nombreuses sollicitations des lecteurs.
D’après les expériences que j’ai faites, je
puis vous dire que les revues historiques
ou géographiques, ou encore certaines
revues de voyage ont la faveur des pa-
tients. Au mur aussi, il ne doit y avoir que
des choses plaisantes; tout doit aider au
confort et à la sédation.
Psychologie et plan de traitement
Il est une question que je ne puis qu’ef-
fl eurer au passage, mais qui a son impor-
tance; c’est celle du traitement à entre-
prendre en tenant compte d’un certain
nombre de facteurs parmi lesquels il faut
noter:
– le facteur esthétique,
– le facteur fonctionnel,
– le facteur fi nancier.
Je sais qu’il est extrêmement satisfaisant
au point de vue professionnel de réussir
un travail exceptionnel par sa beauté et sa
qualité; mais cela peut être une grave er-
reur psychologique de l’entreprendre sur
un patient dont les moyens fi nanciers
sont limités. Car on s’expose alors à de
longues discussions, à des complications
de tous ordres qui ne peuvent que vous
fatiguer bien inutilement.
On me rétorquera qu’il ne devrait pas y
avoir une thérapeutique pour riches et
une thérapeutique pour pauvres. J’admets
bien volontiers l’objection, mais il n’en
reste pas moins que c’est une réalité et
qu’il faut tout de même s’en accommoder,
même si elle n’est pas très satisfaisante,
pour éviter des mécomptes et des déboi-
res. D’ailleurs, le phénomène n’est pas
nouveau; en effet, un illustre médecin de
l’Ecole de Salerne, Cophon, enseigne déjà
à son époque la thérapeutique pour pau-
vres et pour riches. Il est inutile de faire du
romantisme dépassé, il faut être réaliste et
surtout psychologue. Q
Il y faut de bons sièges confortables; une
table ou deux et, si la place ne manque
pas, une bibliothèque ou une armoire.
Quant à la désastreuse habitude d’empiler
n’importe quelle revue à moitié déchirée sur
CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES
«Médecine dentaire sociale: économique et ciblée» – Rétrospective du Congrès SSO du 10 au
12 juin 2004 à Interlaken
Tout ce qui serait subjectivement souhaitable
n’est pas toujours objectivement nécessaire
Thomas Vauthier, Rheinfelden
«Une médecine dentaire sociale, raisonnable et ciblée». Voilà un sujet qui ne peut que convain-
cre même les plus réfractaires. En effet, qui n’est pas confronté quotidiennement à cette méde-
cine dentaire qui est peut-être la plus diffi cile à mettre en valeur ou à pratiquer? S’adapter à
la situation sociale et fi nancière du patient, ainsi qu’à ses désirs, tout en pratiquant une mé-
decine dentaire de qualité est souvent une véritable gageure. Le thème principal du Congrès
SSO 2004 à Interlaken, dont les multiples facettes ont été traitées avec panache par des spé-
cialistes de renom, aura sans doute permis aux quelque 1300 congressistes d’aiguiser leur sens
pour les aspects essentiels et les responsabilités sociales de notre profession. A noter, en passant,
que ce fut la 20e fois que le Congrès de la SSO a eu le plaisir de se dérouler à Interlaken.
La responsabilité que notre profession
doit assumer pour garantir à l’ensemble
de la population un accès complet aux
soins dentaires gagne en importance, non
seulement du point de vue médical, mais
aussi politiquement parlant. Aujourd’hui,
le médecin-dentiste ne peut plus se con-
centrer sur le seul aspect médico-dentaire
des soins qu’il prodigue a ses patients.
Lorsqu’il recherche la solution optimale
pour chacun d’entre eux, il doit également
tenir compte de l’environnement social et
économique dans lequel nous vivons. A
cet égard, le véritable défi ne réside pas
avant tout dans la réalisation à tout prix
du nec plus ultra. Au contraire, le médecin-
dentiste doit au contraire le plus souvent
se limiter au nécessaire, tout en garantis-
sant une exécution irréprochable. Ce pro-
blème est souvent bien diffi cile à résoudre.
Le congrès SSO de cette année a été con-
sacré précisément à ces aspects de notre
profession. Le fi l rouge des présentations
peut être résumé sous le constat: l’objectif
premier de la médecine dentaire sociale
est de garantir à chaque patient, quel que
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%