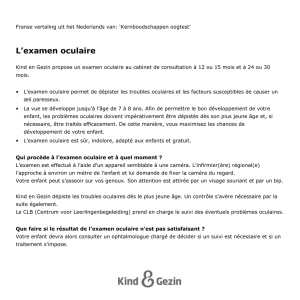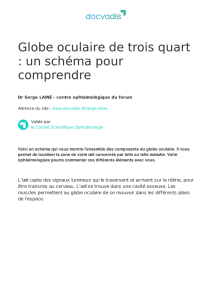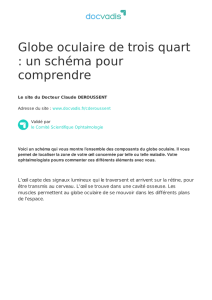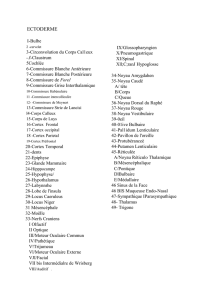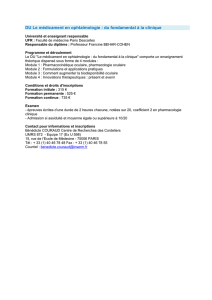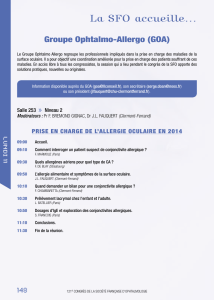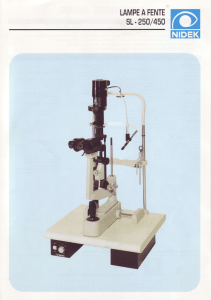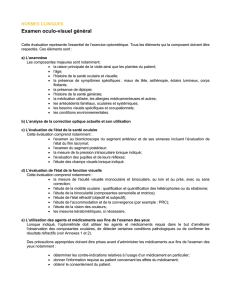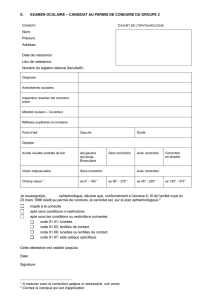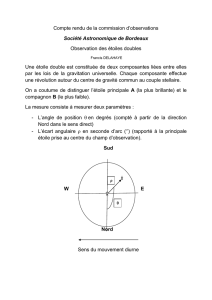Blépharites et pathologies cutanées

réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie # 256_Novembre 2016_Cahier 1
Mise au point interactive
9
Blépharites et pathologies cutanées
rosacée, l’atteinte oculaire peut être iso-
lée ou précéder l’atteinte cutanée dans
20 % des cas, ce qui rend plus difficile
le diagnostic.
1. Mécanismes
Il existe constamment une atteinte des
glandes de Meibomius palpébrales dont
le produit de sécrétion a pour rôle de
limiter l’évaporation des larmes. Le mei-
bum est trop visqueux et stagne dans les
glandes, ce qui a plusieurs conséquences :
– une sécheresse oculaire qualitative par
hyperévaporation ;
– un enkystement des glandes de
Meibomius, avec parfois inflammation
aiguë sous forme de chalazion ;
– une dénaturation physico-chimique du
meibum par prolifération bactérienne,
source d’inflammation du bord libre ;
– une prolifération bactérienne aboutissant
elle-même à des réactions infectieuses (orge-
let), toxiniques (hyperhémie) ou immuno-
logiques (conjonctivite phlycténulaire,
kératite catarrhale, sclérite) au niveau de la
conjonctive et de la cornée ;
– la prolifération de Demodex folliculu-
rum et/ou brevis dont la pathogénicité
oculaire est controversée
2. Signes fonctionnels
Ce sont avant tout ceux de la sécheresse
oculaire : sensations oculaires de corps
étranger, de brûlure, de picotements et
parfois larmoiement paradoxal. Un pru-
rit ou des sensations de brûlure du bord
libre palpébral sont fréquents. Une rou-
geur oculaire (fig. 1) ou palpébrale est
souvent rapportée par les patients.
3. Signes cliniques
Le bord libre palpébral est souvent
inflammatoire, hyperhémique, siège de
➞ S. DOAN
Ophtalmologiste, Hôpital Bichat et
Fondation A. de Rothschild, PARIS.
L’origine embryologique com-
mune entre la peau et la sur-
face oculaire (conjonctive,
cornée, paupières) explique que de nom-
breuses pathologies cutanées ont aussi
une expression oculaire, en particulier
conjonctivale. Nous détaillerons avant
tout les atteintes de la rosacée et de la
dermite séborrhéique, puis de la derma-
tite atopique.
[
Rosacée, dermite
séborrhéique et œil
La rosacée cutanée et la dermite sébor-
rhéique s’accompagnent très souvent
d’une atteinte oculaire. Ces deux maladies
sont très fréquentes et représentent, sur le
plan ophtalmologique, une grande partie
des irritations oculaires chroniques.
Si les tableaux cutanés sont différents,
l’atteinte oculaire est très similaire, se
résumant le plus souvent à une blépha-
rite et à un inconfort oculaire. En cas de
télangiectasies et de bouchons obstruant
les méats des glandes de Meibomius, et
de croûtes à la base des cils (fig. 1). Les
conjonctives bulbaire (blanc de l’œil) et
palpébrale sont hyperhémiques.
4. Complications
Elles sont nombreuses :
– au niveau de la paupière : chalazions,
orgelets ;
– au niveau de la conjonctive : conjoncti-
vite immunologique dite phlycténulaire,
conjonctivite fibrosante (diagnostic
différentiel d’une pemphigoïde des
muqueuses), sclérite ;
– au niveau cornéen : kératites inflam-
matoires (fig. 2) pouvant entraîner une
Fig. 1 : Blépharite dans une rosacée.
Fig. 2 : Rosacée oculaire. Conjonctivite et kératite
immunologiques.

réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie # 256_Novembre 2016_Cahier 1
Mise au point interactive
10
(fig. 3). L’examen de la cornée montre
souvent une kératite ponctuée ainsi
qu’une néovascularisation.
3. Complications
Des ulcères cornéens peuvent survenir,
se compliquant de surinfection, cicatrice
opaque et baisse de vision. Les surinfec-
tions staphylococciques, herpétiques ou
fungiques sont fréquentes. Une déforma-
tion cornéenne peut survenir progressi-
vement (kératocône).
Une fibrose conjonctivale avec brides
palpébro-oculaires peut être pré-
sente et évoquer une pemphigoïde des
muqueuses.
La maladie nécessitant souvent une cor-
ticothérapie locale au long cours, des
complications iatrogènes, telles que la
cataracte ou le glaucome cortisonique,
sont fréquentes et représentent des
causes majeures de baisse de vision.
L’atopie s’associe par ailleurs classique-
ment à une cataracte et au décollement
de la rétine.
4. Traitements
>>> Traitements topiques oculaires
Le traitement de base fait appel aux col-
lyres antiallergiques (antidégranulants
mastocytaires, antihistaminiques), aux
antihistaminiques oraux et aux rinçages
oculaires avec du sérum physiologique
non conservé.
(1 goutte matin et soir) répété 1 à 3 fois
par mois est également efficace, mais pas
toujours bien toléré.
Seules les formes avec inflammation cor-
néenne sévère nécessiteront l’usage des
corticoïdes en collyre oculaire, voire de
la ciclosporine en collyre en cas de cor-
ticodépendance.
[ Dermatite atopique et œil
Dans 25 à 40 % des cas de dermatite ato-
pique, une atteinte oculaire ou périocu-
laire peut survenir. Elle se limite le plus
souvent à un eczéma des paupières et à
une conjonctivite peu sévère, mais peut
parfois être beaucoup plus sévère, avec
atteinte cornéenne et menace visuelle,
dans le cadre d’une kératoconjonctivite
atopique.
Contrairement à l’atteinte cutanée, la
maladie oculaire ne survient en géné-
ral que chez l’adulte à partir de 30 ans.
L’évolution se fait par poussées sur un
fond chronique d’intensité variable. Les
mécanismes expliquant la maladie sont un
mélange d’hypersensibilité immédiate et
d’hypersensibilité à médiation cellulaire.
1. Signes fonctionnels
Les signes fonctionnels au cours des crises
sont souvent très invalidants : prurit très
important, sensation de corps étranger,
de brûlure oculaire, larmoiement et sécré-
tions. La photophobie doit faire redouter
la présence d’une kératite.
2. Signes cliniques
Les signes cliniques sont ceux d’une
conjonctivite chronique importante :
hyperhémie conjonctivale, œdème
conjonctival, larmoiement, sécrétions.
Il existe presque toujours un eczéma chro-
nique des paupières avec des squames
géantes, une peau cartonnée et une perte
des cils caractéristiques de la maladie
perforation cornéenne ou aboutir à
des cicatrices opaques néovasculaires
sources d'une baisse de vision.
La rosacée oculaire de l’enfant ou de
l’adulte jeune, appelée également
kérato conjonctivite phlycténulaire, est
particulière en raison de son évolution
et de sa gravité potentielle. Elle débute
par des chalazions récurrents, puis des
épisodes d’yeux rouges avec photo-
phobie qui traduisent la présence d’une
kératoconjonctivite chronique. Une
atteinte cutanée est souvent présente
mais discrète, à type d’érythrocoupe-
rose ou d’éruption papuleuse fugace.
Un avis ophtalmologique est essentiel
pour mettre en route le traitement adapté
qui évitera la survenue de complications
potentiellement cécitantes.
5. Traitements
Le traitement de base vise à réguler la
sécrétion meibomienne et à pallier la
sécheresse oculaire. Il est basé sur les
soins des paupières et les larmes artifi-
cielles.
Les soins des paupières doivent être
quotidiens et consistent en un réchauffe-
ment palpébral doux pendant 5 minutes,
suivi d’un massage appuyé des pau-
pières pour exprimer les sécrétions mei-
bomiennes. Une toilette du bord libre
avec des lingettes ou des produits émol-
lients peut compléter le traitement en
cas de croûtes importantes. Les larmes
artificielles sans conservateur seront uti-
lisées systématiquement.
Dans les formes rebelles à ce traitement
de base, une antibiothérapie prolongée
par cyclines ou azithromycine sera le
plus souvent efficace. L’azithromycine
est particulièrement intéressante car,
du fait de sa demi-vie longue, elle per-
met une administration discontinue. Par
voie orale, on peut proposer le schéma
suivant : 250 mg matin et soir 3 jours de
suite, 1 à 3 fois par mois. Par voie locale
en collyre, un traitement de 3 jours
Fig. 3 : Blépharite d’une dermatite atopique.

réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie # 256_Novembre 2016_Cahier 1
11
des traitements nécessitent une collabo-
ration étroite entre les deux spécialités
concernées.
Pour en savoir plus
• Doan S. La sécheresse oculaire : de la clinique
au traitement. Med’com, 2009, Paris, 192 pp.
• Doan S, MorteMouSque B, PiSella PJ. L'allergie
oculaire : du diagnostic au traitement.
Med’com, 2011, Paris, 256 pp.
L’auteur a déclaré être consultant pour les
laboratoires Alcon, Allergan, Bausch & Lomb,
Horus, Santen, Thea.
met non seulement un meilleur contrôle
de l’eczéma, mais il a aussi souvent un
effet bénéfique sur l’atteinte oculaire
même. Il permet fréquemment de dimi-
nuer l’utilisation de collyre anti-inflam-
matoire.
Dans les formes très sévères cécitantes,
un traitement immunosuppresseur sys-
témique (ciclosporine, tacrolimus, myco-
phénolate mofétil) peut être indiqué.
Enfin, une chirurgie cornéenne recons-
tructrice à type de greffe peut être néces-
saire, mais elle a souvent un pronostic
médiocre.
[ Conclusion
Les blépharites avec atteinte cutanée
sont fréquentes et variées. La spécificité
des tableaux oculaires ainsi que celle
Les poussées inflammatoires nécessitent
fréquemment le recours aux corticoïdes
en collyre. En cas de corticodépendance,
la ciclosporine en collyre peut être ten-
tée, mais elle est mal tolérée.
>>> Traitements cutanés
Comme dans tout eczéma, on utilise des
produits hydratants et des dermocorti-
coïdes de faible puissance. Une surveil-
lance initiale de la tension oculaire doit
être demandée en cas d’utilisation quo-
tidienne afin de dépister une hypertonie
oculaire cortico-induite. Cette complica-
tion est une éventualité rare, survenant
en général dès le début du traitement,
mais qui peut évoluer vers un glaucome
cortisonique si elle n’est pas dépistée.
Le tacrolimus en pommade cutanée à
basse concentration appliqué sur les
paupières est extrêmement utile. Il per-
1
/
3
100%