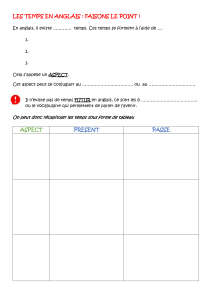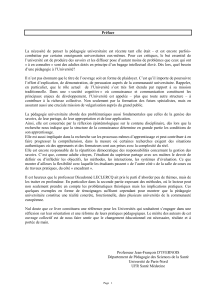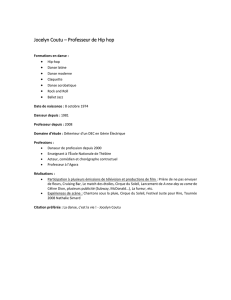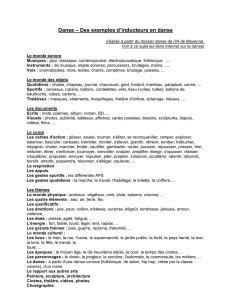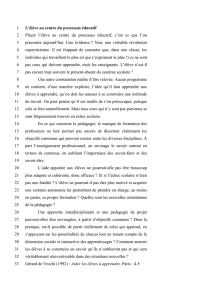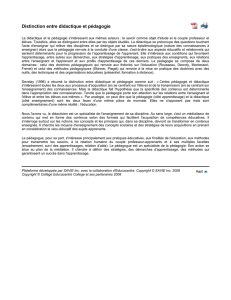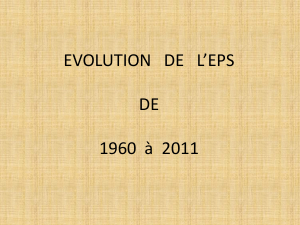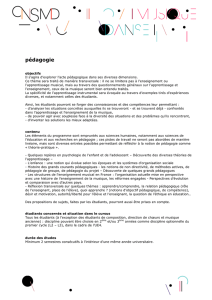Toute culture véritable est prospective. Elle n`est point la stérile

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE
Toute culture véritable est
prospective. Elle n’est point
la stérile évocation
des choses mortes, mais
la découverte d’un élan
créateur qui se transmet
à travers les générations
et qui, à la fois réchauffe
et éclaire. C’est ce feu,
d’abord, que l’Éducation
doit entretenir.
Gaston Berger
« L’Homme moderne
et son éducation »

© INRP, 2010 — Tous droits réservés
ISBN : 978-2-7342-1186-0
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE
Service des publications
19, allée de Fontenay — BP 17424 — F-69347 LYON CEDEX 07
Tél. +33 (0) 4 72 76 61 58 — Fax +33 (0) 4 72 76 61 68
Rédaction de la revue : Tél. +33 (0) 4 72 76 61 59 — [email protected]
Page Internet de la revue : <www.inrp.fr/editions/rfp>
Vous pouvez adresser vos réactions, propositions, interventions diverses
aux rédacteurs en chef par courriel aux adresses suivantes :
Cet espace de dialogue permet d’informer la rédaction des attentes
et des vœux du lectorat de la Revue française de pédagogie.
Une note aux auteurs, comportant les orientations éditoriales, les consignes bibliographiques
et typographiques ainsi que les conditions de soumission est disponible
au format PDF sur Internet à l’adresse suivante :
<www.inrp.fr/editions/revues/revue-francaise-de-pedagogie/consignes-aux-auteurs>
Les articles de la Revue française de pédagogie sont désormais
indexés à l’aide du Thésaurus européen des systèmes éducatifs (TESE).
La Revue française de pédagogie est référencée dans la base de données FRANCIS
produite par l’Institut de l’information scientifique et technique (INIST-CNRS).

REVUE FRANÇAISE DE PÉDAGOGIE | N° 170 | JANVIER-FÉVRIER-MARS 2010
Sommaire
Varia
Laurent Cosnefroy – Se mettre au travail et y rester : les tourments de
l’autorégulation p. 5
Carine Guérandel & Fabien Beyria – La mixité dans les cours d’EPS d’un collège
en ZEP : entre distance et rapprochement des sexes p. 17
Samuel Julhe & Stéphanie Mirouse – Entrer dans la danse : divergence des
« systèmes de pertinence » entre enfants, parents et enseignants p. 31
Céline Piquée – Pratiques enseignantes envers les élèves en difficulté dans
des classes à efficacité contrastée p. 43
Alexis Spire – Les effets politiques des transformations du corps enseignant p. 61
Pierre Merle – Structure et dynamique de la ségrégation sociale dans les collèges
parisiens p. 73
NOTE DE SYNTHÈSE
Marie-Pierre Chopin – Les usages du « temps » dans les recherches
sur l’enseignement p. 87
NOTES CRITIQUES
Robin Alexander – Essays on pedagogy (Maroussia Raveaud) p. 111
François Audigier & Nicole Tutiaux-Guillon – Compétences et contenus.
Les curriculums en questions (Joël Lebeaume) p. 114
Jesús Bermejo Berros – Génération télévision. La relation controversée de l’enfant
avec la télévision / Mon enfant et la télévision (Geneviève Jacquinot-Delaunay) p. 116
Jean Bréhon & Olivier Chovaux – Études sur l’EPS du Second Vingtième Siècle
(1945-2005) (Yvon Léziart) p. 118
Michel Brossard & Jacques Fijalkow – Vygotski et les recherches en éducation et
en didactiques (Vincent Charbonnier) p. 120
Max Butlen – Les politiques de lecture et leurs acteurs, 1980-2000 (Emmanuel Fraisse)
p. 123
André Chervel – L’orthographe en crise à l’école. Et si l’histoire montrait le
chemin ? (Danièle Cogis) p. 125
Xavier Dumay & Vincent Dupriez – L’efficacité dans l’enseignement. Promesses
et zones d’ombre (Romuald Normand) p. 126
Vincent Dupriez, Jean-François Orianne & Marie Verhoeven – De l’école au
marché du travail, l’égalité des chances en question (Josiane Vero) p. 129
Jacques Lautrey, Sylvianne Rémi-Giraud, Emmanuel Sander & Andrée
Tiberghien – Les connaissances naïves (Claude Bastien) p. 131
Martin Lawn – An Atlantic crossing? The work of the International examination
inquiry, its researchers, methods and influence (Pierre Vrignaud) p. 132
Isabelle Vinatier & Marguerite Altet – Analyser et comprendre la pratique
enseignante (Laurent Talbot) p. 134

REVUE FRANÇAISE DE PÉDAGOGIE | N° 170 | JANVIER-FÉVRIER-MARS 2010
Sommaire
LA REVUE A REÇU p. 137
SUMMARIES p. 139
RESÚMENES p. 142
ZUSAMMENFASSUNGEN p. 145
TABLE DES ARTICLES, NOTES DE SYNTHÈSE ET NOTES CRITIQUES PARUS
EN 2009 p. 149

Revue française de pédagogie | 170 | janvier-février-mars 2010 5-15
Varia
conduites d’auto-évaluation. À la maison, le profes-
seur n’est plus là pour porter assistance, empêcher
la dispersion et prodiguer des encouragements. Il
revient à l’élève de prendre en charge l’ensemble
de ces processus et de trouver en lui-même des
ressources pour se mettre au travail et y rester.
Ces caractéristiques font du travail à la maison une
forme particulière d’apprentissage autorégulé, c’est-
à-dire un ensemble de « processus par lesquels
les sujets activent et maintiennent des cognitions,
des affects et des conduites systématiquement orien-
tés vers l’atteinte d’un but » (Schunk, 1994, p. 75).
L’appren tissage autorégulé se traduit par un fonction-
nement autonome, le sujet trouvant en lui-même des
ressources pour entrer dans le travail, résister aux
Le travail scolaire se présente sous la forme d’une
alternance régulière entre le travail en classe et
le travail à la maison. Si le second s’inscrit dans la
continuité du premier, ces deux lieux de l’étude n’en
constituent pas moins deux univers distincts. Le
travail à la maison impose des tâches spécifiques
(apprendre une leçon, réviser un contrôle), de même
qu’il requiert un mode de fonctionnement à bien des
égards différent de celui qui est mobilisé en classe.
La liberté de s’organiser comme on l’entend et de
définir soi-même la quantité de travail à effectuer
s’oppose au rythme contraint de la classe et à la
tutelle exercée par le professeur (Barrère, 1997). Ce
dernier soutient l’élève dans son travail en l’aidant à
maintenir l’effort, à focaliser son attention sur les
informations importantes et à mettre en œuvre des
Cet article aborde le travail à la maison des lycéens en se référant à la théorie de l’apprentissage autorégulé.
Lors de notre étude, 202 élèves de seconde ont répondu à une question ouverte destinée à mieux connaître
les stratégies utilisées pour réguler leur effort. Identifier des buts qui donnent sens au travail, se protéger de
la distraction et planifier le travail à faire constituent trois compétences-clés pour s’autoréguler. La comparaison
entre élèves en difficulté et bons élèves montre que ces derniers ont beaucoup plus développé de compétences
de planification et d’organisation du travail.
Descripteurs (TESE) : devoirs, stratégie d’apprentissage, autonomie, motivation, école secondaire.
Se mettre au travail et y rester :
les tourments de l’autorégulation
Laurent Cosnefroy
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
1
/
160
100%