bio-indication et évaluation des impacts écologiques des rejets

BIO-INDICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS ÉCOLOGIQUES DES
REJETS URBAINS DE TEMPS DE PLUIE
Yannis FERRO
(1)(2)
, Claude DURRIEU
(2)
, Hélène Arambourou
(3)
(1)
CETE Méditerranée, Pôle d’activité, 30 avenue Albert Einstein CS 70 499 13593 Aix-en-Provence Cedex 3,
(2)
ENTPE – LEHNA, Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin, [email protected]
(3)
CETE Ile de France, 12 rue Teisserenc de Bort, 78197 Trappes en Yvelines Cedex
Résumé :
La seule connaissance de la composition physico-chimique d’un échantillon ne permet pas de connaître son
impact écologique sur le milieu récepteur. Partant de ce constat, si l’on souhaite évaluer cet impact, il est
aujourd’hui indispensable d’avoir recours à des outils, tels que les bio-indicateurs, qui intègrent les effets
d’une pollution chronique. Si les bio-indicateurs communautaires reposant sur l’étude de la composition
d’une communauté d’organismes dans le milieu ont été largement utilisés dans le cadre de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), les bio-indicateurs reposant sur l’étude d’effets bio-chimiques,
physiologiques ou morphologiques au niveau de la population ou bien de l’individu sur des espèces
préalablement sélectionnées sont à ce jour peu utilisés. Ces bio-indicateurs pourraient s’avérer
particulièrement intéressants, car ils sont capables de mettre en évidence une pollution de façon précoce.
Cet article présente les principes importants lors de la sélection d’organismes et de marqueurs d’écotoxicité
pertinents dans l’étude des impacts écologiques des rejets urbains de temps de pluie sur les écosystèmes
récepteurs.
Mots clefs :
bio-indicateurs, bio-marqueurs, écotoxicologie, bio-indication.
Introduction
La qualité d’un milieu ne se résume pas à sa simple composition chimique. Partant de ce constat, les
politiques européennes, en particulier la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), exigent une restauration du bon
état chimique mais également écologique des masses d’eaux [Le parlement européen et le conseil de
l’union européenne, 2000]. Le respect de ces engagements passe par une meilleure gestion des rejets
urbains de temps pluie. Un suivi physicochimique est possible à l’aide de prélèvements ponctuels et
d’analyses de laboratoire. Ces analyses, performantes à l’échelle d’un site et d’un échantillon, ne sont pas
adaptées au suivi de plusieurs rejets dans la durée. En effet cette démarche a montré ses limites en raison
de la variabilité extrême des effluents et du coût des analyses. En outre, à partir des seules informations
physico-chimiques, il n’est pas possible de prédire l’effet du rejet sur une masse d’eau donnée et encore
moins l’atteinte écologique.
Une autre voie consiste alors à s’intéresser non pas à la composition du rejet, mais directement à son impact
sur l’écosystème récepteur à l’aide de bio-indicateurs.
Deux types de bio-indicateurs sont généralement distingués : les bio-indicateurs reposant sur l’étude de la
composition d’une communauté (c’est-à-dire l’ensemble des populations) ou bien les bio-indicateurs,
encore appelés bio-marqueurs, reposant sur l’étude des changements comportementaux,
physiologiques et bio-chimiques d’un taxon donné. Si les premiers bio-indicateurs sont aujourd’hui les
plus utilisés pour évaluer l’état écologique d’un milieu (DCE), ils renseignent, en revanche, peu sur les effets
sub-létaux d’une pollution chimique. Or, si l’on veut pouvoir agir rapidement au cours d’un processus de
dégradation, il s’avère aujourd’hui indispensable pour le gestionnaire d’avoir accès à des informations
précoces.
L’objectif de cet article est de définir et de présenter les différents bio-indicateurs de qualité des
écosystèmes aquatiques pouvant permettre en évidence les effets d’un Rejet Urbain de Temps de Pluie
(RUTP). Les bio-indicateurs communautaires sont largement décrits dans la littérature, aussi, nous nous
attacherons plus particulièrement à présenter les bio-marqueurs susceptibles d’être utilisés pour
caractériser ces rejets. Nous montrerons également l’intérêt de ce type d’approche en présentant les
résultats de travaux issus de littérature concernant les impacts des RUTP sur différentes masses d’eaux.

1 Définitions et généralités
1.1 Différentes échelles d’observation en bio-indication
Premièrement, il existe les bio-indicateurs communautaires qui reposent sur l’étude de la présence et de
l’absence d’un taxon dans une communauté d’organismes. Ces indicateurs sont aujourd’hui largement
utilisés pour évaluer l’état d’un écosystème dans le cadre de la DCE. En particulier, pour évaluer l’état d’un
milieu aquatique, les gestionnaires ont aujourd’hui recourt aux indicateurs normalisés tels que l’indice
macrophytes (NF T90-395/2003), l’indice macro-invertébrés benthiques (NF T90-350/2004), l’indice poisson
(NF T90-344/2004), l’indice diatomées (NF T90-354/2007) ainsi que l’indice oligochètes (NF T90-390/2002).
Ces bioindicateurs ont pour avantage d’être très représentatif du fonctionnement écologique d’un
écosystème (Figure 1). En revanche, ils donnent peu d’informations quant aux effets sub-létaux, c’est-à-dire
survenant avant la disparition d’un organisme. En outre, s’ils sont sensibles à des altérations physiques ainsi
qu’aux apports de matière organique, ils répondent peu à l’apport de micro-polluants dans le milieu.
Figure 1 : niveau d’organisation biologique et bio-indication
Deuxièmement, il existe les bio-indicateurs populationnels et individuels. Ces bio-indicateurs, appelés
également bio-marqueurs ,sont peu représentatifs du fonctionnement écologique d’un écosystème (Figure
1) mais ils présentent l’intérêt de donner une information précoce sur la dégradation chimique d’un milieu.
Selon [Lagadic et al. 1997], « Le terme de biomarqueurs désigne des changements structuraux ou
fonctionnels observables et mesurables, qui prennent place à différents niveaux de l’organisation biologique,
depuis la molécule jusqu’à l’organisme pris dans son intégralité, qui traduisent une exposition persistante ou
passée d’un individu à une ou plusieurs substances polluantes. »
Parmi tout un ensemble de biomarqueurs, on distingue les bio-marqueurs d’exposition qui mettent en
évidence l’activation des mécanismes de compensation des bio-marqueurs d’effets qui renseignent sur le
dépassement de ces mécanismes (Figure 2). L’utilisation des bio-marqueurs se fait au travers des tests
écotoxicologiques, que nous présentons dans le paragraphe ci-après.

Figure 2 : les bio-marqueurs à l’échelle de la population et de l’individu, d’après [Depledge, 1994]
1.2 Les tests écotoxicologiques
Pour de déterminer l’impact d’une matrice ou d’une molécule sur un organisme (échelle de l’individu) ou sur
un groupe d’organismes (échelle de la population), il a été mis au point des bio-essais écotoxicologiques,
appelés aussi tests d’écotoxicologie. Ces bio-essais ont pour objectif selon [Ramade, 2007] « d’évaluer le
degré de sensibilité (ou de résistance) à tel ou tel polluant toxique chez les diverses espèces animales ou
végétales. En pratique on cherche à déterminer les différentes formes de toxicité (par contact, par inhalation,
ou par ingestion), et à faire une évaluation quantitative de leurs principaux effets létaux ou sublétaux. »
Ces essais, menés en conditions contrôlées, permettent en particulier de mesurer la réponse d’un bio-
marqueur à l’échelle d’un individu ou d’une population, après exposition à un toxique. Comme le
souligne [Ramade, 2007], si l’on souhaite obtenir une vision représentative de l’effet d’une pollution sur un
écosystème, il est important de mener ces bioessais « sur les divers types écologiques d’êtres vivants
(producteurs, consommateurs, décomposeurs) ».
1.3 Les organismes modèles utilisés en bio-indication
Le choix des espèces modèles pertinentes en bio-indication est une préoccupation constante de l’écologue
et de l’écotoxicologue. Les caractéristiques d’une espèce modèle sont les suivantes [Ramade, 2007] :
tous les individus d’une espèce bio-indicatrice devraient présenter une corrélation identique et simple entre
leur teneur en la substance polluante et la concentration moyenne de cette dernière dans le biotope ou dans
l’alimentation quelles que soient la localisation et les conditions environnementales ;
l’espèce devrait être sédentaire afin d’être sûr que les concentrations trouvées soient bien en rapport avec
sa contamination dans le site géographique où elle a été prélevée ;
l’espèce devrait être abondante dans l’ensemble de l’aire étudiée et si possible avoir une distribution
biogéographique étendue afin de favoriser les comparaisons entre zones distinctes ;
les espèces à forte longévité sont préférables parce qu’elles permettent un échantillonnage sur plusieurs
classes d’âge si nécessaire. En outre, les espèces à forte longévité subissent une exposition à un
contaminant pendant de longues périodes ce qui par suite permet de disposer de preuves expérimentales
sur les effets à long terme ;
l’espèce devrait être facile à échantillonner et assez résistante pour être amenée en laboratoire afin de
réaliser par exemple des études de décontamination.
Voyons maintenant comment s’appliquent ces grands principes à l’évaluation de l’impact écologique des
RUTP.

2 L’évaluation écotoxicologique des RUTP : approches substance et matrice
La caractérisation des effets écotoxicologiques d’un échantillon consiste à mettre en évidence sa capacité à
agir sur les organismes du milieu récepteur considéré. On cherche en général à observer un effet délétère
sur une fonction (bio-marqueur) de cet organisme (croissance, métabolisme, reproduction, …). La principale
finalité de cette caractérisation est de parvenir à évaluer la concentration prédite sans effet (PNEC
predicted no effect concentration) pour l’échantillon concerné [Angerville, 2009].
Il est reconnu que les actions combinées (effets de synergie et/ou d’antagonisme) liées à la présence de
mélanges de polluants dans les RUTP ne peuvent être prévues à partir de la seule connaissance des
concentrations chimiques en ces polluants. L’utilisation d’essais sur les organismes biologiques permet de
pallier ces manques [ADEME, 2005].
On peut procéder à la caractérisation écotoxicologique d’un rejet au moyen de deux approches
complémentaires : soit on considère l’échantillon comme un tout indivisible, donc une « matrice », soit on
l’approche en fonction de ses différentes composantes, c’est l’approche dite « substances ».
2.1 Approche substance
Les approches « substances » impliquent deux étapes complémentaires. On fait tout d’abord appel à
l’analyse physico-chimique de la matrice polluante concernée en vue de déterminer les polluants qu’elle
contient. Ces polluants sont les agents potentiellement dangereux à partir desquels on réalisera la
caractérisation des effets de la matrice étudiée. Un nombre important de ces composés peut être mis en
évidence dans une matrice polluante, cependant il est admis de procéder au choix de certains composés qui
joueront alors le rôle de « traceurs de risque ». Le choix des traceurs découle d’un consensus permettant de
retenir un ensemble de polluants pertinents et/ou spécifiques au scénario étudié. Ces traceurs de risque
peuvent, par conséquent, être de natures diverses : inorganiques, organiques ou biologiques.
On procède ensuite à la mise en œuvre d’essais écotoxicologiques sur des gammes de concentrations des
traceurs de risques sélectionnés. Cette approche est conseillée lorsqu’il s’agit d’une matrice relativement
bien connue et relativement simple (c’est-à-dire dans laquelle seuls quelques toxiques prédominent).
2.2 Approche matrice
Tout comme l’approche « substances », l’approche « matrice » réclame la mise en œuvre d’essais
écotoxicologiques en vue d’apprécier les effets d’une matrice sur des organismes. Mais dans le cadre de
cette approche on expose les organismes considérés à la matrice tout entière. On utilise cette approche
lorsqu’aucun toxique ne domine dans la matrice et/ou que la nature des substances présentes est incertaine.
Pour mettre en évidence des effets, il est possible d’utiliser différents niveaux d’organisation biologique et
différentes échelles d’expérimentation. On peut sélectionner un certain nombre de bioessais mono-
spécifiques qui constitueront une « batterie de bioessais mono-spécifiques », tout comme on peut recourir à
des « bioessais pluri-spécifiques ». La notion de batterie de « bioessais mono-spécifiques » fait référence à
différents bioessais (normalisés ou non) réalisés séparément sur la même matrice (ou le même polluant).
Les « bioessais pluri-spécifiques » font intervenir plusieurs espèces d’organismes mais simultanément au
contact de la matrice, avec des niveaux d’organisation écologiques supérieurs (cf. partie 3).
L’analyse physico-chimique de la matrice polluante étudiée ne joue donc plus le rôle prépondérant qui lui est
attribué dans les approches « substances » pour l’estimation des valeurs de PNEC. Néanmoins, la
caractérisation physico-chimique de la matrice apporte des informations complémentaires sur les
concentrations en éléments potentiellement toxiques présents dans cette matrice.
La figure 3 compare caractéristiques, avantages, limites et applicabilité de ces deux types d’approche.

Figure 3 : tableau comparatif des approches substances et matrices [ADEME, 2007]
Attardons-nous maintenant sur les bio-essais pouvant être utilisés dans le cadre d’une étude portant sur les
impacts écologiques des RUTP.
3 L’évaluation écotoxicologique des RUTP : les essais en conditions contrôlées
Chez un organisme vivant, un stress toxique agit à différents niveaux : de la molécule à la physiologie en
passant par la cellule [Moore et al., 1987] et à différentes échelles de temps. Ainsi, afin de mettre en
évidence ce stress chez les macro-invertébrés aquatiques, différents biomarqueurs, correspondant à des
échelles de travail différentes, ont été proposés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%

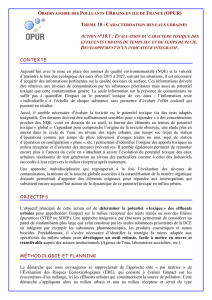
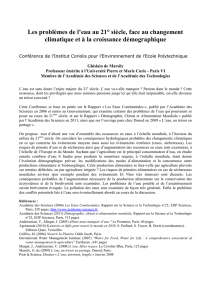
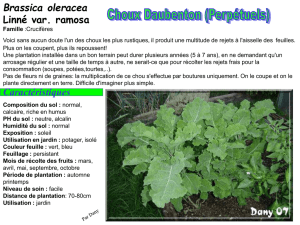
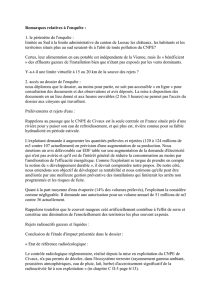
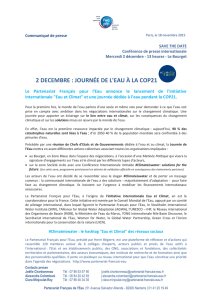

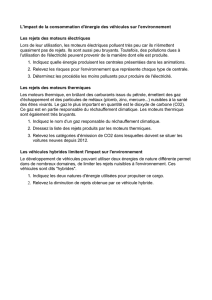
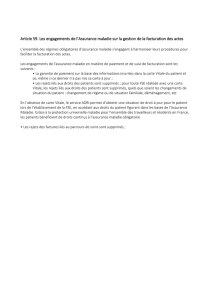


![(Intro Herve Jourdan [Mode de compatibilité])](http://s1.studylibfr.com/store/data/002610473_1-b1a16f4aedaac97dc8dc1a4cb4713839-300x300.png)