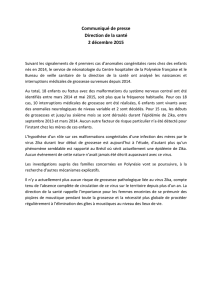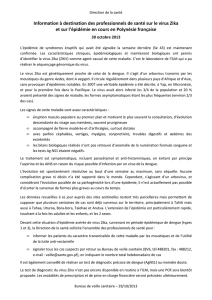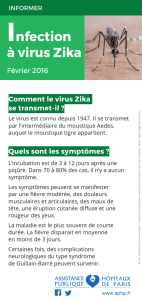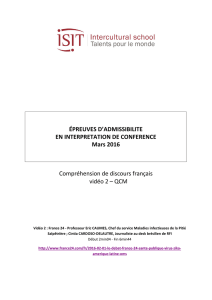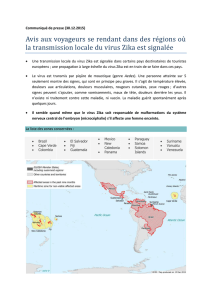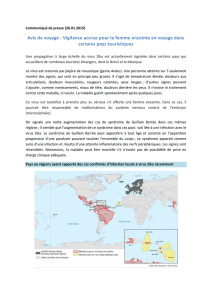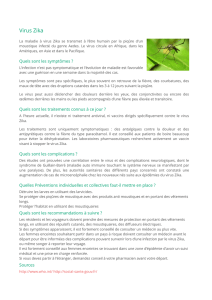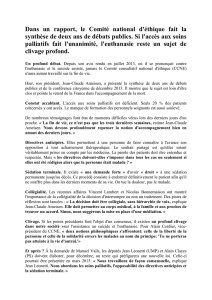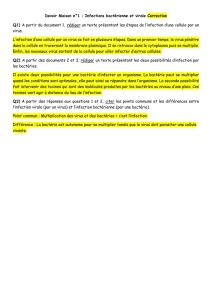RDP n° 303 du CCNE

1
ÉTHIQUE
Tests génétiques: il est urgent d'ouvrir le débat
Le Figaro du 28 janvier 2016 par Pauline Fréour
Le Comité consultatif national d'éthique publie un avis sur les enjeux économiques, sociétaux
et scientifiques du décryptage de l'ADN.
Le génome dans le carnet de santé. Ce qui relevait hier encore de la science-fiction paraît de plus en
plus plausible. Les progrès techniques spectaculaires du séquençage génétique à haut débit observés
depuis la publication du premier génome humain il y a douze ans permettent en effet de disposer
d'une transcription complète des 25 000 gènes d'un être humain en quelques heures et pour à peine
plus d'un millier d'euros. Mais pareil élargissement du savoir génétique individuel est-il seulement
souhaitable ? « Jusqu'où a-t-on le droit d'aller ? », traduit le Comité consultatif national d'éthique
(CCNE), qui présentait vendredi son dernier travail sur le sujet, « Réflexion éthique sur l'évolution
des tests génétiques liée au séquençage de l'ADN humain à très haut débit ».
Dans ce texte de 80 pages, le CCNE, qui compte une quarantaine de membres (scientifiques,
médecins, philosophes, juristes…), pose de nombreuses questions sur les enjeux scientifiques,
sociétaux et financiers du sujet, sans rien préconiser. « En émettant des recommandations, on
donnerait l'impression que la question est simple. Alors qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour
réfléchir, ouvrir un débat », justifie Jean Claude Ameisen, président du CCNE. Force est de
constater que la position actuelle de la France, qui interdit tout test génétique d'initiative
personnelle, semble un peu déconnectée. Plusieurs sociétés étrangères proposent en effet d'évaluer
les risques individuels pour une série de pathologies, sur simple envoi d'un échantillon d'ADN. « À
ce que je sache, personne n'a encore été condamné pour avoir envoyé un test salivaire en Californie
», ironise le Pr Patrick Gaudray, président du groupe de travail pour cet avis.
En interdisant ce genre de pratique, le législateur entend protéger les individus contre la réception
d'une information sensible et complexe sans accompagnement. Car la génomique n'est pas une
science exacte. Il ne s'agit pas de tomber dans le piège du « déterminisme génétique » qui consiste à
penser que l'ADN « fait tout » alors que l'histoire personnelle de chacun et le milieu de vie sont
déterminants dans le développement de la majorité des maladies. La généralisation du séquençage
de génome entier pose avec acuité la question de la propriété et de la protection d'informations
personnelles massives, dont le stockage a un coût, mais aussi du droit de savoir, ou de ne pas savoir.
Cette technologie augmente les chances de découvrir des informations que l'on ne recherchait pas
d'emblée. Ainsi, une personne testée pour une maladie X doit-elle être mise au courant de son
surrisque de maladie Y - sachant qu'il ne s'agit que d'une probabilité ? Cette personne a-t-elle la
responsabilité d'en informer sa parentèle, qui partage avec elle de l'ADN ? « Il peut y avoir une
certaine pression sociale à savoir », note Cynthia Fleury, rapporteur de l'avis.
Les experts s'interrogent aussi sur l'avènement possible de « devoirs comportementaux », dans la
mesure où il devient possible d'identifier les individus à fort risque de développer des maladies
coûteuses pour la société, comme le diabète ou l'hypertension, dont on sait qu'elles sont en partie
évitables avec une bonne hygiène de vie. Dans quelle mesure peut-on être tenu responsable de sa
santé ou de celle de son enfant ?

2
Des tests en vente libre aux Etats-Unis
Le Figaro du 28 janvier 2016 par Aude Rambaud
À partir de cette année, plusieurs sociétés américaines proposent le séquençage génétique
pour tous au nom du « droit de savoir », mais sans aucun encadrement et sans autorisation
officielle.
Ça y est, le premier test génétique à destination du grand public a reçu la bénédiction des autorités
de santé aux États-Unis. Une petite révolution sociale. N'importe qui peut désormais obtenir des
informations sur son ADN sans passer par son médecin et dans le respect des contraintes
réglementaires du pays. La pratique n'est pas nouvelle et remonte à 2007. À partir de cette année,
plusieurs sociétés américaines proposent le séquençage génétique pour tous au nom du « droit de
savoir », mais sans aucun encadrement et sans autorisation officielle. C'est le cas de 23andMe avec
son « Personal Genome Service », mais aussi de Pathway Genomics, Navigenics ou encore
DecodeMe. Le succès est immédiat, des dizaines de milliers d'Américains se jettent dessus.
Mais la FDA, l'autorité de santé américaine, ne l'entend pas de cette oreille. Après plusieurs
échanges avec les fabricants demandant à prouver la fiabilité des résultats, elle décide finalement
d'interdire ce type de test en 2013. Elle s'inquiète des conséquences de résultats faussement positifs
ou faussement négatifs chez les utilisateurs. Il faut dire qu'à l'époque, les fabricants n'y vont pas de
mainmorte et prétendent informer sur le risque de cancer, de maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou
encore de maladies cardiovasculaires qui dépendent en fait d'un très grand nombre de facteurs de
risque autres que génétiques.
« Les résultats pouvaient suggérer une pathologie qui ne viendrait pas ou, au contraire, en écarter
une autre pouvant survenir », explique le Pr Hervé Chneiweiss, chercheur en neurosciences,
président du comité d'éthique de l'Inserm et membre du Comité consultatif national d'éthique
(CCNE). « Les mutations des gènes BRCA 1 et 2 impliqués dans la survenue des cancers du sein et
de l'ovaire augmentent par exemple de 50 à 70 % le risque de survenue de ces cancers, ce qui
justifie un suivi particulier, mais des femmes porteuses de ces gènes ne tomberont finalement pas
malades. Or la présence de ces mutations génère de l'angoisse, voire des interventions préventives
radicales comme l'ablation des seins. À l'inverse, d'autres femmes ne présentant pas ces mutations
développeront quand même un cancer, mais ne feront rien pour limiter d'autres risques, se pensant
épargnées », illustre Hervé Chneiweiss.
Suite à ce coup d'arrêt, 23andMe se rapproche de la FDA pour proposer un produit répondant aux
critères fixés par l'agence. Un coup de maître qui lui vaut de relancer son « Personal Genome
Service » avec un tampon officiel « FDA approval » en 2015 qui fait office de garantie pour les
utilisateurs. La FDA « appréciant le fait que le grand public puisse obtenir des informations sur son
génome et ses risques de développer des maladies afin de les responsabiliser sur certains aspects de
leur santé et d'en apprendre plus sur les risques génétiques ». Pour cela, l'entreprise a cependant
pratiqué un lifting important sur son produit. Exit les marqueurs de risque de maladies
multifactorielles, telles que le cancer et la maladie d'Alzheimer. Exit aussi les données de sensibilité
à certains médicaments autrefois disponibles. Le nombre de marqueurs a été réduit à une
soixantaine et cible désormais des maladies génétiques transmissibles graves comme la
mucoviscidose et des caractères non médicaux : sensibilité à l'alcool, consommation de caféine,
intolérance au lactose et plusieurs traits physiques, comme la couleur des yeux ou la nature des
cheveux inscrits dans les gènes. Enfin, la société a nettement misé sur la composante « histoire
personnelle ». Le test permet en effet de retrouver ses origines en comparant ses liens génétiques
avec 31 populations du monde et en analysant la provenance maternelle ou paternelle de ces
origines. Les utilisateurs peuvent même comparer leur ADN avec ceux des membres de leur famille
au risque d'y découvrir des surprises, voire retrouver des affiliés dans la base de données 23andMe
s'ils acceptent d'y figurer.

3
De sorte que la page Facebook de l'entreprise croule sous les témoignages de personnes qui
découvrent avoir été adoptées, dont la sœur est finalement la demi-sœur, ou qui recherchent leur
père biologique !
En France, cette pratique est totalement interdite. La loi restreint l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins médicales, de recherche scientifique, d'identification post-
mortem ou d'enquêtes judiciaires. « La loi a tranché sur le fait que, en dehors de ces motifs, nul ne
peut avoir accès aux caractéristiques génétiques de l'individu, même pas soi-même ! En France, il
n'y a pas de liberté individuelle face à l'ADN en raison de la protection des données identifiant
chaque personne. Aucune de ces données n'étant anodine », rappelle Hervé Chneiweiss. En outre, la
réalisation des analyses génétiques est très encadrée. À des fins médicales, elle doit être prescrite
par un médecin et assortie de « conseil génétique, consentement du patient, accréditation des
laboratoires de génétique par les agences régionales de santé ou encore agrément des praticiens par
l'Agence de la biomédecine », rappelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé française (ANSM).
Tests génétiques : s’assurer de la vérité du
consentement
Le Quotidien du Médecin du 28 janvier 2016 par Coline Garré
Dans son avis 124, rendu public le 21 janvier, le comité consultatif national d’éthique (CCNE) a
souhaité éclairer « la complexité » des questions éthiques que suscitent les tests génétiques et le
séquençage de l’ADN humain à très haut débit.
Parmi les questions brûlantes, figure celle du consentement libre et informé, fondement du droit
médical et de la bioéthique. « Ce dispositif nécessite d’être entièrement revu », dit le CCNE. À la
croisée de la recherche et de la pratique médicale, le séquençage à très haut débit rend poreuse la
différence entre le consentement général et ouvert (requis dans les programmes de recherche) et un
consentement restreint, conditionné à une information précise, localisée dans le temps. Quel type de
consentement demander lorsque le séquençage global du génome devient une facilité technique, ou
une nécessité (comme en oncologie pour comparer le génome tumoral au génome constitutionnel) ?
D’autre part, où est l’autonomie du patient ? Une personne en situation de vulnérabilité médicale
peut-elle librement refuser ou donner son consentement ? « Le consentement ne doit en aucun cas
être l’alibi d’un choix forcé », dit la philosophe Cynthia Fleury, co-rapporteur de l’avis. « Il serait
irresponsable de ne pas s’inquiéter de la vérité du consentement », poursuit-elle.
Risques psychologiques
Autre question : comment respecter le droit de ne pas savoir ? Les risques psychologiques liés à
l’annonce du résultat d’un test génétique ne sont pas à minimiser, alerte le CCNE. « Le temps se
télescope entre l’état de santé et l’état de la maladie », explique Cynthia Fleury. La maladie risque
de devenir la seule certitude d’une vie, qu’elle finit par caractériser. Et que faire lorsqu’on ne sait
pas soigner la maladie ? L’annonce du résultat doit être anticipée, à travers un entretien
psychologique qui familiarise avec une pensée de l’incertitude. « Le conseil génétique doit faire
réfléchir : 50 % des jeunes qui se rendent à la consultation de La Pitié Salpêtrière sur la maladie
de Huntington finalement décident de ne pas savoir », illustre Jean Claude Ameisen.

4
L’information génomique conduit enfin à réfléchir à la propriété de ses données. En France, la loi
du 7 juillet 2011 rend obligatoire l’information de la parentèle en cas de diagnostic d’une maladie
génétique héréditaire grave. « Cela ne résout pas la question éthique de savoir annoncer un risque
de maladie à une parentèle qui n’est pas en demande », dit le CCNE. Dans la recherche, doit-on
parler d’un don d’information lorsqu’on s’engage dans un protocole ou qu’on intègre une cohorte ?
Peut-on récupérer ou effacer ses données si l’on change d’avis ? questionne Cynthia Fleury. Le
CCNE suggère de réfléchir à la formalisation d’un contrat de réciprocité entre l’individu et les
autorités publiques, la vie privée et la santé publique.
Breveter le vivant : faut-il l'autoriser ?
Sciences et Avenir du 28 janvier 2016 par Loïc Chauveau
Le Sénat a dit "non". Au cours de l’examen de la loi sur la biodiversité, il a étendu
l’interdiction de brevetage des fruits et légumes et de leurs composants génétiques issus de
procédés biologiques.
Depuis les débuts de l’agriculture, l’homme sélectionne les plantes les plus productives et les plus
résistances en les faisant se croiser. Les techniques se sont affinées tout au long du 20ème siècle avec
les progrès réalisés sur la connaissance de la génétique, notamment à partir des lois de Mandel. La
découverte de l’ADN en 1953 puis le séquençage des génomes de plantes et d’animaux ont permis
de mieux cibler les marqueurs génétiques porteurs de gènes d’intérêt (résistance à la sécheresse et à
des pathogènes, productivité). L’hybridation devient plus précise. Il est en effet désormais possible
d’introduire avec précision dans une plante cultivée un caractère présent dans une variété rustique.
Cette technique n’est pas aujourd’hui considérée comme une modification génétique, puisqu’il n’y
a pas introduction d’un gène étranger à la plante par transgenèse.
Quel est le débat sur les brevets ?
Depuis plusieurs années, de nombreuses associations comme Semences paysannes dénonce le
brevetage de plantes possédant ces gènes d’intérêt. Le risque dénoncé est que les agriculteurs soient
désormais obligés de payer des droits pour chaque semence utilisée. De même, les semenciers
pourraient être contraints à verser des droits de propriétés lors de leur recherche de nouvelles
variétés. En mars 2015, l’Office européen des brevets (OEB) a donné corps à leur inquiétude en
brevetant un brocoli porteur d’une substance favorable à la lutte contre le cancer (brevet déposé par
une petite entreprise anglaise de biotechnologie) et une tomate “ridée” pouvant pousser sans
consommer beaucoup d’eau (déposé par le ministère de l’Agriculture israélien). L’OEB a considéré
que le procédé pour obtenir ces vertus nutritionnelles ou agronomiques ne pouvait être breveté (ce
n’est après tout qu’une méthode sophistiquée de croisement végétal), mais que le produit, lui,
pouvait l’être.
Cette décision pose une réelle difficulté. Les gènes à l’origine de la substance anticancérogène
existent dans la nature, tout comme les gènes rendant les tomates plus sobres en eau. Ces “traits
natifs” se retrouvent donc sous la protection d’un brevet bénéficiant à son propriétaire. C’est cette
décision qui a amené le Sénat à voter en janvier 2016 à une forte majorité un amendement qui
interdit de brevetage les produits et les composantes génétiques issus de procédés biologiques. La
loi française n’annule en rien la validité des brevets européens accordés, mais il empêche toute
poursuite judiciaire des titulaires de ces brevets sur le territoire français. À noter que l’OEB fluctue
énormément sur ce sujet. L’office vient ainsi d’annuler un brevet accordé à Monsanto pour un
melon résistant à une maladie virale obtenu par croisement avec une variété rustique d’Inde.

5
Comment considérer les nouvelles techniques d’hybridation ?
Le Sénat s’est aussi penché sur les nouvelles techniques d’hybridation (New Breeding Techniques,
NBT). Ces procédés microbiologiques de modification génétique in vitro de cellules de plantes sont
brevetables, qu’ils aient ou non recours à la transgenèse. Mais les fruits et légumes obtenus sont
décrits dans les revendications de brevet d’une manière qui ne permet pas de les différencier de
produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, plaident les opposants au brevetage.
C’est d’ailleurs parce que leur produit est très proche des traits natifs que les sociétés de
biotechnologie estiment qu’elles ne fabriquent pas d’OGM. Les NBT ne seraient qu’un moyen
d’obtenir plus vite des variétés résistantes que par hybridation classique. Le Sénat a donc considéré
qu’un tel produit ne pouvait être brevetable.
OGM ou pas OGM ?
Cette position française (que l’Assemblée nationale devra confirmer en deuxième lecture de la loi
biodiversité) est un élément de plus dans un débat européen complexe. Depuis de longs mois, la
Commission européenne doit en effet décider d’un statut pour ces NBT. OGM ou pas OGM ? La
question est cruciale. Avec un statut OGM, fruits et légumes issus de NBT devront comporter un
étiquetage de provenance, ce que les industriels voudraient éviter, l’opinion publique européenne
étant majoritairement hostile à ces produits. À la présidence de l’Union européenne depuis le 1er
janvier, les Pays-Bas ont mis cette question à leur agenda de six mois. La commission européenne
de son côté a promis qu’elle donnerait un avis en avril. Le Sénat n’est donc pas allé jusqu’à voter
sur le caractère des NBT, dans l’attente des décisions à venir. En octobre 2015, 16 États européens
(dont la France) ont demandé l’interdiction de cultiver des OGM sur leur territoire.
Bioéthique: les embryons ne sont pas "un
matériau jetable", selon le pape
Belga News du 28 janvier 2016
Les embryons ne "doivent pas être traités comme un matériau jetable", tout comme les personnes
"qui s'approchent de la mort", a affirmé jeudi avec force le pape François devant le comité italien
de bioéthique.
"Le défi est de résister à la culture du déchet qui a tant de visages, parmi lesquels le traitement
comme un matériau jetable des embryons humains, tout comme des personnes malades et âgées qui
s'approchent de la mort", a affirmé le pape argentin en recevant les membres de ce Comité, institué
depuis plus de 25 ans auprès de la présidence du Conseil italien. Dans ses contacts avec le
gouvernement, le comité, s'est-il félicité, a plusieurs fois répété la nécessité de "l'intégrité de l'être
humain et de la protection de la santé depuis la conception jusqu'à la mort naturelle". "Un tel
principe éthique est fondamental aussi pour ce qui concerne les applications biotechnologiques
dans le domaine médical", qui "ne doivent jamais être guidées uniquement par des visées
industrielles ou commerciales", a-t-il insisté.
Alors que l'Eglise est souvent accusée de s'ingérer en Italie dans les débats sur les questions
délicates de société, de la bioéthique aux unions civiles gays (qui font l'objet d'un projet de loi
actuellement discuté au parlement), Jorge Bergoglio a souligné qu'"il n'est peut-être pas clair pour
tout le monde" que l'Eglise, bien que sensible à des "thématiques éthiques", "ne revendique aucun
espace privilégié dans ce domaine". "Elle est satisfaite dès lors que la conscience civile, à divers
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%