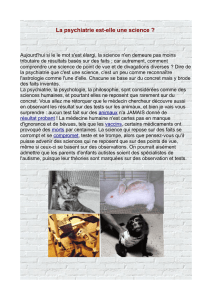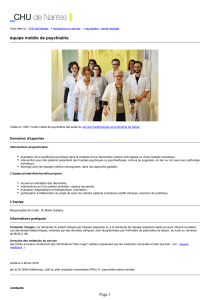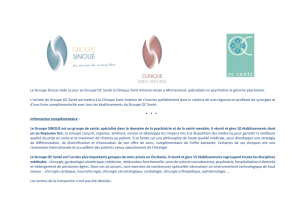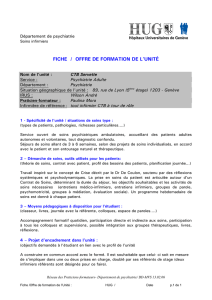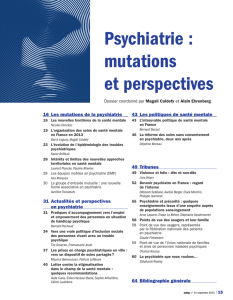Lire l`article

1/23
Coordination, partenariat, coopération entre professionnels de santé : la question
des réseaux de santé en psychiatrie
MC Hardy-Baylé, I Prade
Introduction
Cet article, qui prolonge celui de 2001 (1), se propose, sur la base des leçons tirées de
l’expérience du Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les Yvelines Sud
(RPSM 78), et d’une lecture, à la lumière de cette expérience, du contexte actuel de
l’organisation de l’offre de soins en psychiatrie, de répondre à la question posée aux auteurs :
pourquoi et comment, de manière concrète, construire un partenariat tel que la notion de
réseau tend à le promouvoir ?
Au-delà de cette question, et pour répondre aux difficultés rencontrées dans la généralisation
des réseaux en psychiatrie, nous tenterons, au fil de l’article, d’exposer ce qu’une telle
expérience peut nous dire sur les facteurs de résistance à la généralisation d’une telle
innovation législative dans une discipline dans laquelle elle s’imposerait pourtant tout
naturellement. Cette relative réserve des professionnels du soin en psychiatrie est d’autant
plus étonnante que les réseaux de soins représentent sans aucun doute l’une des opportunités
les plus adaptées à la discipline de lever les impasses qu’elle rencontre et de l’introduire dans
la « modernité » en réaffirmant les grands principes que la psychiatrie de secteur a toujours
défendus.
Cet article se propose de faciliter l’appropriation de la « culture réseau » par les
professionnels du soin en rappelant les attendus d’un réseau, tels que les textes nous les fixent,
et de promouvoir son développement en montrant comment le réseau, sur un territoire donné,
a permis à chacun des acteurs publics et privés, de trouver sa place et au secteur de renouer
avec une politique sectorielle qui peine à se développer.
Le Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les Yvelines sud (RPSM 78)
Structure juridique du réseau : Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
Zone géographique d’intervention : territoire de santé 78-1 (Yvelines sud)
Nombre d’habitants du territoire : 650 000
Nombre de secteurs de psychiatrie :
8 secteurs de psychiatrie générale
3 secteurs de psychiatrie infanto juvénile
1 secteur de psychiatrie pénitentiaire
Etablissements de santé membres du GCS :
Centre Hospitalier André Mignot de Versailles (public)
Centre Hospitalier Jean-Martin Charcot de Plaisir (public spécialisé)
Institut Marcel Rivière de La Verrière (privé mutualiste participant au service public)
Clinique d’Yveline (privé à but lucratif)
Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir-Grignon (public)
Centre Hospitalier de Rambouillet (public)

2/23
Libéraux partenaires du réseau :
246 médecins généralistes
15 psychiatres
14 psychologues
Médecins généralistes et psychologues sont impliqués dans le GCS, mais surtout dans le dispositif de soins partagés
ville/hôpital.
Partenariats non sanitaires principaux :
Structures et services sociaux et médico-sociaux (plus de 200 équipes en 8 ans)
13 Associations
14 Communes et structures publiques
Conseil Général des Yvelines
6 Associations d’usagers
Education Nationale (assistantes sociales et infirmières scolaires, lycées)
Ministère de la Justice
Financeurs stables du réseau :
Fond d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins
Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Ile de France
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale des Yvelines
Département des Yvelines
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dispositifs et thématiques du réseau :
Les actions matures :
Dispositif de soins partagés depuis 2000 entre médecins généralistes et système spécialisé
psychiatrique. Ce dispositif assure une activité dite « directe » auprès des patients adressés par leur médecin généraliste
constituée de « séquences thérapeutiques de courte durée » avant l’élaboration d’un projet de soin « négocié » avec le
médecin généraliste, une activité dite « indirecte », hors présence du patient, constituée d’actions de coopération
dématérialisées et d’actions de formation – supervision – intervision en direction des médecins généralistes et proposant
des prestations dérogatoires de psychothérapie avec les psychologues libéraux.
Dispositif mutualisé d’interface entre psychiatrie et secteur social et médico-social depuis 2000, sous
forme d’une équipe mobile territoriale de liaison développant une clinique de l’aide aux aidants sociaux contribuant à
lutter contre la précarité, et d’un dispositif territorial d’hébergement favorisant l’insertion des malades mentaux stabilisés
par l’accès à des solutions d’hébergement diversifiées et adaptées.
Coopération hospitalière territoriale public/privé par élaboration d’un projet coordonné de territoire
inter établissements. Exemple de réalisation : organisation coordonnée territoriale de la réponse à l’urgence, à la crise et à
la post-urgence en psychiatrie.
Les actions matures donnent lieu au développement d’une démarche d’amélioration de la qualité territoriale et d’une
démarche d’évaluation territoriale de l’activité médicale.
Les actions en cours de maturation :
Dispositif de soins partagés en psychiatrie de la personne âgée.
Coordination territoriale de la réponse de la psychiatrie aux besoins des adolescents.
Transformation des « obligations de soins » en « opportunités de soins ».
Accès aux soins somatiques des patients psychiatriques.
Filière de soins pour la prise en charge des personnes autistes.
Addictions et comorbidités psychiatriques.
Maladies somatiques graves et comorbidités psychiatriques.

3/23
1. L’organisation sectorielle historique de la psychiatrie, qui porte les
objectifs des réseaux de santé, peut s’avérer un frein à leur mise en oeuvre
Si les dispensaires dédiés à la prise en charge des patients présentant une tuberculose sont
considérés comme l’expérience initiale d’un travail en réseau dans le champ de la santé et les
réseaux dédiés aux patients atteints du SIDA comme leur successeurs, la psychiatrie a à son
actif la politique de sectorisation comme modèle d’organisation de l’offre de soins ayant
cherché à développer, dès les années 50-60 les principes fondamentaux d’un travail en réseau,
au premier rang desquels :
- faciliter l’accès aux soins par la définition de territoires pertinents comme le promeut
la circulaire du 15 mars 1960 (2) : « Éviter la désadaptation qu'entraîne l'éloignement
du malade de son milieu naturel. Il est donc nécessaire que les établissements, qu'il
s'agisse de l'hôpital psychiatrique, de l'hôpital de jour ou du foyer de postcure, soient
facilement accessibles pour la population qu'ils desservent. » La psychiatrie est ainsi la
première discipline à avoir adopté l’approche territoriale de l’organisation des soins
pour laquelle opte aujourd’hui toute la santé.
- Assurer la continuité des prises en charge qu’elle soit sanitaire, sociale ou médico-
sociale : « Ce dispositif consiste essentiellement à diviser le département en un certain
nombre de secteurs géographiques, à l'intérieur de chacun desquels la même équipe
médico-sociale devra assurer pour tous les malades, hommes et femmes, la continuité
indispensable entre le dépistage, le traitement sans hospitalisation quand il est
possible, les soins avec hospitalisation et, enfin, la surveillance de postcure » (2).
La similitude avec les principes qui sont à l’origine de la promotion des réseaux de santé
est frappante, que l’on se réfère aux ordonnances dites « Juppé » de 1996, à la circulaire
plus récente de 2007 (3) ou au texte fondateur de 2002 (4), qui indique « les réseaux de
santé répondent à un besoin de santé de la population dans une aire géographique définie,
prenant en compte l’environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les
réseaux mettent en œuvre des actions de prévention, d’éducation, de soin et de suivi
sanitaire et social ».
C’est sans doute ce qui explique que la psychiatrie se soit sentie peu concernée par cette
réforme de l’organisation des soins, qui ne faisait que reprendre des principes mis en
oeuvre par elle depuis plus de 40 ans. Mais cette lecture, trop superficielle, a privé la
psychiatrie d’une évolution importante, à un moment où son organisation connaissait elle-
même des difficultés comme en témoignent les nombreux colloques et écrits qui au début
des années 2000 soulignent la crise de la psychiatrie française. C’est peut-être d’ailleurs
ces difficultés elles-mêmes qui expliquent que la psychiatrie a préféré justifier son
organisation historique, plutôt que de se saisir des opportunités offertes par les réseaux
pour la faire évoluer. De fait, le nombre de réseaux développés par la psychiatrie est resté
limité même si les années 2000 ont vu l’émergence de plusieurs réseaux, essentiellement
thématiques (réseaux dépression en régions Ile de France et Provence - Côte d’Azur,
réseaux adolescents dans plusieurs régions, réseaux orientés vers l’insertion des patients
en région Rhône-Alpes…).
En effet, la méthode de travail promue par les textes sur les réseaux de santé est aussi
importante que les objectifs poursuivis, car elle tient compte du fait que les formes de
coopération et de coordination attendues se structurent différemment en fonction des époques,
et en fonction des politiques de santé qui se succèdent. Sans cet accrochage fort aux

4/23
évolutions de la société, le pacte social qui doit unir le monde de la santé à sa société, est
menacé. Il semblerait qu’aujourd’hui la psychiatrie peine à s’inscrire dans un pacte social
accepté par les professionnels du soin eux-mêmes et par la société, représentée par les
associations d’usagers.
Ainsi si les réseaux de santé conservent les principes de l’organisation sectorielle ils rompent
à bien des égards avec la manière de les décliner sur le terrain des soins. Les réseaux tiennent
en effet compte du fait que les évolutions culturelles et sociologiques des 30 dernières années
impliquent que la façon de développer un partenariat effectif sur un territoire donné a changé.
1.1 Les changements culturels attendus
L’engagement effectif des professionnels, dans leur diversité, est l’un des gages essentiels
d’un partenariat réel. Comme le signale le rapport de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales sur les réseaux (5) « dans la perspective d’une généralisation à tout le territoire, la
question de l’engagement des professionnels de santé dans des démarches nouvelles (…)
nécessitera une évolution forte de la culture et des comportements actuels des professionnels
de santé »
Il est donc essentiel de revenir aux textes pour éclaircir ce qui est préservée de l’organisation
traditionnelle de la psychiatrie et ce qui peut être considérée comme un changement radical
afin que le monde de la psychiatrie juge, en connaissance de cause, de la pertinence de
développer les réseaux en psychiatrie.
La correspondance affichée en introduction des deux textes de 1960 (2) et de 2002 (4)
n’exprime rien de moins que la réaffirmation des grands principes de la psychiatrie
traditionnelle, notamment celui de territoire de proximité pour assurer au mieux la réinsertion
des malades, la continuité des soins et la nécessité de prendre en compte conjointement la
prévention, le suivi des soins et la réinsertion. En somme les réseaux de santé s’inscrivent
dans des objectifs de santé publique. Au-delà, ils sont porteurs de changements culturels
attendus par les professionnels comme par les patients.
1.1.1 De la responsabilité territoriale d’une équipe dédiée à la notion de
responsabilité partagée
L’origine du terme réseau réside dans la définition sociale qui en a été donnée. Il est avant
tout « un mouvement social qui périme les modes d’organisation anciens » et qui s’est
développé dès les années 1980 dans les organisations au travail (6).
Le domaine de la santé s’est ouvert plus tardivement à ce mouvement social, dont l’essentiel
repose, d’une part sur une coordination d’acteurs en vue d’un objectif précis et non dans le
seul but de pérenniser une organisation, d’autre part sur une coopération des acteurs, non
hiérarchisée mais portée par un « leader » dont la compétence est reconnue dans le champ de
l’action projetée (en santé, un professionnel du soin). Ainsi cette notion intègre le changement
radical de valeurs dans la motivation et le comportement des hommes au travail, marquée par
le refus de la hiérarchie et la revendication de liens contractuels, individuels, autour d’un
projet et propose la réponse la plus adaptée à ces attentes : une équipe organisée autour d’un
projet, lieu d’une auto régulation, s’organisant et se contrôlant elle-même pour mener à bien
le projet. « Celui qui est légitime pour organiser ces personnes autonomes, auto-organisées et
créatives n’est plus le chef hiérarchique, nommé statutairement, (…) » c’est le leader, celui

5/23
qui est reconnu comme légitime pour mener à bien le projet qui possède à la fois la
compétence requise et à la fois la qualité d’animation du groupe ».
Ce retournement des valeurs au travail a différentes conséquences : « d’une part, le centre de
l’action est bien le projet et non l’institution ; ce qui compte c’est qu’un projet aboutisse et
que sa réalisation permette, si possible, de nouer d’autres relations qui pourront s’unir autour
d’un nouveau projet. (…). L’organisation par projet crée elle-même les liens nécessaires entre
des professionnels, indépendamment des frontières institutionnelles ».
« Cette approche souple, changeante, décrite par L. Boltanski et E. Chiapello (7) est
radicalement opposée à la pratique hospitalière actuelle, malgré les nombreuses tentatives qui
se sont succédées pour réformer l’hôpital. Au-delà des modalités d’organisation de la
planification ou de l’évaluation, c’est la nature même des relations et de l’organisation interne
de l’hôpital qui reste fondée sur des valeurs de hiérarchie et de position statutaire ». « La
notion de frontière, frontières de l’établissement, frontières entre le public et le privé,
frontières au sein de l’établissement entre services, entre l’administration et les services de
soins, reste forte ».
Or, par son organisation même et ses principes, le secteur n’est pas favorable au mode
d’organisation souple d’un réseau, dans laquelle il n’y a pas de pivot, mais des professionnels,
éventuellement issus d’équipes différentes, qui apportent leurs compétences et s’organisent
pour assurer la continuité des soins dans un réseau. Il n’y a pas une équipe qui répond à toutes
les demandes et organise les partenariats nécessaires mais des équipes et des professionnels
qui organisent, ensemble, la réponse, de manière différenciée selon les situations, à des
niveaux territoriaux différents, le leader n’étant pas le même selon les projets.
C’est bien ce que portent les textes récents sur les réseaux de santé et notamment la circulaire
du 2 mars 2007 relative aux orientations de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Offre de
Soins (Ministère de la Santé) et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés en matière de réseaux de santé, à destination des Agences Régionales de
l’Hospitalisation et des Unions Régionales des Caisses d’Assurance Maladie, et qui définit
des orientations en matière d’évolution des réseaux de santé (3).
La notion de réseau impose d’intégrer trois facteurs constituant les éléments du changement
culturel attendu : l’abandon d’un fonctionnement hiérarchisé des acteurs, où l’un des
partenaires pourrait revendiquer la position de «pivot », pour un fonctionnement horizontal où
la responsabilité territoriale est partagée ; la prise en compte de facteurs économiques sur le
mode d’un financement attaché à un relevé d’activité précis et adaptée à la réalité des services
rendus ; et enfin l’application d’une démarche qualité pour guider les pratiques de soins, c'est-
à-dire la préférence accordée aux arguments de qualité et d’efficience sur les arguments
d’autorité et de rentabilité.
Cette évolution culturelle implique une réflexion renouvelée sur l’ensemble des principes qui
ont fondé le secteur et qui doivent fonder toute organisation des soins de qualité, qu’il s’agisse
de la notion de territoire pertinent, de la définition des acteurs impliqués dans la prise en
charge des patients et de la notion de responsabilité partagée ou de l’évaluation des pratiques
professionnelles.
L’enjeu, pour la psychiatrie, est de passer de la continuité des soins dévolue à une équipe
unique à la coordination des acteurs impliqués dans le parcours de santé du patient, et de la
responsabilité d’une équipe à organiser l’offre de soins d’un territoire à une culture
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%