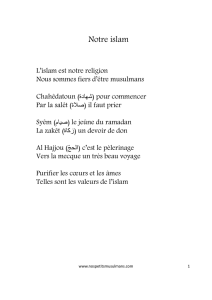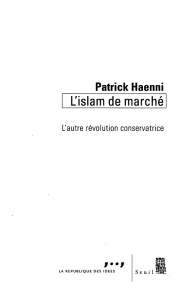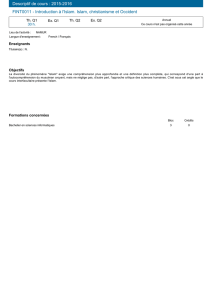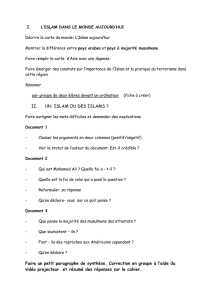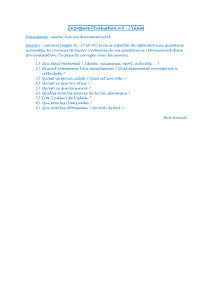Le corps et le sacré en Orient musulman

REMMM 113-114, 9-33
Catherine Mayeur-Jaouen*
Le corps et le sacré en Orient musulman
« Le corps et le sacré en Orient musulman » : dans l’imaginaire européen du
XIXe siècle, le sujet aurait suscité quelques images convenues, odalisques de harem
ou de bain turc, marabouts sales et hirsutes, des Bédouins faméliques au regard
de braise, des derviches tourneurs dansant inlassablement devant les premiers
touristes occidentaux… C’est le temps où l’islam, fondé par un prophète alors
décrit comme fanatique et sensuel, passait pour une religion capable de susciter
l’ascétisme le plus extrême comme d’exciter les tendances les plus charnelles.
Aujourd’hui, le même énoncé susciterait d’autres clichés, d’autres interrogations
que l’on pourrait sans doute résumer par cette simple phrase : « pourquoi toutes
ces femmes voilées et ces hommes barbus ? » (Benkheira, 1997 : IX)1. L’islam
charnel serait devenu, en un siècle à peine, une religion essentiellement forma-
liste, religion de la norme corporelle où s’allieraient l’austérité de la secte et le
mépris du corps féminin.
Le livre collectif présenté ici ne prétend pas répondre à tous ces clichés. Il n’est
pas sûr, pour commencer, que l’islam implique une culture particulière du corps,
même si naturellement il propose ses propres modèles avec la Sunna prophéti-
que qui guide les usages corporels. Cette Sunna incorporée traduit un amour
de la Loi qui n’est pas propre à l’islam, et des études similaires sur le judaïsme
décriraient, elles aussi, prescriptions juridiques et rites minutieux. Quant aux
* Institut national des langues et civilisations orientales-INALCO, Paris .
1. Pour ceux que la question intéresse, la réponse proposée par M.H. Benkheira (1997) est : « à cause de
l’amour de la Loi ». Ce livre fondamental dispense du petit manuel léger de Khuri, 2001.

10 / Catherine Mayeur-Jaouen
nombreuses études récentes qui portent sur la construction sociale du corps
dans le christianisme médiéval et moderne, elles aboutissent à des thèmes et
à des conclusions très proches de celles auxquelles nous sommes nous-mêmes
parvenus pour l’Orient musulman : le compte rendu d’un livre de synthèse sur
l’histoire du corps dans le Moyen Âge chrétien conclut que « la tension entre
corps réprimé et corps exalté » est au cœur de l’ouvrage2. Nous ne proposerons
pas ici de meilleure formule. C’est aussi pour cette raison que quatre des commu-
nications de ce volume présentent l’anthropologie corporelle chez les chrétiens
arabes, voisins des musulmans et partageant la même culture sociale. Maronites
du Mont-Liban, melkites de Syrie ou coptes égyptiens veillent sans doute à se
démarquer de l’islam, par la pratique d’un jeûne différent ou la réforme zélée
des usages corporels dans des pèlerinages souvent partagés. Si la sainte maronite
Rifqâ apparaît sans équivalent en islam, c’est que la sainteté féminine doloriste
du XIXe siècle dont s’inspire Rifqâ est d’abord pétrie par des modèles catholiques
latins et par l’imitatio Christi jusque dans la souffrance des stigmates. Mais l’ethos
corporel proposé aux chrétiens d’Orient paraît souvent très proche de celui des
musulmans : le Livre de la Direction (Kitâb al-hudâ), un traité de théologie morale
maronite du XIIe siècle étudié ici par Bernard Heyberger, utilise le vocabulaire
corporel même sur lequel s’appuie un Ghazâlî (m. 1111) dans le sixième livre
de la première partie de la Revivification des Sciences de la Religion (IÌyâ’ ‘ulûm
al-dîn), à propos de ramadan : dans les deux cas, le jeûne est présenté comme
le moyen pour l’homme de s’arracher aux passions et d’échapper au rang des
animaux pour s’approcher de celui des anges (Ghazâlî, 1993 : 117).
On peut insister sur les proximités dans les terminologies et les visions du
monde, peut-être dues à un même héritage aristotélicien. On peut aussi relever
les différences théologiques irréductibles. Le jeûne de Ramadan, c’est d’abord
le mois du Coran, celui où l’on pratique intensément la récitation (tilâwa) du
livre sacré. D’autre part, si Ghazâlî se tourne vers l’exemple prophétique et vers
la Loi qui en découle, le Kitâb al-hudâ affirme que le jeûne a été donné au peuple
chrétien par le Christ lui-même, et rattache le Carême à l’Eucharistie puisque
les quarante jours de jeûne s’achèvent par la Cène du Jeudi Saint : c’est dans le
banquet eucharistique préparé par le jeûne que réside pour le croyant le véri-
table espoir de salut. Autre différence théologique majeure entre christianisme
et islam : pour les chrétiens, la doctrine de l’Incarnation impose l’image d’un
Dieu fait homme et qu’il convient de suivre dans une pieuse imitatio Christi.
Les conséquences du dogme de l’Incarnation sur la culture corporelle du chris-
tianisme sont multiples : l’apparition d’une conception de l’histoire et du temps
où l’éternité de Dieu se mesure à l’aune du temps des hommes s’accompagne de
la légitimation du charnel et du sensible grâce à la présence de l’Eucharistie. Le
corps devient un instrument de salut dans les gestes de la prière et les macérations
du jeûne. Deuxième conséquence, les aspects visuels du corporel, le fait même
de représenter, émanent directement de cette doctrine de l’Incarnation. Enfin, le
2. Compte rendu dans Le Monde, 17 octobre 2003 de Le Goff et Truong, 2003.

Introduction / 11
REMMM 113-114, 9-33
corps se définit aussi comme institution “incorporée”, l’Église, traversée par les
tensions entre spirituel et temporel, entre clercs et laïcs, jusqu’à ce qu’éclose la
devotio moderna (Schmitt, 2001 : introduction). Encore que la place occupée par
le Dieu incarné dans l’enseignement de l’Église et dans la piété des fidèles ne soit
pas exactement la même dans le christianisme oriental que dans le christianisme
latin. Le Dieu des Orientaux est plus transcendant et plus éloigné de l’humanité
que ne l’est le Dieu des Latins, du moins à partir du XIIIe siècle.
En islam, si l’absence du dogme de l’Incarnation entraîne par définition
l’absence de l’Eucharistie et de l’institution ecclésiastique, l’adoration d’un
Dieu absolument transcendant et inaccessible à l’esprit humain exige la pré-
sence d’éléments médiateurs, fondamentalement la Loi qui pétrit les corps ou le
saint homme qui propose un modèle (Benkheira, 2000 : 25). La légitimation du
charnel et du sensible, celle du corps comme instrument de salut, existe aussi en
islam : la création d’Adam comme vicaire de Dieu sur terre, et surtout l’exemple
du Prophète MuÌammad fixent les règles à suivre d’un corps désireux d’échapper
aux passions pour rejoindre sa vocation profonde. Le Coran lui-même propose
le Prophète comme le « bel exemple » (uswatun Ìasanatun) aux croyants (Coran,
XXXIII, 21), ce qui est en définitive la raison principale de l’étude du hadith.
L’orientaliste allemande Annemarie Schimmel (1989 : 50) a pu aller jusqu’à
parler d’imitatio Muhammadi : c’est cette imitation qui, du Maroc à l’Indonésie,
donnerait au monde musulman un visage si reconnaissable.
« Où que l’on soit, on sait comment se comporter pour entrer dans une maison,
quelles formes de salut employer, ce qu’on doit faire en société et ce qu’on doit
éviter, comment manger et comment voyager. »
Il s’agit cependant davantage d’une spiritualité profonde qui s’exprime dans
des coutumes assez souples plutôt que d’une norme intangible et unique. Un
air de famille plutôt qu’une répétition infinie à l’identique. Quant à la sainteté,
comme le rappelle Michel Chodkiewicz (2001), elle est en islam imitatio Pro-
phetae,
« par quoi il faut entendre non pas seulement une conformité aux normes de com-
portements instituées par l’Envoyé, mais une adhérence à ses états intérieurs ».
Variété infinie au sein d’une spiritualité commune. Les différentes sociétés
dans lesquelles l’islam s’est ancré ont en effet joué autant qu’une norme mouvante
et insaisissable, elle-même en constante redéfinition : on rencontrera ici aussi
bien des sociétés maures dominées par des familles maraboutiques et une culture
lettrée, que des paysans du plateau iranien marqués par le chiisme et l’héritage
cheikhî, aussi bien les robustes dévots des saints soufis du delta du Nil que des
derviches tourneurs de l’époque ottomane guidés par une interprétation ésoté-
rique du monde ; des ruraux, des urbains et toute la gamme indéfinissable qui
va des uns aux autres dans le monde contemporain ; des humbles et des sultans,
des saints et des danseuses, des femmes en transe et des muftis en consultation.
Le regard que ces groupes variés et ces sociétés diverses ont porté sur le corps
est abordé tantôt grâce à l’étude de textes médiévaux ou modernes, tantôt grâce

12 / Catherine Mayeur-Jaouen
à l’observation anthropologique des sociétés contemporaines. Depuis la Sîra du
Prophète ou les hadiths jusqu’aux fatwas du cheikh Al-Bûtî, en passant par des
écrits hagiographiques, des proverbes, des manuels soufis ou des chroniques
ottomanes, des sources très variées sont mobilisées pour étudier la culture du
corps en islam.
On rencontrera aussi le corps sur lequel on ne tient pas de discours, mais
autour duquel on construit essentiellement une pratique, faite de réalités
vécues qui ne correspondent pas toujours à une théorie élaborée et pleinement
consciente d’elle-même, sans citation explicite d’écrits qui les codifient ou les
légitiment. Ces pratiques ne sont pas pour autant privées de sens religieux ou
sacral. Tout ce qui relève de la culture populaire n’implique pas l’absence de
référence à une culture écrite ou normative, même lorsqu’il s’agit d’une pratique
transgressive. Un tatouage, un banquet, la préparation d’un plat, un vêtement,
un regard, un geste : tout a un sens et ressortit à une anthropologie religieuse
du corps. Celle que décrit Anne-Sophie Vivier – à partir d’un travail de terrain
dans un petit village iranien chiite en 2002 – ressemble presque trait pour trait
à celle que Richard Kurin (1984 : 196-220) a tirée, vingt-cinq ans plus tôt, de
l’observation du milieu rural sunnite pakistanais… et dont il remarquait déjà la
coïncidence avec des textes médiévaux comme celui de Hujwirî3. L’anthropologie
sacrée mise en œuvre, si elle recourt à des références islamiques, ressortit plus
généralement à la vision du corps dans les cultures prémodernes. Rien, sinon des
références idéologiques issues de préoccupations contemporaines ou la croyance
naïve dans une orthodoxie sur laquelle l’accord ne s’est jamais fait, n’autorise à
séparer absolument une magie instrumentale d’une religion éthique, le rituel
et la croyance, le culte des saints et le soufisme, la religion populaire d’un islam
officiel qui serait normatif4. L’âme charnelle (la nafs) à combattre, perçue comme
féminine, se situe sans doute – si l’on en croit les censeurs – du côté des pratiques
locales, de la coutume, de la Jâhiliyya, des femmes; mais en même temps, elle
est nécessaire au triomphe de l’islam. La diversité typologique des saints, tour
à tour combattants, lettrés, réformateurs, possédés (majdhûb-s) scandaleux ou
ascètes puritains montre la nécessité plurale des charismes.
Cette tension dialectique entre norme et pratique ne signifie pas pour autant
que la culture populaire n’existe pas. C’est au contraire justement dans son
rapport au corps que s’exprime, en islam comme dans le christianisme, une
religiosité populaire spécifique, plus immédiate et souvent plus crue. C’est la
religion des rites de passage, c’est la religion où interviennent les femmes – par
exemple avec les tatouages des femmes yéménites, une pratique formellement
interdite en islam mais universellement pratiquée dans les sociétés traditionnel-
les, et que présente ici Hanne Schönig. C’est là que s’expriment rites agraires et
3. Le travail de terrain à l’appui de cet article date de 1976-78.
4. Toutes choses excellemment répétées, sur des modes différents et à partir d’expériences variées par les
chercheurs qui travaillent sur la sainteté musulmane, cf. notamment les introductions des livres de Vincent
Cornell, 1998 et Pnina Werbner et Helen Basu, 1998.

Introduction / 13
REMMM 113-114, 9-33
obscénités rituelles. C’est dans ses pratiques corporelles que la culture folklorique
est apparue suspecte à nombre d’ulémas et a été volontiers combattue et refoulée,
soit par le silence (d’où la quasi-absence de sources directes sur le sujet jusqu’aux
descriptions ethnographiques du XIXe siècle), soit par une littérature polémique
où Ibn Taymiyya, mort en 1328, occupe une place de choix.
Religieux, saint, sacré
Le corps et le religieux, le corps et la sainteté, le corps et le sacré : on se doute
à quel point chacun de ces titres aurait pu convenir, sans qu’aucun des trois
termes associés, pourtant, ne connaisse de véritable correspondant en arabe5.
Le religieux serait situé davantage du côté d’une norme scripturaire, imposée
par des clercs ou des ulémas ; la sainteté camperait tantôt du côté de l’exception
admirable, tantôt de celui du modèle imitable. Faute de mieux, le terme de
« sacré » que nous avons choisi est le terme le plus englobant et le plus souple des
trois, celui qui permettait de recourir aux contributions les plus variées, à la fois
thématiquement et méthodologiquement. Il correspond à la fois au mot arabe
muqaddas employé par les musulmans comme par les chrétiens pour indiquer
une sanctification ; au mot Ìarâm, qui indique l’interdit, l’illicite, mais aussi le
tabou – donc le sacré; enfin au mot mubârak, qui désigne ce qui est empreint de
baraka. Muqaddas est le participe passif de deuxième forme de la racine QDS qui
se réfère en réalité à la sainteté (celle de Dieu) plus qu’au sacré ; ou à la rigueur à
la sacralité : muqaddas, stricto sensu, c’est ce qui est rendu sacré ou rendu saint,
sanctifié. Les termes dérivés de la racine ÎRM sont multiples. À ce sujet, on ne
peut que citer Joseph Chelhod (1986 : 35) :
« Il y a deux manières de considérer le sacré : on peut l’envisager soit en lui-même,
soit dans ses manifestations extérieures. Néanmoins, c’est un même terme qui
exprime à la fois l’entité et l’état, la chose et la condition qu’elle crée. Le sacré, dans
la perspective animiste, c’est cette force mystérieuse et impersonnelle, bienfaisante
et redoutable, qui serait à l’origine de tout pouvoir, de tout bonheur comme de tout
malheur. C’est d’autre part une situation, celle dans laquelle se trouvent des êtres et
des objets exclus du monde profane. Pour exprimer le sacré et définir ses rapports
avec lui, l’Arabe, comme le musulman, se sert de la racine Ì r m dont l’ambiguïté
est telle qu’il serait impossible d’en préciser le sens en quelques phrases ».
ÎRM permet les mots Ìarâm (le sacré tabou, en fait, ce qui est interdit),
iÌrâm (plutôt sacralisation), Ìurm ou Ìurma (choses sacrées et inviolables), et
enfin Ìaram qui désigne aussi bien une chose illicite, une chose sacrée, un harem,
le territoire de La Mecque et par extension un sanctuaire. La prohibition d’un
espace ou d’un temps peut être liée à l’illicite (lui-même défini par l’opposition
entre pur et impur), mais aussi, à l’inverse, à la sainteté d’un lieu et d’un moment,
accessible au profane au prix de rites de purification et de sacralisation. Enfin,
5. L’atelier organisé par Bernard Heyberger à l’AFEMAM en juillet 2001 et qui a servi de point de départ
à ce colloque portait sur « Les religions, le corps, le sensible ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%