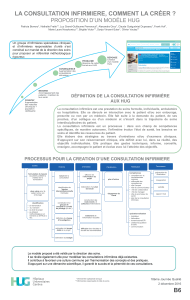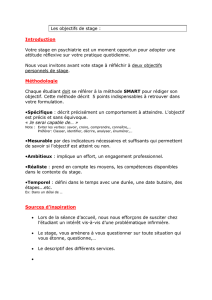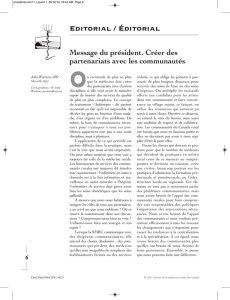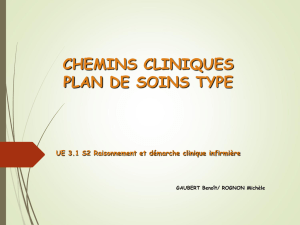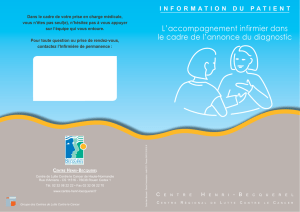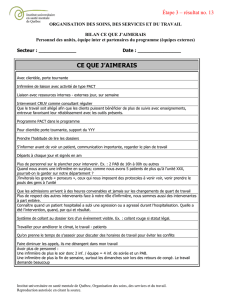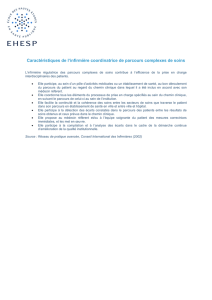Université de Genève

Université de Genève – Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation – section des
sciences de l’éducation
Année académique 2004/2005
Mémoire de licence
Directeur de mémoire : Jean-Michel Baudouin
SOIGNER OU TRAITER ?
UN POINT DE VUE INFIRMIER DE LA PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
Sabine Derouiche
2, rue Baudit
1201 Genève
Tél. : 022/733’31’35
E-Mail : [email protected]

2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ...................................................................................................................... 5
1. Difficulté de l’objet étudié ............................................................................................. 7
2. Objectifs de recherche .................................................................................................... 8
3. Hypothèse de recherche.................................................................................................. 9
4. Postulat de base ............................................................................................................ 10
5. Point théorique de la recherche .................................................................................... 11
6. Partie méthodologique et Analyse des données ........................................................... 11
PREMIERE PARTIE:
CADRE THEORIQUE
1. LA DOULEUR DANS L’APPROCHE MEDICALE ..................................................... 13
1. Les trois types de la douleur ......................................................................................... 14
1.1. Les douleurs nociceptives ......................................................................................... 14
1.2. Les douleurs neurogènes ........................................................................................... 15
1.3. Les douleurs psychogènes ......................................................................................... 16
2. Durée de la douleur : Douleur aiguë – douleur chronique ........................................... 16
3. Définition de la douleur ................................................................................................ 17
4. La douleur aux HUG .................................................................................................... 18
4.1. La douleur comme cinquième signe vital ................................................................. 19
4.2. Les outils de mesure : les échelles quantitatives ....................................................... 20
4.3. Le Réseau douleur des HUG ..................................................................................... 21
4.4. Filière infirmière HES : les cours traitant de la douleur à Bon Secours ................... 22
5. Un paradigme explicatif ? ................................................................................................ 24
2. APPROCHE SOCIO-HISTORIQUE DE LA DOULEUR .................................................. 26
1. La douleur : de l’antiquité Gréco-romaine à aujourd’hui................................................. 26
1.1 L’antiquité Gréco-romaine ......................................................................................... 26
1.2. Le Galénisme ............................................................................................................. 27
1.3. L’Antiquité tardive et le Moyen Age ........................................................................ 27
1.4. La douleur dans la Renaissance ................................................................................ 28
1.5. Le 18ème et le 19ème siècle : des différences face au problème de la douleur ............ 28
1.6. La douleur dans la première moitié du 20ème siècle .................................................. 29
1.7. Une modification du seuil de sensibilité ? ................................................................ 30
2. Constituer la douleur comme un problème : la création d’une médecine de la douleur .. 31
2.1. De la douleur expérimentale à la douleur clinique .................................................... 31
2.2. La complexification de la conceptualisation médicale de la douleur ........................ 33
2.3. Créer une association de la douleur ........................................................................... 34
2.4. Théorie de la barrière ou théorie de la spécificité : une tension de paradigme au sein
de l’approche médicale ? .................................................................................................. 34
3. L’autonomisation de la douleur ........................................................................................ 35
3.1. Du symptôme au syndrome ....................................................................................... 36
3.2. Former un groupe ...................................................................................................... 36
4. L’utilité de la douleur dans l’approche médicale ............................................................. 37
3. APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DE LA DOULEUR ................................................ 39
1. Douleur et médecine ......................................................................................................... 39
2. La douleur : à la fois un fait biologique et un apprentissage social ................................. 40

3
2.1. Biologique, sociale, mais aussi singulière ................................................................. 41
2.2. Un syndrome méditerranéen ? ................................................................................... 42
3. La douleur comme cinquième signe vital ? ...................................................................... 44
DEUXIEME PARTIE:
DIMENSION METHODOLOGIQUE ET ANALYSE DES DONNEES
1. METHODOLOGIE .............................................................................................................. 49
1. Posture .............................................................................................................................. 50
1.1. Agent et acteur à la fois ............................................................................................. 51
1.2. « Praticien-chercheur » ou « chercheur praticien » ? ............................................... 51
2. Choix de la population ..................................................................................................... 51
2.1. Les unités représentatives .......................................................................................... 52
2.2. Difficultés rencontrées .............................................................................................. 53
3. Recueil de données : l’entretien semi-directif .................................................................. 53
4. Guide d’entretien .............................................................................................................. 54
5. Modalité d’analyse : analyse de contenu .......................................................................... 55
2. ANALYSE DES ENTRETIENS ......................................................................................... 56
1. Registre personnel ............................................................................................................ 57
1.1. La douleur laisse toujours une trace dans la mémoire .............................................. 57
1.2. Dimension normative et religion ............................................................................... 59
1.3. Dimension relationnelle ............................................................................................ 60
1.4. Dimension éducative et culturelle ............................................................................. 62
2. Le registre professionnel : la douleur institutionnalisée ................................................... 64
2.1. Les « patients- types » ............................................................................................... 66
2.2. La douleur doit non seulement s’entendre, elle doit aussi se voir ............................. 66
2.3. Douleur et angoisse ................................................................................................... 67
2.4. La « Douleur » ........................................................................................................... 71
3. Situation normale, standard - situation de dérive ............................................................. 71
3.1. Situation normale ...................................................................................................... 72
3.2. Situation de dérive ..................................................................................................... 73
4. Dialectique des deux registres .......................................................................................... 84
4.1. La douleur institutionnalisée ..................................................................................... 84
4.2. Le propre vécu de l’infirmière interfère dans sa pratique professionnelle ............... 86
4.3. La double logique ...................................................................................................... 88
5. Douleur et savoir infirmier : soigner ou traiter la douleur ? ............................................. 90
TROISIEME PARTIE:
SYNTHESE ET CONCLUSION
SYNTHESE ET CONCLUSION ............................................................................................. 94
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 99

4
REMERCIEMENTS
Je remercie, en premier lieu, mon directeur de mémoire, Monsieur Jean-Michel Baudouin,
pour son aide, ses conseils précieux et ses encouragements permanents dans la rédaction de
mon mémoire de licence.
Mes remerciements vont également à toutes les personnes qui étaient prêtes à mener un
entretien sur la douleur. Sans eux, ce mémoire de licence n’aurait pas vu le jour.
Samira Zerroug ainsi que Pauline Di Carlo ont chacune lu et corrigé d’une manière attentive
cet ouvrage. Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées.
Ma gratitude va également à mon mari, qui, pendant tout mon parcours universitaire, m’a
toujours soutenue et encouragée.
Enfin, je remercie les responsables d’unité du département de la chirurgie et de la médecine
interne de l’hôpital cantonal de Genève. Ils m’ont mis en contact avec les infirmiers/ères
intéressé/es pour mon sujet et ont permis, de ce fait, la réalisation des entretiens.

5
« Le médecin, non moins que le patient, projette ses catégories
morales et culturelles sur les symptômes. Il n’est pas un
enregistreur : il est un homme disposant d’un savoir en face d’un autre
homme souffrant et tenant un discours sur son mal. La médecine
est par nature un fait de relation. Elle relève d’une culture
professionnelle, nuancée par la culture propre du médecin dont la
tâche est de contourner la culture profane qui imprègne le
jugement et les attitudes du patient. Les motifs de malentendus
foisonnent».
David Le Breton (1995), Anthropologie de la douleur, p.137.
INTRODUCTION
La douleur est le premier motif de la consultation médicale. Bien que d’importants progrès
ont été réalisés ces dernières années dans la connaissance, dans la prise en charge et le
traitement de la douleur, de nombreux malentendus existent entre les patients qui souffrent de
douleur et leurs soignants. En particulier, lorsque l’intensité de la plainte douloureuse ou ses
répercussions semblent disproportionnées au substrat somatique identifiable.
Dans le milieu médical, la douleur est assimilée à la maladie et à la souffrance. Mais
l’interprétation de la douleur semble être un phénomène complexe qui touche à l’homme
souffrant plutôt qu’à son seul fonctionnement physiologique, et se réfère également au regard
de l’autre et à sa manière de percevoir la douleur.
Depuis que j’ai commencé mes études d’infirmière en 1988, je suis continuellement
confrontée à la douleur des patients. Pour les différentes sortes de douleurs (post-opératoires,
chroniques, accouchement, etc.) qui se distinguent dans leur localité et dans leur intensité, il
existe différents médicaments antalgiques permettant de soulager la souffrance. Mais face à la
douleur, chacun a une manière de l’exprimer qui lui est propre et l’intensité ressentie reste
toujours subjective. Rendre compte de la souffrance de l’autre d’une manière optimale est
donc un des soucis principaux du soignant.
Pourquoi avoir choisi un thème pareil pour rédiger ce travail de fin d’étude? L’intérêt pour la
douleur dans ce mémoire de recherche est né d’un étonnement que je tenterai d’expliquer :
A l’hôpital cantonal universitaire de Genève, où je travaille depuis 1991 en tant qu’infirmière
dans un service de chirurgie thoracique-cardio-vasculaire, différentes recherches ont été
menées pour mieux cibler la douleur des patients en objectivant la douleur ressentie.
Actuellement, nous utilisons une réglette qui va de 0 à 10 sur laquelle le patient indique sa
douleur (0 = pas de douleur ; 10 = douleurs insupportables). Cette évaluation de la douleur
permet ainsi une meilleure perception et une antalgie adaptée.
Bien que ce système d’évaluation permette de traduire les douleurs ressenties, les soignants
gardent souvent leur propre perception de la douleur du patient. Durant toutes ces années, j’ai
ainsi constaté que même si nous avons à disposition un outil qui vise la mesure et l’évaluation
objective de la douleur, celle-ci, exprimée de la part des patients ayant une origine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%