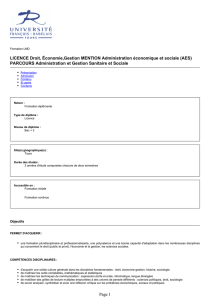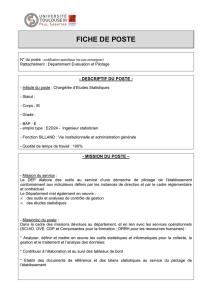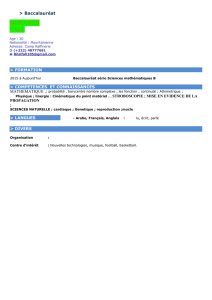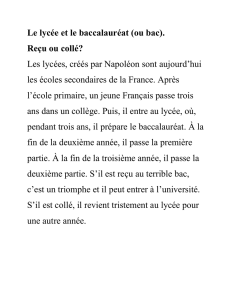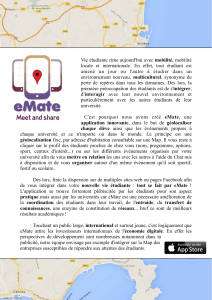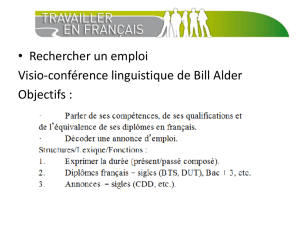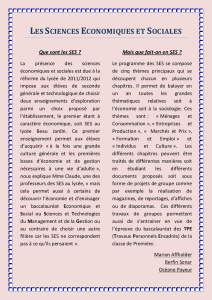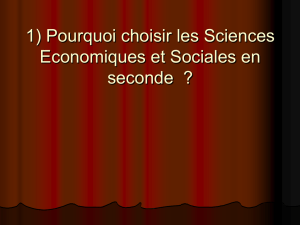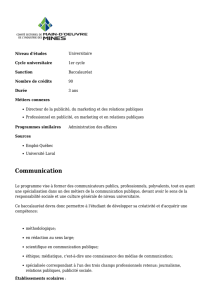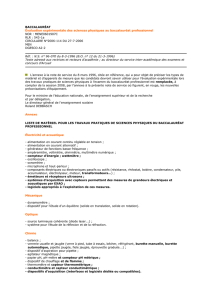L`étudiant moyen n`existe pas

Consortium d’Animation sur la Persévérance et la Réussite en Enseignement Supérieur
CAPRES
Colloque sur la réussite étudiante en enseignement supérieur
(20 et 21 mai 2003)
Entrevue menée par Martin Toulgoat
Diplômé du baccalauréat en communication de l'université du Québec à Montréal
_________________________________________________________________________________
Claude Grignon, Observatoire de la Vie Étudiante à Paris
«L’étudiant moyen n’existe pas»
Pour le président du comité scientifique de l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), Claude Grignon,
même si comme au Québec l’enseignement supérieur s’est énormément démocratisé au cours des
quarante dernières années, en France, l’accès aux grandes écoles demeure encore réalité que pour
une minorité. L’étudiant moyen, un simple mythe.
Martin Toulgoat
11h30. Dans le hall d’entrée de l’Hôtel Rimouski, Claude Grignon surprend par son calme. À peine
une heure avant sa présentation dans le cadre du Colloque sur la réussite étudiante en enseignement
supérieur, tenu au mois de mai dernier, le conférencier invité par le Consortium d’animation sur la
persévérance et la réussite étudiante en enseignement supérieur (Capres) reste détendu,
aucunement préoccupé par son allocution prévue pour l’après-midi. Il prend même les devants, se
permettant d’engager l’entretien.
«L’un des problèmes est que l’on s’intéresse beaucoup aux études supérieures mais bien peu à ses
usagers», déplore-t-il d’entrée de jeu. Créé par le ministère de l’Éducation français en 1992, l’OVE
tente de combler cette lacune. Son mandat est d’analyser les résultats d’enquêtes postales, envoyés
aux trois ans, à près de 80 000 étudiants français, questionnés à propos des conditions de vie et de
réussite dans lesquelles ils se retrouvent lors de leurs études universitaires. Environ 25 000 enquêtés
retournent le questionnaire.
Même s’il doit sa naissance au gouvernement français, l’OVE demeure une instance autonome qui ne
doit de compte à aucune organisation politique, qu’elle soit gouvernementale ou étudiante. «Nous ne
faisons pas de recommandations, mais nous diagnostiquons, précise le sociologue. Même si on sert
d’expertise pour le gouvernement, nous ne donnons pas de directives thérapeutiques. C’est au
ministère de décider.»
L’OVE regroupe en son sein deux organismes, soit le Conseil de l’Observatoire composé de
représentants du ministère de l’Éducation, d’universités et de syndicats étudiants, ainsi que le Comité
scientifique, qui réunit statisticiens et sociologues œuvrant pour leur part selon une logique
scientifique et non politique. «Je pense que la seule sociologie scientifique qui vaille la peine d’être
faite doit donner la plus grande importance aux tests empiriques. Le contact avec la réalité sociale est
une contrainte indispensable à laquelle la sociologie doit se soumettre pour ne pas être de la
mauvaise philosophie.»
Mais comme l’impact discutable qu’ont pu avoir certaines commissions parlementaires canadiennes
au cours des dernières années, laissant souvent de glace le gouvernement fédéral, les constatations
de l’OVE sont-elles vraiment reconnues par ses pères? «Notre grande légitimité est due au fait que la
condition de vie des étudiants est devenue un terme porteur auquel on ne s’intéressait pas avant,
précise-t-il. Aussi, nous intervenons indirectement dans le débat public en l’éclairant, et en empêchant
autant chez les syndicats étudiants qu’au ministère de l’Éducation, que soient invoqués des
arguments fallacieux.»
Le mythique étudiant moyen
Depuis 1992, l’OVE a entre autres constaté que même si la démocratisation du système universitaire
français a permis à un plus grand nombre de joindre les rangs post-secondaires, il n’en demeure pas

moins que les niveaux de l’enseignement supérieur sont restés hiérarchiques. «Je crois qu’il faut
réduire encore davantage les inégalités sociales en milieu universitaire, parce qu’il n’y a pas de
raisons qu’un enfant né dans une classe populaire ait moins de chance de faire des études dans de
grandes écoles qu’un enfant qui a grandi au sein d’une classe dominante.»
En France, le baccalauréat professionnel mène automatiquement sur le marché du travail et son
détenteur ne peut accéder à des études supérieures. Quant au baccalauréat technologique, il peut
mener à un niveau supérieur. Le recrutement au sein des grandes écoles reste toutefois socialement
sélectif. «Pour une institution, la question est de savoir si elle veut être sélective sur les antécédents
scolaires et les capacités scolaires ou sur les origines sociales d’un étudiant parce que c’est ça le
problème, si vous êtes titulaire d’un baccalauréat bien coté, vous pourrez choisir le type d’études que
vous voudrez entreprendre. Inversement, si vous avez un baccalauréat technologique, vous ne
pourrez pas faire d’études en médecine ou une classe de préparation aux grandes écoles.»
Ratisser plus large
Selon les enquêtes réalisées par l’OVE, obtenir un «bon» baccalauréat dépend énormément des
repères familiaux auxquelles peut se référer un étudiant. «Les chances d’adhérer à un baccalauréat
reconnu et d’y connaître du succès dépend autant des ressources financières de la famille que de ses
ressources culturelles, c’est-à-dire la distance que cette dernière entretient avec le système
d’enseignement.»
Selon Claude Grignon, cet élitisme peut entraîner à long terme des effets pervers sur le
développement sociétal, tenant compte du taux de natalité peu élevé qui frappe les pays occidentaux.
«On a intérêt à ratisser large parce que dans des quartiers défavorisés, il y a aussi des enfants qui
pourraient faire de très bons physiciens et mathématiciens. C’est l’une des raisons pour laquelle il
faut corriger les inégalités sociales et actuellement en France, ça ne se fait pas du tout.» Il n’en
demeure pas moins qu’une démocratisation accrue de l’enseignement supérieur peut entraîner chez
certains bacheliers une dévalorisation de leur diplôme. «Si vous sortez en France d’une école qui est
restée très sélective, le diplôme gardera sa valeur, mais par exemple, pour une licence de sociologie,
le fait que l’on ait accru ses détenteurs le dévalorise.»
Au Québec, le Conseil supérieur de l’éducation rejoint sur plusieurs points le mandat que s’est donné
l’OVE. Une telle organisation pourrait-elle tout de même gagner des gallons en sol québécois?
«Malgré qu’il y ait des différences entre les systèmes d’enseignement supérieur français et québécois,
il reste qu’il y a des invariants. Les fonctions sociales que remplit l’enseignement supérieur demeurent
similaires dans la plupart des sociétés industrialisées et développées», conclut Claude Grignon,
conscient des mérites du processus d’investigation que tient l’Observatoire parisien.
-30-
1
/
2
100%