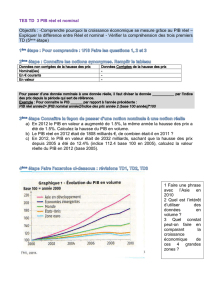La nouvelle économie a besoin de réseaux

– notamment de réseaux – en 1994-
1998, juste au début de l’envol de
la nouvelle économie.
La réflexion sur la croissance et
l’emploi au début des années
2000 est donc une réflexion sur
les interrelations entre réseaux,
institutions et marchés. Avant
d’aborder directement ce point,
44
Sociétal
N° 37
3etrimestre
2002
N
La nouvelle économie
a besoin de réseaux
CHRISTIAN SAINT-ETIENNE*
Nous sommes bien entrés dans une « nouvelle
économie » : ce terme ne désigne pas seulement
le développement des activités liées à l’information
et aux télécommunications, mais le renouvellement
complet de notre « système technique ». Les
infrastructures de réseau jouent donc désormais
un rôle essentiel : leur configuration commandera
l’organisation de notre espace ; de leur densité
et de leur qualité dépendra la croissance future
– ce qui suppose un effort d’investissement
public consistant et durable. Or la France a pris
du retard dans ce domaine, et les pouvoirs
publics sous-estiment l’importance de l’enjeu.
R E P È R E S E T T E N D A N C E S
COMPTES NATIONAUX
précisons le concept de nouvelle
économie.
On peut, dans une première
approche, limiter celle-ci aux
technologies de l’information et
de la communication (TIC), et la
présenter comme le monde de
la flexibilité, de la rapidité et de
l’engagement sur des projets risqués
et incertains, dont la réussite n’est
assurée que pour le ou les deux
ou trois premiers acteurs capables
de séduire le maximum de clients
dans le minimum de temps, donc
de fixer les standards, ou de contri-
buer à les fixer, et de bénéficier
ainsi des effets de réseau.
Mais on peut aussi concevoir la
nouvelle économie, très au-delà du
secteur des TIC, comme l’entrée
de l’ensemble de l’économie dans
un nouveau « système technique »
(ST), caractérisé par des rende-
ments croissants et une synergie
entre microélectronique, auto-
matisation et informatique. La
géné rali sati on progressi ve
d’Internet, en permettant l’infor-
matisation de l’échange entre en-
treprises et avec les consomma-
teurs, après celle de la production
et de la gestion au sein des en-
treprises, accélère l’avènement
du ST moderne.
CROISSANCE
Le développement de la nouvelle
économie s’appuie sur une solide
capacité logistique, elle-même tota-
lement dépendante de la qualité des
réseaux. Il n’est pas sans intérêt de
noter que les Etats-Unis, pays phare
dans ce domaine, ont un niveau élevé
d’investissement public, et qu’ils ont
conduit un programme spécial de
développement des infrastructures
* Professeur des Universités (Université de Tours et Université Paris-Dauphine), président
de l’Institut France Stratégie.

45
Sociétal
N° 37
3etrimestre
2002
LA NOUVELLE ÉCONOMIE A BESOIN DE RÉSEAUX
On sortirait ainsi de la production
mécanisée, associée aux révolutions
industrielles précédentes, pour
entrer dans la logique de la produc-
tion automatisée, qui s’est déployée
depuis le milieu des années 70
dans le monde industriel développé,
et achèverait de transformer le
système productif dit global au
cours des années 2000. Cette
révolution industrielle globale est
accélérée par deux autres facteurs :
le basculement organisationnel, qui
favorise les structures décentrali-
sées, et l’extension des méca-
nismes de marché, qui font un
usage intense de l’information.
Il est clair que ces deux conceptions
de la révolution technologique en
cours n’ont pas les mêmes impli-
cations. La nouvelle économie-TIC
concerne avant tout un secteur
industriel (les TIC), un domaine
de l’activité humaine (le recueil et
le traitement de l’information) et
un aspect de la vie économique
(l’informatisation de l’échange –
particulièrement, mais pas seule-
ment, de l’échange d’information).
La nouvelle économie-ST, qui a
commencé dans les années 70 et
qui est fortement accélérée par
les TIC depuis le milieu des
années 90, concernera probable-
ment, à partir de 2004-2005, tous
les secteurs industriels, tous les
domaines de l’activité humaine
(de l’éducation aux loisirs en
passant par la vie professionnelle)
et tous les aspects de la vie éco-
nomique (la production, l’échange
et l’accumulation des actifs, réels
et financiers).
L’exceptionnelle croissance des
Etats-Unis dans la deuxième moitié
de la dernière décennie, même si
elle est suivie d’un ralentissement
en 2001-2002, est due au double
déploiement de la nouvelle économie-
TIC et de la nouvelle économie-ST,
celle-ci s’appuyant sur des réseaux
de communication, de télécommu-
nications et d’énergie de grande
qualité.
RÉSEAUX, MARCHÉS
ET INSTITUTIONS
Pour comprendre les interac-
tions entre réseaux, marchés
et institutions, il faut cerner de plus
près la notion de réseau. Jusqu’à
une période récente, elle s’analysait
principalement du point de vue
des techniques mises en œuvre :
ainsi, la circulation de l’information
est souvent confondue avec l’ob-
servation physique des flux. Par
exemple, dans une organisation
logistique classique, l’étiquette
portant la mention de l’expéditeur,
du destinataire et de
la nature de la mar-
chandise est attachée
au colis et ne renseigne
que celui qui l’a sous les
yeux.
L’identification de
l’information comme
processus indépendant
et le développement
des TIC transforment
la représentation mor-
phologique des réseaux.
Pour simplifier, on peut
en distinguer trois ni-
veaux :
– l’infrastructure, qui concerne le
réseau physique et les procédures
de maintien de la sécurité et de
la qualité des divers tronçons du
réseau ;
–l’infostructure, qui concerne
l’acheminement du trafic d’une
origine vers une destination, le
contrôle de bout en bout des
liaisons, et qui assure la compati-
bilité des éléments périphériques
au réseau, entre eux et avec l’in-
frastructure ;
– le niveau des services, qui rend
le réseau accessible aux usagers et
définit les spécifications des ser-
vices finaux qui leur sont offerts.
Ces réseaux « enrichis » par l’essor
des TIC structurent les espaces et
les marchés. En ce qui concerne
les espaces, les batailles autour
des tracés et des gares de TGV
rappellent l’importance des enjeux :
un territoire préalablement continu
sera bouleversé par des lignes, des
nœuds de communication, des
origines et des destinations qui
concentrent les échanges ou qui
isolent des acteurs : sans réaction,
ces derniers peuvent être réduits
à l’insignifiance.
Pour les marchés, les conséquences
sont encore plus évidentes. L’eau,
le gaz, l’électricité, le téléphone ne
sont pas accessibles dans le vide,
mais à des points de
connexion obéissant
à des contraintes
physiques et commer-
ciales. Si le client final
n’est pas en position
d’accéder directement
ou indirectement à
une connexion, il est
hors réseau et donc
hors marché. Le réseau
n’est pas seulement
générateur ou modé-
rateur des coûts de
transaction entre les
agents économiques :
il peut rendre tout
simplement possibles
ou impossibles les relations entre
eux. De plus, la médiation anonyme
du marché traditionnel est rem-
placée, dans un marché dépendant
d’un réseau, par une médiation
personnalisée qui peut être exploi-
tée comme telle. Le réseau ne se
contente donc pas de structurer le
marché, il transforme la relation
entre les agents économiques.
Enfin, l’efficacité des réseaux dé-
pend des institutions, au sens
large du terme : organisation légale
et réglementaire du marché des
opérateurs et offreurs de services
sur un réseau donné ; organisation
du marché du travail et organisa-
tion industrielle des opérateurs ;
possibilités techniques, légales et
organisationnelles permettant
d’exploiter les potentialités d’un
réseau.
Le déploiement
de la nouvelle
économie
aux Etats-Unis
s’est appuyé
sur un effort
d’investissement
dans les réseaux
de communication,
de télécommunications
et d’énergie.

46
Sociétal
N° 37
3etrimestre
2002
R E P È R E S E T T E N D A N C E S
Au total, ne pas investir dans les
réseaux qui rendent possible l’essor
des TIC et du « système technique »
moderne, c’est non seulement se
couper des sources de la croissance,
mais aussi accepter que nos terri-
toires soient enrichis ou appauvris
par les décisions d’autres investis-
seurs. C’est accepter que nos
marchés soient structurés par des
décideurs extérieurs. C’est se
priver de sources d’évolution de
nos institutions, dont la rigidité nous
conduira vers l’archaïsme social et
l’isolement économique.
Or il est impossible de développer
l’infostructure et les services liés aux
réseaux modernes sans investir
dans leurs infrastructures.
L’URGENCE
D’UN RÉVEIL FRANÇAIS
Où en est la France dans ce
domaine ? L’investissement
public y a représenté 2,9 % du PIB
en moyenne, en 1998 -1999, contre
1,3 % au Royaume-Uni, 2,8 % aux
Pays-Bas, 3,1 % aux Etats-Unis et
7,8 % au Japon. Si l’on ne prend en
compte que les pays dont les
comptes publics évoluent sur un
sentier de croissance soutenable
(donc en laissant de côté le cas
du Japon, dont le déficit public est
trop lourd), deux groupes de pays
apparaissent :
– Les Etats-Unis et les Pays-Bas ont
connu une croissance économique
extrêmement rapide depuis plus
d’une douzaine d’années (plus de
43 % sur la période 1987-1999) ;
or l’effort d’investissement public
annuel moyen a été de 3,15 %
du PIB aux Etats-Unis entre 1994
et 1999, c’est-à-dire pendant le
décollage de la nouvelle économie,
et de 2,95 % du PIB aux Pays-Bas
entre 1987 et 1999.
– La France et le Royaume-Uni ont
connu une croissance beaucoup
plus modérée (29 % en cumulé
entre 1987 et 1999) ; l’effort d’in-
vestissement public annuel moyen
en 1994 -1999 s’est établi à 3,10 %
du PIB en France, et à 1,55 % du
PIB au Royaume-Uni.
La France a donc eu un niveau
d’investissement public comparable
aux deux pays à croissance rapide,
alors qu’elle a connu une croissance
faible – légèrement inférieure à
CROISSANCE
2,5
3,0
3,5
4,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,5
2,0
2,5
Total de l'investissement public
Investissements de l'Etat
Investissements des administrations
publiques locales
Sources : Comptes de la Nation (2000) et Rapport économique
et financier pour 2001.
L’INVESTISSEMENT PUBLIC EN FRANCE
(EN % DU PIB)
L’investissement local, qui représente plus des deux tiers de l’investissement public
total, a baissé de 2,3 % à 1,92 % du PIB entre 1993 et 1998, avant de remonter à
1,98 % du PIB en 2000. L’investissement de l’Etat a diminué parallèlement, mais sa
baisse s’est poursuivie pour atteindre un niveau inférieur à 0,5 % du PIB en 2000,
soit moins du quart de l’investissement local et un sixième de l’investissement
public total.

47
Sociétal
N° 37
3etrimestre
2002
LA NOUVELLE ÉCONOMIE A BESOIN DE RÉSEAUX
celle du Royaume-Uni. On peut
donc se demander si la France
conduit un effort d’investissement
public adapté aux besoins modernes.
Les collectivités locales en sont la
principale source (voir le graphique).
L’effort d’investissement de l’Etat
a baissé constamment depuis une
dizaine d’années. En ce qui concerne
la nature de ces investissements,
les évaluations de la comptabilité
nationale recouvrent les travaux
neufs (45 % du total) et les travaux
d’entretien et de renouvellement
(55 %).
Ce ralentissement des investisse-
ments publics en France semble
faire l’objet d’un étrange consensus.
Les documents officiels les plus
élaborés dans ce domaine concer-
nent les priorités pour les infra-
structures de transport : rapport
Bonnafous (1999), étude du
ministère de l’Equipement (1997).
Ces documents se placent dans
le contexte apparemment le plus
probable, en l’absence de stratégie
volontariste : une croissance éco-
nomique moyenne de l’ordre de
2,5 %,voire 2 % l’an ; un vieillissement
de la population conduisant à la
saturation du taux d’équipement
automobile, au plafonnement d’autres
types de demande, à une réduction
des programmes d’investissement
routier ; le tout conduisant à un
« scénario stratégique recomman-
dant un tassement de l’offre d’in-
frastructures » (Bonnafous).
Le document intitulé « Schémas
multimodaux de services collectifs :
transports de voyageurs et de
marchandises » (Datar, automne
2000), publié dans la foulée de la
Loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement durable du
territoire du 25 juin 1999, confirme
ce manque d’ambition. La projec-
tion centrale de croissance de
l’économie à l’horizon 2020 est de
2,3 % l’an (avec la prise en compte
d’une hypothèse à 1,9 %). Faisant
état des « perspectives de forte
dégradation du niveau de service
Dans les modèles néoclassiques,
la croissance de la production ré-
sulte de l’accumulation de capital
productif, de l’augmentation de la
quantité de travail et du progrès
technique qui permet d’améliorer
la productivité des autres facteurs.
Selon cette approche, le rendement
du capital est décroissant : seul
le progrès technique permet de
le maintenir – ce progrès étant
exogène et gratuit.
C’est avec les articles sur la crois-
sance endogène de Paul Romer
(1986 et 1990) et de Robert
Lucas (1988) que l’on introduit
des effets d’externalité liés à des
mécanismes de diffusion du sa-
voir. La technologie et les
connaissances scientifiques sont
des biens non rivaux, c’est-à-dire
que leur utilisation par un pro-
ducteur n’exclut pas leur
utilisation par d’autres. La re-
cherche-développement peut
avoir des rendements croissants :
par exemple, une fois un logiciel
mis au point, son coût marginal de
production est négligeable.
Ces externalités, grâce auxquelles
le rendement de l’ensemble des
facteurs de production est crois-
sant, peuvent être le capital tech-
nologique et scientifique, ou bien
l’ensemble du capital public au
sens large. Ce dernier, qu’il soit
assimilé à l’effort public d’éducation,
de recherche-développement, de
diffusion de l’information, de télé-
communications, ou à la construc-
tion d’infrastructures, contribue à
la croissance de l’économie selon
quatre canaux (Bernard Fritsch,
1999) :
– l’éducation, la recherche et la
construction d’infrastructures aug-
mentent directement la demande
finale ;
– les réseaux (communications,
télécommunications, énergie,
eau, collecte et traitement des
déchets…) permettent aux entre-
prises de produire et d’expédier
leur production ;
– le capital public augmente la
productivité et l’efficacité des
facteurs de production privés. Par
exemple, l’extension et l’améliora-
tion des réseaux de transport
urbain contribuent à accroître le
marché du travail où l’entreprise
peut rechercher sa main d’œuvre ;
la production en « juste à temps »
dépend de façon cruciale de la
qualité des réseaux routiers et
autoroutiers, etc ;
– le capital public peut exercer des
effets d’attraction et de localisation
qui bénéficient aux territoires dotés
des meilleures infrastructures.
Comme le montrent Sylvie Charlot
et Miren Lafourcade (2000), l’im-
pact le plus net des infrastructures
de transport réside moins dans le
surcroît de richesse qui en résulte
que dans la réduction des coûts de
transaction. Les modèles d’écono-
mie géographique permettent
d’associer la baisse des coûts de
transaction (ou, plus spécifiquement,
des coûts de transport), l’exploita-
tion des externalités (pécuniaires
ou technologiques) et le niveau des
disparités régionales. Comme le
rappellent les auteurs, des travaux
empiriques d’économistes améri-
cains,à la fin des années 80, avaient
établi un lien si net entre infra-
structures et croissance de la
productivité que l’administration
fédérale a décidé de consacrer un
budget spécial de 27 milliards de
dollars aux dépenses d’infrastructures
sur la période 1994-1998 – qui fut
celle d’un nouveau décollage de
l’économie américaine.
Stock d’infrastructures
et croissance économique

48
Sociétal
N° 37
3etrimestre
2002
R E P È R E S E T T E N D A N C E S
des autoroutes A7 et A9 à l’hori-
zon 2020 », le rapport propose, à
moyen terme, le développement
d’autres modes de déplacement
comme le fret ferroviaire (dont on
connaît les déficiences notoires,
essentiellement dues au monopole
et à l’organisation interne de la
SNCF) ; il préconise aussi l’achève-
ment d’autres autoroutes ou l’amé-
nagement progressif en artères
interurbaines de certaines routes
nationales. La seule action directe
envisagée est la « mise en œuvre
d’une stratégie volontariste d’ex-
ploitation et de modulation des
péages, afin d’optimiser la capacité
des autoroutes et des axes alter-
natifs ».
RELANCER LES
INFRASTRUCTURES
Or, le simple bon sens incite à
adopter une stratégie radica-
lement opposée. Si l’on admet
le lien, confirmé par l’expérience
américaine, entre le développement
de la nouvelle économie et la qualité
des réseaux, si l’on se fie d’autre
part à des évaluations techniques
très crédibles, selon lesquelles les
travaux d’entretien et de rénovation
des réseaux physiques en France
sont probablement inférieurs d’un
cinquième à ce qu’ils devraient être
pour maintenir le stock de capital
public à un niveau satisfaisant d’ef-
ficacité, de qualité et de sécurité,
c’est une vigoureuse relance de la
construction d’infrastructures qu’il
faut préconiser.
Le taux d’investissement public en
France, de 2,9 % du PIB en 2000-
2001, se divise en travaux neufs
(1,3 % du PIB) et travaux d’entretien
ou de renouvellement (1,6 % du
PIB). Il faudrait envisager d’aug-
menter progressivement le taux
de travaux neufs d’un demi-point
de PIB en cinq ans (un dixième de
point par an sur la période 2002-
2006) en centrant cet effort sur
les infrastructures les plus utiles
(communication, télécommunica-
tions, énergie, adduction d’eau,
collecte des déchets et traitement
des eaux usées), et d’augmenter le
taux des travaux d’entretien et de
renouvellement de 0,4 % du PIB
en cinq ans. Ce double mouve-
ment porterait le taux d’investis-
sement public de moins de 2,9 %
du PIB en 2001 à 3,8 % du PIB en
2006. Ce taux d’investissement
public annuel devrait être main-
tenu autour de 3,8 % du PIB au
cours des dix années suivantes.
Cet effort ne doit pas être l’occa-
sion de nouvelles querelles idéo-
logiques, car peu importe, en
dernière analyse, la nature de
l’investisseur : toutes les tech-
niques de financement mobilisant
des partenariats public-privé
peuvent être utilisées. C’est à ce
prix que la France pourra rester
un acteur, et non un simple spec-
tateur-consommateur, de cette
nouvelle économie dont nous
n’avons sans doute encore vu que
les commencements.l
CROISSANCE
Bibliographie
Bonnafous (rapport, 1999) :
« 2000-2006 : Quelles priorités pour les infrastructures de transports ? »
Commissariat Général du Plan.
Charlot Sylvie et Lafourcade Miren (2000) :
« Infrastructures publiques, coûts de transport et croissance régionale »,
in Economie géographique : les théories à l’épreuve des faits, Economica,
Paris, octobre 2000.
Datar (automne 2000) :
« Schémas multimodaux de services collectifs : transports de voyageurs
et de marchandises », automne 2000.
Datar (novembre 2000) :
Aménager la France de 2020,
La Documentation française.
Lucas, Robert (1988) :
« On The Mechanics of Economic Development,
Journal of Monetary Economics, 22 (July 1988) : p 3-42.
Ministère de l’Equipement (1997) :
La demande de transports en 2015, SES.
Romer, Paul (1986) :
« Increasing Returns and Long Run Growth »,
Journal of Political Economy, 94 (October 1986) : p. 1002-1037.
Romer, Paul (1990) :
« Endogenous Technological Change »,
Journal of Political Economy, 98, (October 1990, Part 2) : p. S 71-S 102.
1
/
5
100%