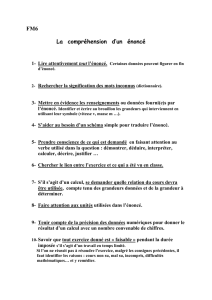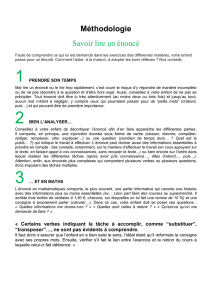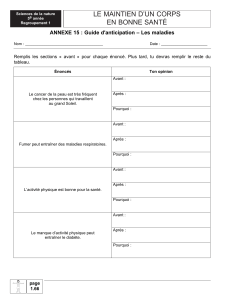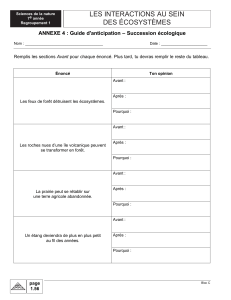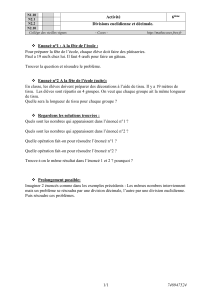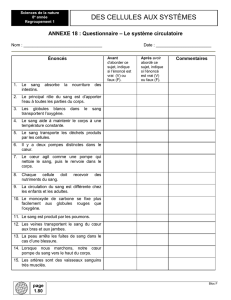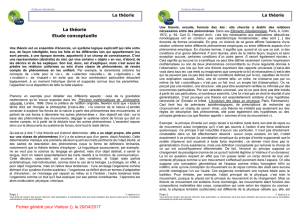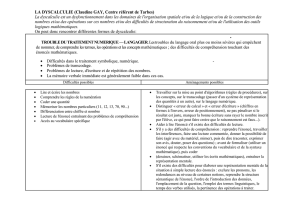1 Article paru dans la Revue du Nouvel Ontario n° 20, 1996: pp.76

1
Article paru dans la Revue du Nouvel Ontario n° 20, 1996: pp.76-112
(Numéro spécial: La langue française en Ontario)
ANALYSE MORPHOSYNTAXIQUE DU PARLER
D'UN GROUPE D'IMMIGRANTS FRANÇAIS À TORONTO
1
Gilles F
ORLOT
Université de Rouen
& Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO),
Ontario Institute for Studies in Education, Toronto
Introduction
La francophonie torontoise est depuis longtemps pluriethnique. L'immigration a fait que la
population ayant pour langue d'usage le français est d'horizons divers, contrairement à d'autres
régions francophones de l'Ontario. Cela revient à dire que la langue française parlée à Toronto est
difficilement définissable, ou plutôt qu'elle est constituée de nombreuses variétés, et notre étude se
donne pour objectif de cerner l'évolution morphosyntaxique du parler d'un certain nombre de
ressortissants français immigrés à Toronto depuis des périodes allant de trois à quarante quatre.
Notre approche est d'abord idiolectale, c'est-à-dire qu'elle se penche sur la pratique individuelle d'un
locuteur : nous avons découvert que l'évolution du parler de ces locuteurs diffère grandement en
fonction de facteurs externes, notamment la migration et l'acculturation, facteurs que nous ne
développerons pas ici mais qui nous obligent à rester prudents dans nos conclusions et à éviter une
quelconque généralisation (Forlot, 1995).
Ce qui reste sûr dans cette francophonie torontoise, d'où qu'elle vienne et quels qu'en soient
les accents, c'est qu'elle doit s'accommoder d'une partenaire inévitable parce que majoritaire : la
langue anglaise. C'est ce bilinguisme, accepté par la plupart de nos vingt-sept locuteurs et pratiqué
de façon plus ou moins intense par tous, qui nous incite à évoquer une pratique langagière bilingue,
ou un «parler bilingue». Nous allons montrer que dans la syntaxe orale du migrant d'origine
française, il y a cette présence de l'anglais, et nous en soulignerons, par l'analyse de quarante-six
énoncés, le nouveau fonctionnement et les restructurations.
1
Je tiens à remercier Claude Caitucoli, Bernard Gardin et Régine Delamotte-Legrand pour leurs remarques lors
de la soutenance d'un travail de 3
e
cycle universitaire dont cet article s'inspire.

2
I - Méthodologie
1 - Choix des locuteurs et prise de position méthodologique
Comme nous l'avons dit, les locuteurs sont tous originaires de France. Ils vivent au Canada
depuis très longtemps pour certains et depuis seulement cinq ou six ans pour d'autres. Le lecteur
trouvera quelques données sur ces personnes interviewées en annexe. Il s'agissait d'abord
d'interroger des Français élevées et éduquées en France : le fait qu'elles y soient nées ou non,
qu'elles soient d'origine étrangère ou française, qu'elles aient émigrées à l'âge de vingt ans ou à celui
de cinquante ans, peu importait de prime abord. Même si ces facteurs avaient certainement un poids
sociolinguistique non négligeable dans l'adaptation et l'acculturation de nos locuteurs, ce que nous
voulions d'abord, c'était un échantillon de sujets éduqués dans la même langue et la pratiquant
comme langue maternelle, même si certains pouvaient aussi en avoir une autre. Ce critère impératif
venait du fait que nous avions pour objectif de repérer ce qui dans le discours de nos locuteurs,
pouvait sembler non habituel, en somme non standard aux oreilles de l'enquêteur français que nous
étions.
Cela nous amène à aborder la question de l'analyse linguistique. Notre prise de position est
celle d'un examen des formes linguistiques au travers de l'analyse conversationnelle. Nous
considérons que notre corpus ne peut être abordé de façon convenable que par le biais de la
contextualisation du discours, ce qui revient aussi à dire que nous ne faisons pas une analyse des
formes non standard par rapport aux formes préconisées par les grammaires et dictionnaires ou
recensées par les travaux antérieurs. Nous préférons partir du principe que tout énoncé est actualisé
s'il est validé par son destinataire, autrement dit que tout ce que dit un locuteur est acceptable dans
la mesure où le contrat énonciatif qui unit énonciateur et destinataire est respecté. Le résultat de
cette prise de position est que nous n'entendons pas adjoindre à un énoncé l'astérisque marquant son
inacceptabilité, parce que la seule personne apte à valider ou non un énoncé, c'est son destinataire
(nous-même dans les entrevues et les co-énonciateurs dans l'observation discrète). Ainsi, c'est notre
intuition de locuteur francophone de France, mais aussi de participant à l'interaction, qui nous a
servis pour résoudre la problématique suivante : Y a-t-il une évolution de la construction
morphosyntaxique du discours de chacun de ces Français installés à Toronto?
2 - Les entretiens
Pour parvenir à répondre à la problématique posée, il fallait d'abord identifier ce que Lüdi
(1987: 2) nomme les marques transcodiques, ces éléments d'adaptation linguistique au système de

3
la langue d'accueil. Il a donc fallu procéder à des relevés puis à un classement en vue de faire une
typologie. Pour la cueillette des données linguistiques, l'analyse du français parlé par nos
informateurs s'imposait et ceci fut fait au moyen de l'entretien enregistré. Douze entretiens ont donc
été menés, auxquels nous avions fixé des limites suivantes : en premier lieu, chaque entretien devait
durer entre 25 et 35 minutes, avec une durée préférée d'une trentaine de minutes. Cette limite était
indispensable parce que la durée est susceptible de faire varier les données statistiques : plus
l'informateur parlait longtemps, plus son discours pouvait comporter d'éléments d'interférences de
toutes sortes, et nous ne voulions pas arriver à des conclusions faussées par une interprétation
quantitative erronée du corpus. Avec un corpus somme toute relativement petit et une préférence
méthodologique pour l'analyse interactionnelle des idiolectes, nous avons décidé qu'il n'était pas
sage de tirer des conclusions statistiques sur la fréquence d'apparition des énoncés variants chez nos
informateurs. Nous nous sommes contenté de les relever, de les classer et d'analyser
individuellement l'idiolecte de chaque locuteur. Pour arriver à des contextes conversationnels et des
sujets de discussions plutôt similaires entre chaque entretien, nous avons appliqué la deuxième
limite à nos entrevues, celle qui a trait aux sujets de discussion abordés. C'est le principe de
l'entretien semi-directif, où l'enquêteur pose les questions et donne une orientation à la réponse de
son interlocuteur.
Nous avons bien sûr eu à faire face à ce que Labov a appelé le paradoxe de l'observateur
(Labov, 1976: 290) : il y a en effet un paradoxe à vouloir observer un locuteur et à s'attendre à ce
que sa production linguistique soit la plus naturelle possible. Cependant, il ne nous semble pas que
l'on puisse arriver à un corpus «naturel», simplement parce qu'en termes d'interaction langagière, le
naturel est tout à fait subjectif : dans un entretien, on pourra juger que tout est naturel, ou alors que
rien ne l'est. On aurait donc pu abandonner l'objectif de la situation réelle, se passer de l'expérience
qui consiste à «surmonter le paradoxe» et à «briser les contraintes de l'interview» (Labov, 1976:
290) et ceci parce que l'interaction entre l'enquêteur et l'enquêté est une situation comme une autre,
et qu'il n'y a pas de raison de la considérer comme moins réelle ou moins naturelle qu'une autre. Les
précautions du chercheur n'éliminent pas le fait que la conversation, c'est avant tout une négociation
énonciative et l'interview n'est qu'une forme de conversation.
Cependant, on peut difficilement éviter cette attention portée au discours par l'enquêté, que
Labov appelle la «surveillance auditive de son propre discours par le locuteur» (1976: 288), du fait
de l'intimidation que peut provoquer la présence de ces intrus que sont le chercheur, son
magnétophone et ses questions quelquefois indiscrètes. Attendu qu'en situation d'entretien, comme
Labov le précise, l'enquêté ne parle pas son vernaculaire, justement du fait de cette attention qu'il
porte à son discours (c'est ce que le linguiste américain appelle la formalité (Labov, 1976: 289)),
nous avons toutefois appliqué ses mises en garde le plus possible, en essayant d'abord de rassurer

4
nos informateurs sur le côté informel de notre discussion, et en posant par exemple les questions
concernant l'usage de la langue française, en particulier en ce qui a trait à sa norme et au jugement
que nos locuteurs font de leur pratique, à la fin de l'entretien, durant les cinq dernières minutes :
ceci nous permettait de construire avec les locuteurs une conversation qui leur semblait ordinaire et
éloignait les risques de vigilance métalinguistique, dont on allait certainement sentir la plus grande
intensité au moment de parler avec eux des pratiques et normes linguistiques. Ceci s'est trouvé
confirmé lors de la transcription des corpus.
3 - L'observation participante, ou observation discrète
Cette méthode nous permettait aussi d'appliquer les mises en garde de Labov sur les
problèmes de la surveillance du discours par l'enquêté. Nous avons ainsi pratiqué l'observation
participante au sein de certains groupes de Français expatriés que nous fréquentons, ou dans des
lieux où l'on est susceptible de rencontrer des Français en situation d'interaction. Il s'agissait donc
bien d'une observation dissimulée (avec toutes les précautions d'ordre éthique). Les locuteurs
«observés» n'étaient pas enregistrés : nous nous empressions de faire une retranscription écrite
discrète des éléments pertinents, méthode qui ressemble à celle utilisée par Labov (1976: 100-101)
lors de son étude de la stratification sociale du /r/ dans trois magasins de New York.
Laperrière souligne d'autres problèmes, auxquels nous avons aussi dû faire face :
l'observateur qui procède ainsi rencontre des difficultés structurelles (les limites spatiales et sociales
du rôle que se donne l'enquêteur), des contraintes matérielles (la prise de notes sur place est difficile
et l'enquêteur ne peut pas réécouter les énoncés) et des problèmes affectifs qui proviennent de son
implication dans le déroulement de sa propre étude (1993: 258).
Il est vrai que cette observation discrète ne pouvait pas fonctionner dans tous les lieux que
nous avions sélectionnés, surtout pour des raisons matérielles : la réception auditive dans certains
lieux était trop faible ou trop floue, et nous n'étions pas en mesure de transcrire la plupart des
énoncés faute de les avoir entendus de façon satisfaisante. Par conséquent, nous nous sommes
contenté de quatre lieux d'observation discrète systématique : deux écoles de langues, une petite
entreprise, et une école secondaire, toutes quatre largement fréquentées par des locuteurs originaires
de France. Toutefois, nous avons aussi profité des occasions qui se présentaient de cotoyer des
Français, lorsque la prise de notes était possible.
L'avantage de ce type d'observation est qu'il permettait d'obtenir des données que nous
pouvions comparer avec celles obtenues lors des entretiens. En effet, y avait-il dans la production
des locuteurs observés des variantes morphosyntaxiques absentes dans le parler de nos locuteurs
interviewés? Avons-nous échappé à la vigilance métalinguistique? Le fait d'observer sans se poser

5
d'emblée comme enquêteur laissait-il au locuteur le libre choix de son registre de langue, de sa
variété stylistique
2
?
Notre réponse négative à cette dernière question vient du fait que l'enquêteur en observation
discrète n'est pas le seul à déterminer l'orientation stylistique de la conversation : dans notre cas,
nous n'étions qu'un des participants à la conversation, et un locuteur pouvait varier ses registres
stylistiques en fonction des autres participants. Dans les écoles où nous avons fait de l'observation,
un professeur pouvait orienter son discours en fonction de nombreuses personnes : un adulte, le
directeur, un enfant francophone, un enfant anglophone, un enfant sage, un enfant agité, l'enquêteur
seul, l'enquêteur dans un groupe etc., et dans chacune de ces situations, le locuteur opère une
modulation stylistique, c'est-à-dire qu'il renégocie ses contrats énonciatifs. Ces séances
d'observations discrètes, qui ne furent presque jamais planifiées parce que nous voulions les faire
paraître aussi naturelles que possible, ont eu un rendement somme toute peu élevé sur le plan de la
quantité des items linguistiques relevés, certainement parce que nous avons laissé échapper bon
nombre d'items dans cette situation d'enquête, et ceux que nous avons relevés n'ont été conservés
que dans la mesure où leur transcription nous a paru certaine.
II - Parler bilingue et évolution morphosyntaxique
1 - Mise au point terminologique
1.1 - Le parler bilingue
La migration représente un des aspects fondamentaux du comportement social et langagier
de nos locuteurs. Il s'agit de francophones ayant vécu une expérience de migration internationale
(de la France vers Toronto, directement ou via d'autres villes ou d'autres pays). Si s'expatrier ne
signifie pas toujours changer de langue, cela implique certainement changer ses habitudes et ses
pratiques langagières, puisque les interactions se feront très vraisemblablement avec les membres
d'un autre peuple, d'une autre culture. En d'autres termes, si la migration ne signifie pas toujours
changer de langue, elle impose souvent de changer sa langue, qu'on en soit conscient ou non. Les
personnes que nous avons interrogées et observées, toutes originaires de France (métropolitaine) se
trouvent être dans cette situation, où l'on doit, où l'on peut
3
cumuler deux cultures (ou plus).
Lüdi et Py rappellent la théorie déterministe qui a longtemps fait autorité et qui prétendait
«que la relation entre la langue maternelle et la pensée était si profonde et si unilatérale que le
2
Labov (1976:288) parle d'un champ d'alternance stylistique, continuum plus ou moins étendu selon les
locuteurs et sur lequel ceux-ci varient leur discours «à mesure que le contexte social et le thème se modifient».
3
Le choix entre le verbe «devoir» et le verbe «pouvoir» n'est pas question de style ici; chaque locuteur réagit
différemment à son expérience migratoire, et ceci a une influence sur les choix et les pratiques langagières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%