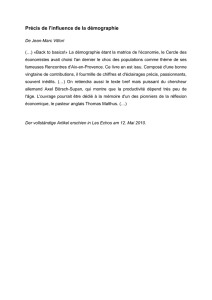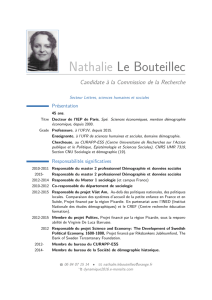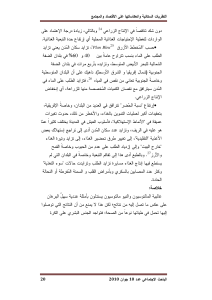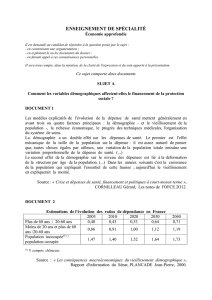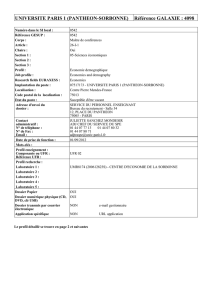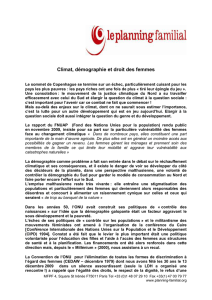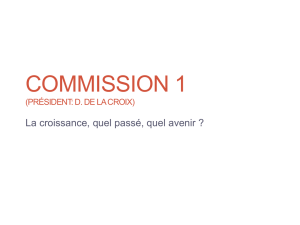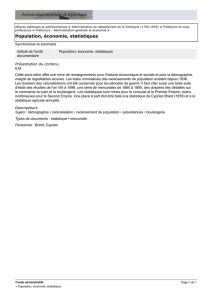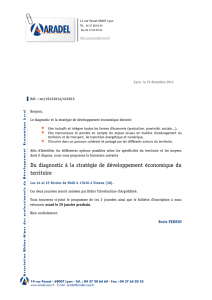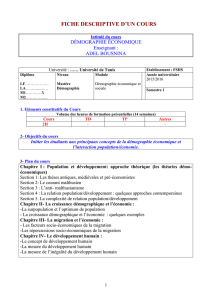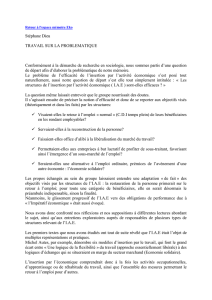Bozon, 2006 - La Faculté des Sciences Sociales de l`Université de

1
CHAPITRE 136
_____________
L’APPORT DES METHODES QUALITATIVES EN
DEMOGRAPHIE
Michel Bozon
Institut national d’études démographiques, Paris
L’association des méthodes qualitatives et quantitatives dans l’étude des
populations n’a pas toujours été considérée comme une rencontre délicate. Dans
l’anthropologie sociale et culturelle britannique, comme dans l’ethnologie pratiquée
par les Français, il était d’usage jusqu’au milieu du XXe siècle environ, que toute
monographie d’une population débute par sa morphologie et donc par une description
démographique (Kertzer et Fricke, 1997, p. 3-4). Marcel Mauss, dans son célèbre
Manuel d’ethnographie, élaboré dans les années 1930, qui a tracé le cadre de la
monographie ethnographique, indiquait ainsi au chapitre 3 (Morphologie sociale):
"Une enquête statistique et démographique proprement dite complètera l’étude de la
morphologie sociale. Il faudra dresser une statistique par maison, dans le temps…; par
famille, par clan, par tribu (lorsque la société comprend plusieurs tribus). On
mesurera ainsi la fécondité, la natalité par sexe, la morbidité, la mortalité, en
distinguant soigneusement la mortalité par accident ou par mort violente de la
mortalité naturelle" (Mauss, 1947, p. 20). Par la suite, l’intérêt des anthropologues
pour la démographie a décliné, à mesure que cette dernière se développait et que son
appareil statistique se sophistiquait.
L’autonomie de la démographie s’est largement fondée, historiquement comme à
l’époque contemporaine, sur la disponibilité et la production de données chiffrées
nombreuses, qu’il s’agisse de statistiques d’état civil, de données de recensement ou de
registres, d’enquêtes démographiques à passage unique ou à passages répétés. Pour
traiter ces masses énormes de données, les démographes ont inventé des méthodes
statistiques de plus en plus élaborées, destinées en premier lieu à mettre de l'ordre dans
les chiffres1. Dans le même temps, une partie des démographes ont toujours exprimé un
1 Allan Hill (1997, p.224) évoque l’« effet pervers » pour la démographie d’une telle quantité de chiffres, “ the
corrosive effect of too many numbers “.
Bozon Michel, 2006. – L’apport des méthodes qualitatives en démographie. in: Graziella Caselli, Jacques
Vallin et Guillaume Wunsch (sous la direction de), Démographie et synthèse. Volume VIII. Observation,
méthodes auxiliaires, enseignement et recherche, p. 433-457. – Paris, Ined-Puf. 760 p.

2
intérêt pour des méthodes appartenant à l’anthropologie ou à la sociologie qualitative
ou manifesté une disposition à dialoguer avec des représentants de ces disciplines
(Roussel et Bourguignon, 1976, 1979 ; Caldwell et al., 1988 ; Gérard et Loriaux,
1988 ; Basu et Aaby, 1998 ; Courgeau, 1999).
Une attitude ouverte à l’égard d’approches non quantitatives n’est pourtant pas le
fait de tous les démographes, de même que l’intérêt d’une coopération avec les
démographes n’est pas perçu par tous les chercheurs en sciences sociales, en particulier
par les plus qualitativistes d’entre eux (pour des exemples voir Kertzer et Fricke,
1997). Pour certains auteurs en effet, il existerait une hétérogénéité radicale,
paradigmatique, entre les recherches fondées sur la quantification (dont la démographie
fait partie) et celles qui utilisent des méthodes qualitatives, opposition que Maryse
Marpsat (1999, p. 13) résume ainsi : "Les méthodes quantitatives se rattacheraient à
une vision strictement positiviste ou empiriste, inspirée des sciences de la nature,
visant à tester des hypothèses par la mise en évidence de corrélations entre des
variables ; les méthodes qualitatives, par l’importance accordée au sens donné à leurs
actions par les acteurs eux-mêmes, correspondraient à d’autres traditions
intellectuelles (sont en général cités la sociologie compréhensive de Weber, la
phénoménologie, à laquelle on peut rattacher l’ethnométhodologie, l’interactionnisme
symbolique)". Dans cette perspective, l’opposition entre une science des faits et une
science des interprétations serait évidemment irréductible.
D’autres chercheurs considèrent qu’il s’agit de méthodes différentes, mais
qu’elles peuvent être combinées et articulées au sein de projets de recherche complexes
et d’équipes multidisciplinaires, en fonction des objets d’analyse. Je me situe sans
équivoque dans ce second courant, considérant que pour aborder les questions dont
traite la démographie et faire évoluer la discipline, il est souhaitable d’associer les deux
types de méthodes et de faire émerger une approche compréhensive. En conséquence,
me semble-t-il, la démographie doit moins être définie par ses sources ou par ses
méthodes d’analyse que par son objet, qui est l’analyse de la reproduction des
populations, envisagée dans une perspective large (voir à ce propos Greenhalgh, 1995,
p. 3-28 ; Townsend, 1997, p. 96-114).
L’apport des méthodes qualitatives sera d’abord ici illustré par la diversité des
types de recherches démographiques dans lesquelles elles interviennent, dont des
exemples sont donnés. Les techniques les plus utilisées dans les recherches seront
ensuite présentées. Les objectifs assignés à ces méthodes et les rôles divers qu’elles
jouent seront ensuite détaillés. Les effets des approches compréhensives sur la
démographie elle-même seront enfin envisagés. Dans certains cas, elles modifient
seulement la présentation des résultats. Dans d’autres cas, elles ont des effets
théoriques, faisant surgir de nouvelles méthodes quantitatives, de nouvelles
interprétations, voire de nouvelles questions.
On ne s’étonnera guère qu’une bonne part des exemples soient empruntés à des
travaux menés sur les pays en développement, qui sont aussi des pays à statistiques

3
imparfaites, dans lesquels le recours à des données complémentaires paraît
particulièrement nécessaire (voir à ce propos Pison, 1980 ; Quesnel, 1988). On laissera
en revanche délibérément de côté la démographie historique, même si des travaux se
rattachant à l’histoire orale (Leboutte, 1991) ou à l’anthropologie historique (Flandrin,
1976 ; Segalen, 1985) peuvent être considérés comme des travaux qualitatifs de
démographie historique.
I. Échantillons de "démographie compréhensive"
Dans la recherche démographique, le recours à des méthodes non quantitatives se
présente souvent comme un effort pour élargir les bases de l’explication d’un
phénomène. Cette démarche peut être qualifiée de « démographie compréhensive »
(Bozon, 1992a). Les travaux qui entrent dans cette catégorie n’ignorent nullement les
méthodes quantitatives; on peut dire qu’ils tentent d’introduire un va-et-vient critique,
une tension scientifiquement productive entre la détermination du domaine de validité
d'un phénomène et la compréhension de son sens.
Différence d’âge entre conjoints et « âge social »
Dans une étude sur la différence d’âge dans les couples entre hommes et femmes
(Bozon, 1990a et b), j’ai utilisé les données qui ont été recueillies dans une enquête sur
la formation des couples en France (Bozon et Héran, 1987, p. 969-970). Dans cette
recherche, le questionnaire, qui a été administré à 3000 personnes de moins de 45 ans
vivant en couple, constitue le cœur d’un dispositif plus vaste, qui comprend en premier
lieu une trentaine d’entretiens semi-directifs dont l’analyse systématique a permis de
préparer le questionnaire. Par ailleurs, à la suite de l’enquête principale, une seconde
série de 75 entretiens a été réalisée auprès de personnes sélectionnées parmi les
répondants du questionnaire. Le questionnaire lui-même comprenait environ 40
questions ouvertes sur un total de 250. Le phénomène de la différence d’âge entre
conjoints n’est pas envisagé comme un déterminant universel et relativement invariant
du mariage, qui ne requerrait aucune explication. L’enquête par questionnaire montre
que les femmes jeunes adhèrent bien plus que les hommes de même âge au modèle de
couple dans lequel l'homme est plus âgé. L’analyse des entretiens semi-directifs fait
apparaître que l’idéalisation par les femmes des hommes considérés comme mûrs
s’accompagne d’un net rejet des jeunes gens de leur classe d’âge, considérés comme
immatures et trop jeunes, au sens péjoratif. "Les hommes disponibles sont perçus,
classés et jugés en fonction de leur âge social, qui ne dépend que partiellement de leur
âge réel" (Bozon, 1990b, p. 581). La maturité sociale de l’homme au moment de la
rencontre est rattachée par les femmes à son expérience, à son statut professionnel, à
ses connaissances, à son autonomie résidentielle. Un retour aux données quantitatives
montre que cette idéalisation de qualités et d’atouts sociaux liés à la maturité des
hommes est d’autant plus forte chez les femmes qui ont elles-mêmes peu d’atouts

4
scolaires et professionnels et sont donc les plus dépendantes du statut social de
l’homme.
L’intérêt théorique des irrégularités et des anomalies
La démographie peut s’intéresser délibérément aux irrégularités. Étudiant une
population africaine à très haute fécondité (Gambie rurale), Caroline Bledsoe,
Fatoumatta Banja et Allan Hill (1998) partent, par exemple, d’un phénomène paradoxal
et contre-intuitif : les femmes qui ont connu des accidents reproductifs (fausse-couche,
mort-né, décès d’enfant en bas âge) tendent à adopter un peu plus fréquemment que
d’autres une contraception de type occidental. Ce comportement inattendu selon la
conception occidentale des régimes de haute fécondité est situé par les auteurs dans une
représentation locale de la vie reproductive des femmes. Le dispositif d’observation
comprend une enquête initiale, qui permet d’établir un registre des femmes d’âge
fécond de 40 villages ruraux (2 980 femmes au total), suivie de séries d’entretiens
ouverts et d’observations de terrain, et d’une enquête à passages mensuels de 15 mois
auprès d’un sous-échantillon de 270 femmes ayant eu une grossesse dans les 3 ans,
comprenant à la fois des questions quantifiables et des questions ouvertes. L’enquête
anthropologique met en évidence que le déroulement de la vie féconde est perçu
comme une "dépense des ressources du corps" (body resource expenditure). Le
potentiel reproductif d’une femme est limité par sa dotation totale en fœtus (nombre
fixé par Dieu, intangible pour une femme, mais variable de l’une à l’autre) et s’épuise
peu à peu, non pas au fil de l’âge mais au fil des épreuves subies par le corps :
l’irréversible perte des « muscles » liée aux grossesses et aux accouchements (y
compris les fausses couches), ainsi que la perte des forces, plus importante, lors des
traumatismes obstétricaux, mais qui peuvent être partiellement restaurées par un repos
entre les grossesses. La fécondité est ainsi vue comme « un potentiel à réaliser »,
plutôt que comme « une capacité limitée par l'âge »
2
(Bledsoe et al., 1998, p. 48).
L’idée d’un temps biologique individuel, qui s’écoulerait de façon continue, n’a pas
cours, ni la représentation de la ménopause comme un âge-limite de la reproduction.
Les individus se réfèrent en revanche à l’âge reproductif, réalité discontinue, illustrée
par les noms différents qu’une femme prend au cours des phases de dépense de son
potentiel
3
. Dans cette logique, il n’est pas étonnant que les initiatives contraceptives les
plus marquantes aient lieu après des agressions fortes contre le corps qui, malgré leur
rudesse, ne donnent pas droit au repos sexuel de l’abstinence post partum. Dans
certains cas, la contraception est de plus une tactique, qui permet aux femmes de ne pas
dilapider leur dotation reproductive dans l’attente d’un remariage éventuel. L’étude
d’une anomalie de la théorie révèle un continent enfoui de représentations sur le corps
et la fécondité et montre que le recours à une pratique considérée comme moderne (la
contraception occidentale) peut parfaitement s'inscrire dans une rationalité
2
“ a potential to be expended “ rather than “ a time-bound capacity “ (Bledsoe et al., 1998)
3
Ainsi on distingue la jeune femme sans enfant ou avec un seul enfant (janka en wolof), une jeune épouse ou
femme au début de sa vie reproductive (jongoma), une jeune femme mariée ou femme au milieu de sa vie
reproductive (jegg), etc. (Hill, 1997, p. 238).

5
traditionnelle.
Une démographie sans nombres
Le travail mené par Nancy Scheper-Hughes sur la mortalité infantile dans une
favela de l’État de Pernambouc, dans le Nordeste brésilien, peut sembler plus éloigné
des perspectives habituelles de la démographie (Scheper-Hughes, 1997). Elle le
qualifie elle-même de « démographie sans nombres » (« Demography without
numbers »). Le point de départ est pourtant classique. L’auteur étudie les déclarations
de décès d’enfants de moins de 5 ans à l’état civil d’une ville moyenne. Un tiers des
décès effectifs ne sont pas déclarés (dans bien des cas, la naissance ne l’était pas non
plus). Parmi les décès enregistrés, les trois quarts n’indiquent pas de causes; les causes
déclarées correspondent à une étiologie très sommaire mais caractéristique, « arrêt
cardiaque et respiratoire », « faim », « déshydratation », « faiblesse », « chute »… La
faible existence officielle de ces événements démographiques pousse l’auteur à tenter
de reconstituer la réalité sociale et culturelle des décès de bébés et d’enfants, à travers
une observation participante dans la favela et une enquête orale auprès des
protagonistes de ces décès (mères et voisines, pères, frères et sœurs, guérisseuses,
prêtres, fossoyeurs, etc.). Dans ce milieu de coupeurs de canne à sucre aux conditions
de vie extrêmement précaires, les mères observent un certain attentisme à l’égard des
tout petits enfants, qui se manifeste par un laisser-faire et une résignation calme face au
destin. L’idée prévaut que certains enfants n’ont, dès le début, pas le goût de vivre ni
de se battre et qu’il n’est pas nécessaire de tout faire pour garder en vie ceux qui sont
destinés à devenir des « anges ». Une sélection implicite s’opère ainsi dans les soins
donnés aux enfants; l’amour maternel ne s’enracine que très progressivement, lorsque
la certitude s’installe que l’enfant n’est pas seulement un visiteur occasionnel sur cette
terre. Cette remarquable observation de terrain permet d’éclairer le processus
d’intériorisation subjective des conditions de vie et de construction sociale des attitudes
maternelles, sur lequel l’histoire et la démographie historique, avec notamment les
travaux de Philippe Ariès sur l’émergence du sentiment de l’enfance à l’âge classique
(Ariès, 1973), avaient déjà ouvert la voie.
Un dispositif qualitatif/quantitatif pour l’étude des personnes sans abri
Les recherches menées à l’INED sur les personnes sans abri par Maryse Marpsat
et Jean-Marie Firdion (2000) constituent un bon exemple d’injection systématique et
raisonnée de méthodes qualitatives dans un dispositif principalement statistique.
L’enquête principale est fondée sur un questionnaire proposé à un échantillon
représentatif d’utilisateurs de centres d’hébergement et de distribution de repas pendant
un mois d’hiver à Paris. La passation du questionnaire a été précédée d’enquêtes de
nuit dans la rue et d’entretiens préliminaires auprès de personnes sans abri, puis suivie
d’une enquête par entretien auprès de responsables de centres d’hébergement, de
personnes sans domicile, ainsi que d’observations plus ethnographiques auprès de
personnes vivant de mendicité. Les entretiens exploratoires ont permis par exemple de
repérer « la récurrence des parcours d’hommes seuls ayant exercé des professions
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%