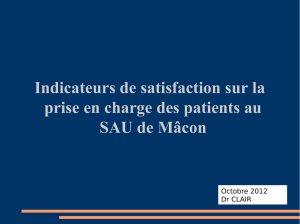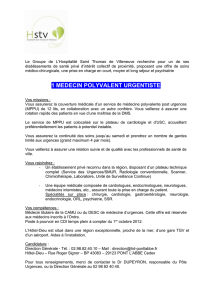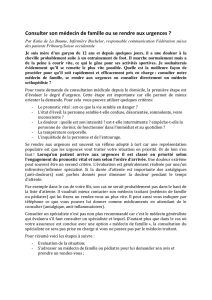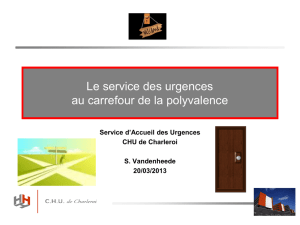Les urgences - Les bases de données de la FHP

FÉDÉRATION DE
L'HOSPITALISATION
FFp
PRIVÉE
Les urgences
Synthèse documentaire
Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ
février 2009

___________________________________________________________________________
FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ 1
février 2009
Les urgences
Synthèse documentaire
Sommaire
1. Cadre juridique d’exercice de la médecine d’urgence
1.1 Conditions d’autorisation d’activité de médecine d’urgence
1.2 Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences
1.3 Prises en charge spécifiques
1.4 Organisation territoriale de la prise en charge des urgences au sein du réseau des
urgences
2. Etat des lieux de l’activité des structures d’urgences
2.1 L’activité des structures d’urgence en quelques chiffres
2.2 Les usagers pris en charge dans les structures d’urgences
2.3 Les facteurs influant le recours aux structures d’urgences
3. Une amélioration de l’organisation et de la prise en charge nécessaire
3.1 Qualité de la prise en charge des patients
3.2 Propositions d’améliorations à apporter aux structures d’urgences
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Une grande partie de la demande de soins « en urgence » est prise en charge par la médecine
générale de ville. Toutefois, la population française recourt de plus en plus fréquemment aux
structures d’urgences hospitalières. Depuis leur création dans le milieu des années 60, les services
d’urgences n’ont cessé de voir leur activité croître d’année en année. Il y a aujourd’hui une demande
des usagers pour une prise en charge rapide, souple et efficace. Cette augmentation constante de la
fréquentation de ces structures est un phénomène commun à tous les pays qui en sont dotés.
L’organisation de la prise en charge médicale des urgences en France repose sur un réseau
d’intervenants publics et privés. Le secteur privé compte à ce jour 120 structures d’urgence. Il se
positionne en acteur essentiel de la permanence des soins.
Après avoir rappelé le cadre juridique d’exercice de la médecine d’urgence, la présente synthèse
dresse un état des lieux de l’activité ainsi que de l’organisation et la prise en charge des usagers dans
les structures d’urgences hospitalières publiques et privées.
1. Cadre juridique d’exercice de la médecine d’urgence
Les décrets n° 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006
1
relatifs à la médecine d’urgence déterminent
un cadre réglementaire rénové à l’organisation de la prise en charge des urgences au sein de
l’établissement et définissent un cadre territorial s’appuyant sur un réseau de prise en charge
coordonnée des urgences.
Les dispositions prévues par ces décrets ne sont actuellement pas toutes mises en œuvre. Les
Agences régionales de l’hospitalisation doivent modifier les schémas régionaux de l’organisation
sanitaire et constituer les réseaux d’urgences. Quant aux établissements de santé, ils disposent d’une
période transitoire pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.
1
Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique /
Décret n° 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux
structures de médecine d'urgence, in J.O. Lois et décrets n° 119 du 23 mai 2006.

___________________________________________________________________________
FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ 2
février 2009
1.1. Conditions d’autorisation d’activité de médecine d’urgence
Les décrets n° 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006, publiés au Journal Officiel du 23 mai 2006
fixent le régime d’autorisation de l’activité de médecine d’urgence qui remplace désormais l’appellation
« accueil et traitement des urgences ».
Ils déclinent l’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence selon trois modalités :
- la régulation des appels adressés au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ;
- la prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ;
- la prise en charge des patients accueillis dans une structure des urgences.
Ces décrets suppriment les appellations SAU (Service d’accueil et de traitement des urgences) et
UPATOU (Unité de proximité d’accueil, d’orientation et de traitement des urgences), regroupées
dorénavant sous forme de structures autorisées à l’activité de médecine d’urgence. La notion de
POSU (pôle spécialisé d’accueil et de traitement des urgences) disparaît également au profit de celle
de plateaux techniques spécialisés.
On ne distingue plus que deux types de structures : structure des urgences et structure des urgences
pédiatriques. Pour la structure mobile d’urgence, deux types d’autorisation sont prévus : SMUR et
SMUR pédiatrique.
Tout établissement de santé qui souhaite disposer d’une structure d’urgence doit obtenir une
autorisation délivrée par l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) concernée. Cette autorisation
est conditionnée par plusieurs éléments. L’établissement de santé doit disposer, pour exercer l’activité
de médecine d’urgence :
- de lits d’hospitalisation complète en médecine ;
- d’un accès à un plateau technique de chirurgie, d’imagerie médicale et d’analyses de
biologie médicale, en son sein ou par convention.
A défaut d’une telle autorisation, l’établissement de santé n’est pas dispensé de répondre aux
obligations générales de secours et de soins aux personnes en danger qui s’adressent à lui. Cette
obligation se manifeste :
- par la dispensation de soins immédiats au patient se présentant aux heures d’ouverture de
ses consultations et s’il y a lieu, en l’adressant ou le faisant transférer, après régulation par
le SAMU, dans un établissement autorisé ;
- par la dispensation des soins non programmés à tout patient qui lui est adressé par un
médecin libéral exerçant en cabinet, après examen et consentement du patient, lorsqu’un
accord préalable direct a été donné par le médecin de l’établissement appelé à dispenser
les soins nécessaires ;
- par la dispensation de soins non programmés à tout patient adressé par le SAMU lorsqu’un
accord préalable à l’accueil dans l’établissement a été donné.
Activité modérée
Afin d’assurer le maillage du territoire en proximité tout en garantissant la qualité des prises en charge
par le maintien des compétences, les structures d’urgence ayant une activité modérée doivent mettre
en place une coopération avec un autre établissement autorisé à faire fonctionner une structure des
urgences et ayant une plus forte activité. Cette coopération peut prendre la forme d’un groupement de
coopération sanitaire.
Aussi, un établissement de santé dont le seuil d’activité de médecine d'urgence est inférieur à 8 000
passages
2
peut être autorisé à exercer l'activité, à condition qu'il participe à un groupement de
coopération sanitaire. Ce groupement de coopération sanitaire prévoit notamment les modalités de
mise à disposition des différents praticiens, tout en leur permettant de conserver leur statut respectif,
qu’ils soient hospitaliers ou libéraux.
2
Arrêté du 12 juillet 2006 fixant le seuil d'activité de médecine d'urgence mentionné à l'article R. 6123-9 du
code de la santé publique, in J.O. Lois et décrets n° 183 du 9 août 2006.

___________________________________________________________________________
FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ 3
février 2009
Activité saisonnière
Un établissement peut, compte tenu d’une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une
structure d’urgence une partie de l’année seulement s’il est organisé en réseau avec un établissement
de santé autorisé à pratiquer la médecine d’urgence.
Les établissements de santé accueillant des patients présentant des troubles mentaux et les
établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux-nés ne sont pas
concernés par ces dispositions.
1.2. Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences
L’organisation de la prise en charge des urgences poursuit un triple objectif de proximité, de sécurité
et d’amélioration de la qualité :
- permettre l’accès aux soins pour tous, en permanence, et en proximité grâce à un maillage
fin du territoire ;
- garantir la sécurité et la permanence par l’accès à des professionnels et à un plateau
technique performant et adapté aux besoins du patient ;
- inscrire le dispositif mis en place dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
des soins et de la politique globale de gestion des risques au sein des établissements de
santé.
L’accueil
L’établissement accueille en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s’y
présente en situation d’urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU.
L’observation, les soins et la surveillance
La prise en charge diagnostique et thérapeutique est organisée, selon le cas, au sein de la structure
des urgences, au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée, ou directement dans une structure
de soins, notamment dans le cadre de prises en charge spécifiques (plateau technique spécialisé,
prise en charge des enfants, des patients âgés relevant de la gériatrie, ou nécessitant des soins
psychiatriques).
Cette prise en charge peut également se traduire par l’orientation du patient vers une consultation de
l’établissement ou d’un autre établissement de santé, vers un autre établissement de santé apte à le
prendre en charge et si nécessaire, vers un médecin de ville ou vers tout autre structure sanitaire ou
tout autre structure médico-sociale adaptée à l’état ou à la situation du patient.
Les patients ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences sont orientés par
l’établissement de santé vers une autre structure, selon des protocoles préalablement définis entre les
responsables des structures et inscrits dans une convention précisant les modalités et conditions
d’orientation du patient ainsi que les modalités de l’évaluation médicale et administrative régulière.
La coordination de la prise en charge du patient entre la structure des urgences et les autres
structures de soins
Les établissements de santé assurent la disponibilité de leurs lits d’hospitalisation.
La sortie du patient de la structure des urgences
L’établissement organise une prise en charge sanitaire et sociale immédiatement ou de manière
différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.
Si le patient le demande ou si le médecin traitant est adresseur, le médecin traitant est informé du
passage du patient et se voit transmettre les informations utiles à la continuité de la prise en charge.

___________________________________________________________________________
FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ 4
février 2009
La tenue d’un registre chronologique continu informatisé
L’établissement autorisé tient, dans la structure des urgences, un registre chronologique continu
informatisé sur lequel figurent l’identité des patients accueillis, le jour, l’heure et le mode d’arrivée,
l’orientation ou l’hospitalisation, l’heure de sortie ou de transfert hors de la structure des urgences.
Conditions techniques de fonctionnement
La qualification des médecins, la composition des équipes, les locaux et l’existence d’une unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD) sont précisées dans le décret n° 2006-577 du 22 mai 2006
relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine
d’urgence.
La structure des urgences comporte :
- une salle d’accueil préservant la confidentialité ;
- un espace d’examen et de soins ;
- au moins une salle d’accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la
réanimation immédiate ;
- une unité d’hospitalisation de courte durée d’au moins 2 lits, dont la capacité est adaptée à
la structure.
Des locaux sont aménagés pour permettre l’accès des personnes vulnérables, notamment
handicapées, pour lesquelles un accueil spécifique est organisé.
L’établissement prévoit, dans le plan blanc, un lieu qui permette d’accueillir des patients ou des
victimes se présentant massivement à la structure et situé, dans la mesure du possible, à proximité de
la structure des urgences. Il prévoit également des modalités d’accueil et de prise en charge adaptées
pour des patients victimes d’un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d’une
pathologie à risque contagieux.
Il organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau
l’accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure :
- aux équipements d’imagerie ainsi qu’aux professionnels compétents ;
- aux analyses de biologie médicale et aux professionnels compétents de la biologie
médicale.
Les résultats des examens d’imagerie et des examens et analyses de biologie et leur interprétation
sont transmis à la structure des urgences dans les meilleurs délais, délais compatibles avec l’état de
santé du patient.
Tous les médecins exerçant dans ces structures ont désormais l’obligation d’avoir la spécialité de
médecine d’urgence ou la reconnaissance d’une expérience de trois ans au moins dans ce type de
service.
Environ 570 médecins urgentistes exercent dans les cliniques privées. Leur âge moyen est de 43 ans.
1.3. Prises en charge spécifiques
Les pôles spécialisés d’accueil et de traitement des urgences (POSU) sont supprimés au profit d’un «
accès direct au plateau technique spécialisé ». Ce dispositif n’est pas encore entré en application.
Accès direct au plateau technique spécialisé
Les patients dont le pronostic vital ou fonctionnel est engagé et nécessitant une prise en charge
médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai, sont orientés directement par le SAMU ou
en liaison avec celui-ci vers le plateau technique adapté à l’état.
L’établissement qui dispose d’un tel plateau technique signe une convention avec un établissement
autorisé en médecine d’urgences afin d’organiser la prise en charge en permanence des patients. La
convention fixe les modalités selon lesquelles les patients qui ne relèvent pas de l’activité pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%