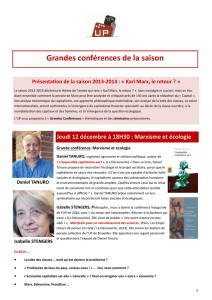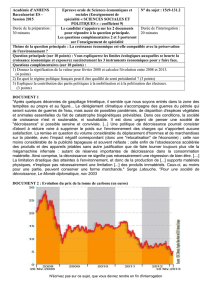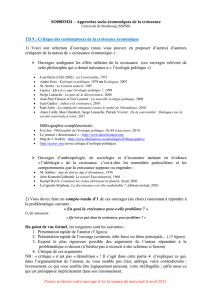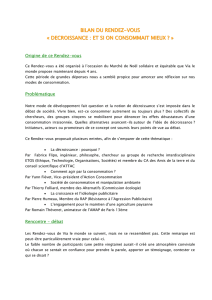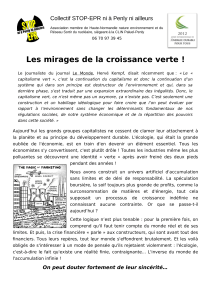Communication au colloque « Penser l`écologie politique : sciences

1
Communication au séminaire « Nature et politique. Séminaire sur l’écologie
politique »
Organisé par Laboratoire de Changement Social et Politique de l’Université Paris
Diderot, Telecom et Management SudParis (Institut Mines-Télécom), l’UMR5600
Environnement, Ville, Société de l’université de Lyon et AgroParistech
Voir [http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/Nature-et-politique-Seminaire-sur]
Université Paris Diderot, 5 février 2015, 17h-19h
Topo : environ 45 mn/1h
****************************************
Écologie politique, décroissance et questionnements libertaires
Par Philippe Corcuff
Je voudrais avancer aujourd’hui une série de questionnements associant
une critique anticapitaliste du productivisme, des problèmes posés par
les objecteurs de croissance ainsi qu’une approche libertaire du thème
du pluralisme. J’en tirerai des conséquences du point de vue d’une
réflexivité épistémologique des sciences sociales, puis sur le plan de la
philosophie politique. Cette exploration participe d’un cadre plus général
de dialogues transfrontaliers entre sociologie et philosophie politique1.
Ces questionnements convergeront vers l’esquisse d’une perspective
pluridimensionnelle de l’émancipation, intégrant un pôle écologiste et
des éléments décroissants dans un cadre plus global, opposé à la thèse
du paradigme écologiste, comme axe principale d’une nouvelle politique
d’émancipation, telle qu’elle a pu être développée sous des modalités
différentes par Alain Lipietz en 19992, puis par Fabrice Flipo en 20143.
Mes investigations suivront cinq étapes complémentaires porteuses
d’éclairages plus ou moins diversifiés, qui chacune nous incitera à nous
saisir davantage de la question de la pluralité. Je m’arrêterai tout d’abord
sur la critique du productivisme et des ressources fournies en ce sens
par les objecteurs de croissance. Puis je m’intéresserai à certains
implicites anthropologique de l’écologie politique et de la décroissance.
Ensuite, je poserai la question des rapports entre anthropologies
philosophiques et sciences sociales. Quatrièmement, je m’arrêterai sur le
traitement de l’histoire des thèmes écologistes, à travers les
controverses autour de l’hypothèse d’un « fascisme vert ».
1 Voir P. Corcuff, Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des savoirs, Paris,
La Découverte, collection « Bibliothèque du MAUSS », 2012.
2 A. Lipietz, Qu’est-ce que l’écologie politique ? La Grande transformation du XXIe siècle, Paris, La
Découverte, 1999.
3 Voir notamment F. Flipo, Pour une philosophie politique écologiste, Paris, Textuel, collection « Petite
Encyclopédie Critique », 2014.

2
Enfin, je terminerai sur l’esquisse d’une philosophie politique pluraliste et
libertaire.
1 – Critique du productivisme capitaliste et ressources de la
décroissance
J’associe critique du capitalisme et critique du productivisme à l’intérieur
d’une sociologie critique du monde existant dans la perspective d’une
philosophie alternative visant l’émancipation individuelle et collective.
On doit d’abord noter le caractère productiviste du capitalisme, au sens
où ce dernier porte une logique de la production pour la production. Le
capitalisme prend appui sur une dynamique illimitée d’accumulation du
capital, associée à la propriété privée des grands moyens de production
et d’échange, alimentée par le profit marchand à court terme. Or, il se
révèle incapable de prendre en compte le temps long de la biosphère ou
des générations à venir. André Gorz, demeuré anticapitaliste jusqu’à la
fin de sa vie, avait bien saisi que la marchandisation de l’humanité et de
la nature portée par la logique capitaliste se heurtait tout à la fois à la
justice sociale, à la qualité existentielle de la vie des individus et à la
préservation des univers naturels4.
Ce faisant, les analyses de Gorz ont anticipé par certains côté les
courants écolo-marxistes, dits écosocialistes5, qui ont mis l’accent sur la
contradiction capital/nature propre au capitalisme, et pas seulement sur
la contradiction capital/travail privilégiée traditionnellement par les
marxistes. Mais comment caractériser la notion même de « contradiction
du capitalisme » ? Je vise ici un ensemble de contraintes structurelles
associées à la dynamique capitaliste mais aussi de possibilités
d’émancipation qu’il laisse ouvertes. Cette double dimension qui
caractérise justement l’approche marxienne du capitalisme comme
dynamique contradictoire. Mais cela nous incite toutefois de rompre ici
avec les ambiguïtés quant à une téléologie historique présentes chez
Marx, dans les moments où il lorgne du côté d’une nécessité historique.
4 Voir notamment A. Gorz, Écologica (textes de 1975 à 2007), Paris, Galilée, 2008.
5 Voir, entre autres, M. Löwy et J.-M. Harribey (éds.), Capital contre nature, Paris, PUF, collection
« Actuel Marx Confrontation », 2003, T. Benton, « Marxisme et limites naturelles : critique et
reconstruction écologiques » (1e éd. : 1989), repris dans Capital contre nature, ibid., J. O’Connor, « La
seconde contradiction du capitalisme : causes et conséquences » (communication de 1990), repris
dans Michael Löwy et Jean-Marie Harribey (éds.), Capital contre nature, ibid., J. B. Forster, Marx
écologiste (chapitres extraits de The Ecological Revolution: Making Peace with the Planet; 1e éd. :
2009), Paris, éditions Amsterdam, 2011, et M. Löwy, Écosocialisme. L’alternative radicale à la
catastrophe écologique capitaliste, Paris, Mille et une nuits/Fayard, 2011.

3
Or, les contradictions du capitalisme, telles qu’entendues ici, pointent
seulement des possibilités, supposant un travail de politisation pour
devenir des logiques pleinement actives, pour s’actualiser, dans une
logique analogue au couple acte/puissance chez Aristote : ce qui n’est
qu’en puissance s’actualisant dans une action6.
Á partir de là, que peut-on dire de la contradiction capital/nature ? La
nature serait elle aussi exploitée dans la dynamique d’accumulation du
capital. Or, dans l’épuisement des ressources naturelles comme dans les
risques techno-scientifiques associés à la logique contemporaine du
profit, le capitalisme mettrait en danger ses propres bases naturelles et
humaines d’existence. Cela appelle un élargissement de l’horizon
temporel de la critique du capitalisme comme de la philosophie politique
émancipatrice par la prise en compte des générations futures, dans le
sillage de la philosophie de la responsabilité formulée par Hans Jonas7.
La notion de « Progrès », au cœur des politiques républicaines-
démocratiques comme des politiques socialistes d’émancipation, ne
devrait pas pour autant être abandonnée, mais s’en trouver redéfinie
dans le sens de ce que j’ai appelé ailleurs des Lumières tamisées8.
Cependant, si capitalisme et productivismes apparaissent associés,
anticapitalisme et antiproductivisme ne l’ont pas toujours été
historiquement. Les sociétés staliniennes en ont été un exemple
historique marquant. Mais déjà chez Marx, les choses apparaissent
ambivalentes. On trouve chez lui tout à la fois une fascination pour
l’essor industriel propre au XIXe siècle, et ses illusions technologistes,
ainsi que des prémisses écosocialistes9. Ted Benton a, par exemple,
bien mis en évidence les difficultés pour rendre visible dans le champ de
vision marxien, et plus encore ensuite marxiste, la question des « limites
naturelles » de la croissance10. Plus largement, on doit noter que nombre
de courants de la galaxie socialiste née au XIXe siècle, comme de la
gauche républicaine qui l’a précédée, ont souvent été profondément
marqués par la vision non critique d’un « Progrès » scientifique et
technique supposé intrinsèquement positif.
6 Voir notamment Aristote, Éthique de Nicomaque, trad. et préface de J. Voilquin, Paris,
GF/Flammarion, 1965.
7 H. Jonas, 1993, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique (1e éd. :
1979), Paris, Cerf, coll. « Passages », 1993.
8 Dans P. Corcuff, La société de verre. Pour une éthique de la fragilité, Paris, Armand Colin, collection
« Individu et Société », 2002.
9 Voir la partie III, intitulée « La vie, les tentations productivistes et la question écologiste », de mon
livre Marx XXIe siècle. Textes commentés, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique »,
2012.
10 T. Benton, « Marxisme et limites naturelles : critique et reconstruction écologiques », op. cit.

4
Ici la galaxie de la décroissance, en tant que courant intellectuel et
mouvement social récent, apparaît utile afin d’aider la gauche
écosocialiste à affiner ses perspectives, en bousculant davantage
certaines évidences portées par l’histoire des gauches sur le plan
écologique. Il s’agit ici de « la décroissance » comme outil pour
« décoloniser l’imaginaire », selon l’inspiration de Serge Latouche11, ou
comme « mot-obus », selon l’expression de Paul Ariès12. En tant que
concept critique, « la décroissance » permet d’interroger ainsi une série
d’évidences et d’impensés actifs à gauche, et en particulier l’idée
prégnante que le plus équivaut au mieux. Ce qui débouche sur un axe
émancipateur décalé synthétisée par la formule « moins de biens, plus
de liens »13. Sur le plan de l’action émancipatrice, la galaxie de la
décroissance a fourni aussi des pistes stimulantes en ouvrant de
nouvelles possibilités d’articulation entre actions individuelles (ce qui est
appelé « la simplicité volontaire »), expérimentations collectives
localisées et action politique globale.
Cependant, la prise en compte de ces apports des objecteurs de
croissance ne conduit pas nécessairement à faire de « la décroissance »
l’axe principal de la pensée critique comme d’une philosophie politique
émancipatrice. Plutôt que de s’arrêter sur un axe principal, à la manière
des marxistes, tant sur le plan de la critique (pour les marxistes, la
contradiction capital/travail) que de la perspective d’émancipation (pour
les marxistes, le rôle central du prolétariat), la critique du productivisme
capitaliste peut nous conduire vers une pluralité de dimensions.
2 – Sur des implicites anthropologiques travaillant l’écologie
politique et la décroissance
En se posant la question des rapports entre les humains et la nature
l’écologie politique en général et la décroissance en particulier portent
des questions anthropologiques au sens philosophique des présupposés
quant aux conceptions de la condition humaine, tant dans l’analyse du
monde tel qu’il est que dans le dessin d’alternatives. Cependant leurs
présupposés sont souvent implicites.
11 Voir notamment S. Latouche, Survivre au développement, Paris, Mille et une nuits/Fayard, 2004, pp.
115-119.
12 Voir P. Ariès, « Adresse aux objecteurs de croissance qui veulent faire de la politique », Les cahiers
de l’IEESDS, n°1, décembre 2006, p. 4, [http://www.decroissance.org/textes/cahiers_ieesds1.pdf].
13 P. Ariès, La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance, Paris, Les empêcheurs de penser
en rond/La Découverte, 2010, p. 225.

5
Ici la mise en parallèle d’un pôle anthropologique exprimé par Marx et
d’un pôle anthropologique exprimé par Durkheim dans certains de leurs
textes va faciliter notre explicitation des référents anthropologiques
portés par les critiques écologistes et décroissantes du monde, comme
des alternatives sur lesquelles elles peuvent déboucher14.
Une des anthropologies philosophiques alimentant la critique marxienne
du capitalisme, depuis les Manuscrits de 1844 jusqu’au livre 1 du
Capital, est celle de « l’homme total » ou « individu complet », selon
l’expression de Marx lui-même. Dans cette anthropologie, les humains
seraient dotés de désirs et de passions infinis. Ces désirs et ces
passions sont considérés comme des potentialités créatrices. Le désir et
la passion apparaissent souvent chez Marx comme intrinsèquement
positifs et émancipateurs. Le capitalisme (comme ce qu’il appelle
« communisme vulgaire » dans les Manuscrits de 1844) constitue un
cadre social entravant, étouffant, amenuisant ces capacités humaines.
Pour Marx, une société émancipée devait libérer les désirs humains
créateurs de leurs entraves, comme la marchandisation et la
spécialisation capitaliste du travail. On pourrait parler chez Marx d’une
anthropologie philosophique des désirs humains créateurs, associée à
une philosophie politique émancipatrice. Quand les écologistes veulent
réorienter les humains de « l’avoir » vers « l’être », on présuppose
souvent de telles propriétés créatrices chez les humains.
Un des fondateurs de la sociologie universitaire française, Durkheim,
partait, dans sa critique du monde moderne, d’un point de départ
proche : « la nature humaine » (expression utilisée par lui) serait
caractérisée par des « besoins » potentiellement « illimités »15. Mais
cette illimitation relèverait de l’« insatiable »16. Le caractère insatiable des
désirs humains les rendrait alors frustrants. « Une soif inextinguible est
un supplice perpétuel », écrit-il17. D’où une certaine philosophie politique
d’inspiration républicaine accrochée à sa sociologie : il faudrait, au
moyen notamment de l’éducation, mettre des bornes – des normes
sociales et des contraintes sociales – sur lesquelles viendrait buter le
caractère destructeur et auto-destructeur des désirs humains. On
pourrait donc repérer chez Durkheim une anthropologie philosophique
des désirs frustrants, associée à une philosophie politique républicaine.
14 Voir le chapitre 5, intitulé « Les conditions humaines de la sociologie », de P. Corcuff, Où est
passée la critique sociale ?, op. cit.
15 É. Durkheim É., Le suicide (1ère éd. : 1897), Paris, PUF, collection « Quadrige », 1999, p. 273.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 274.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%