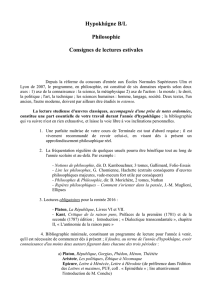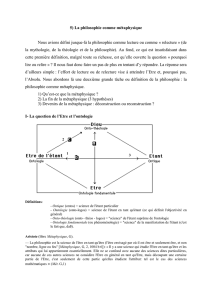Chapitre 8 - Philopsis

E R.
FRANÇOIS-XAVIER CHENET
LA MÉTAPHYSIQUE
DE LA MÉTAPHYSIQUE
Essais et Recherches

Les textes publiés sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
© Françoise Chenet - Philopsis 2008
Philopsis éditions numériques
http ://www.philopsis.fr

E R.
CHAPITRE VIII
LA THÉORIE DE LA MÉTHODE
« La philosophie est le fait de donner des lois à la raison »
Réfl. 1663 (1776-78)
Philopsis
© françoise Chenet
3
http://www.philopsis.fr

Objet et plan
La division de la Critique en une théorie des éléments et une
théorie de la méthode avait été annoncée à la fin de l'introduction où
Kant écrit que « si l'on veut organiser la division de cette science du
point de vue universel de la division d'un système, en général, il
faut que celle que nous exposons maintenant contienne : premiè-
rement, une théorie des éléments [Elementarlehre] ; deuxièmement,
une théorie de la méthode [Methodenlehre] de la raison pure »
(cf. A 15/ B 29 ; R 113).
Sa brièveté (de l'ordre du sixième du texte entier, du cin-
quième de la Théorie des éléments), sa composition en cha-
pitres de plus en plus courts (le dernier se limitant à deux
pages et demie) sont autant de (mauvaises) raisons pour la
regarder de haut ! En fait, la brièveté d'un développement
n'est pas chez Kant l'indice de son caractère secondaire.
Sans soutenir que l'importance de la question traitée soit ré-
gulièrement dans la Critique inversement proportionnelle à
la place qui lui est consacrée, soulignons l'extrême impor-
tance de chapitres proportionnellement peu étendus : l'Es-
thétique transcendantale, le chapitre du schématisme de
l'entendement pur, la section des postulats de la pensée
empirique, l'Appendice à la Dialectique transcendantale.
La Théorie de la méthode ou Méthodologie transcendantale est
maintenant présentée comme un simple complément destiné à para-
chever
le système de la raison pure
: il faut encore doter la théorie
transcendantale d'une discipline, d'un canon, d'une architectonique
et d'une histoire de la raison pure. La fin que poursuivait la Théorie
des éléments était l'évaluation des matériaux de la connaissance et la
détermination de la nature de d'édifice qu'ils permettent de cons-
truire. Sans doute le résultat de cette recherche est-il que notre pro-
vision de matériaux n'autorise – au lieu de la tour (de Babel
: «
ein
Turm, der bis an den Himmel reichen sollte
») que nous rêvions de
construire –, que la construction d'une simple «
maison d'habi-
Philopsis
© françoise Chenet
4
http://www.philopsis.fr

tation [Wohnhaus] ». Comme le nomadisme sceptique ne peut
nous satisfaire, nous ne pouvons renoncer à construire une résidence
[Wohnsitz] solide, mais la Critique nous a avertis [gewarnt] de ne
pas nous aventurer sur un projet arbitraire et aveugle (tel celui que
nourrit la métaphysique spéculative dogmatique). Il nous faut donc
précisément faire maintenant le
devis [Vorrat] d'un édifice [Ge-
bäude] qui soit en rapport avec les matériaux [Bausteine] dont nous
disposons, d'une part, et qui soit approprié à nos besoins [Bedürf-
nis], d'autre part. Maintenant que nous savons précisément ce que
nous pouvons connaître, il s'agit d'élaborer une métaphysique ap-
propriée à nos besoins (l'intérêt pratique de l'homme), mais qui
tienne compte des limites de notre connaissance.
On aurait donc tort de ne voir dans la Théorie de la méthode
qu'un complément – au fond, facultatif –, seulement destiné à assu-
rer la perfection architectonique du système. On doit la tenir pour la
conclusion véritable de la Critique qui ne contient – le fait est à souli-
gner – aucune section portant ce nom. Sa brièveté se comprend d'ail-
leurs bien, de ce point de vue : autant la Méthodologie peut paraître
bien maigre comme pendant de la Théorie des éléments, autant l'on
comprend que, comme conclusion, elle soit d'une étendue res-
treinte. Elle constitue le versant positif de la critique de la méta-
physique i. La Critique est, en effet, écrite en vue du « Canon de la
raison pure ». Après avoir renouvelé la leçon essentiellement néga-
tive de la Dialectique transcendantale, et avoir ainsi écarté une nou-
velle fois l'idée d'un usage légitime de la raison pure dans l'usage
spéculatif, Kant définira l'ensemble des principes a priori de l'usage
légitime de la raison, lequel ne peut être qu'un canon de son usage pra-
tique. Les conclusions que tire la Théorie de la méthode, le pro-
gramme qu'elle dessine, la transition qu'elle constitue entre la Criti-
que de la raison pure et la Critique de la raison pratique, sont autant
de raisons de s'inscrire en faux contre la légende tenace qui veut ab-
solument qu'elle soit une partie très ancienne de l'œuvre. Il en va en
effet dans cette section de la Critique de la détermination des conditions
de l'usage légitime de la raison pour la métaphysique future.
La Méthodologie transcendantale est tout entière tournée vers
l'avenir. Après avoir longuement tiré les leçons implicites de la
Théorie des éléments (le chapitre «
De la discipline de la raison
» oc-
Philopsis
© françoise Chenet
5
http://www.philopsis.fr
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%